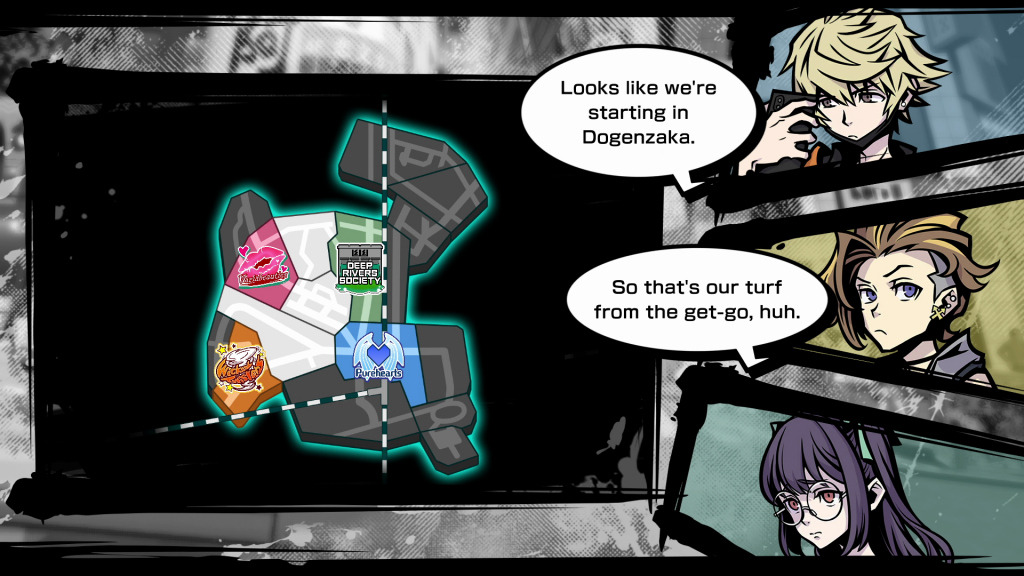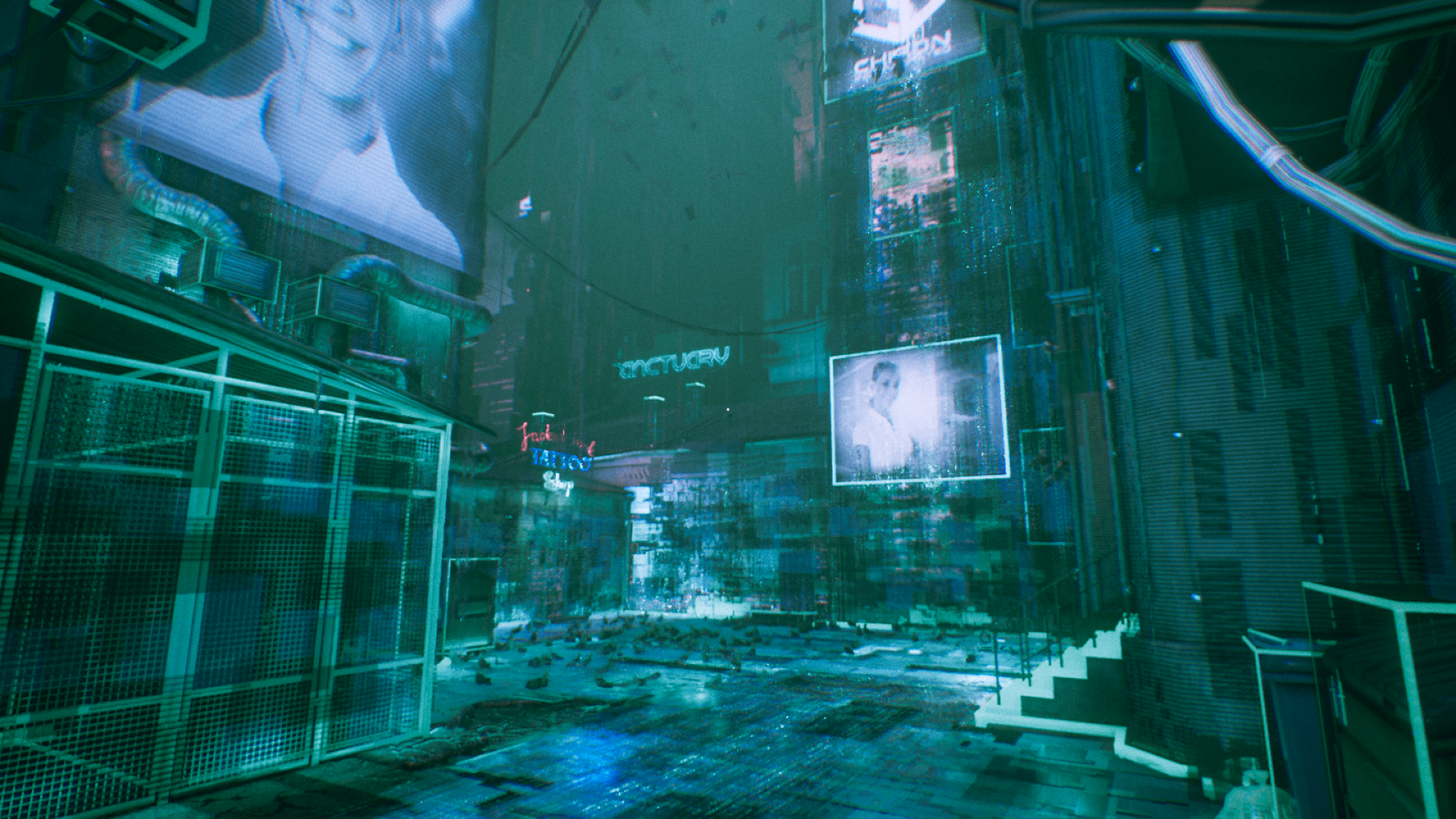Third Editions est une maison d’édition fondée en 2015, spécialisée avant tout dans le jeu vidéo mais qui propose aussi plusieurs ouvrages sur le cinéma, les séries et la bande dessinée. Après de nombreux ouvrages analysant bien des licences vidéoludiques (Kingdom Hearts, Final Fantasy, Death Stranding, Resident Evil…), c’est au tour de The Last of Us d’être décrypté dans un livre écrit par Nicolas Deneschau. L’auteur est familier du studio Naughty Dog, puisqu’il avait déjà analysé la saga Uncharted auparavant chez le même éditeur. Il est évidemment déconseillé de lire ce documentaire si vous n’avez pas encore joué à The Last of Us. Mais pour ceux qui ont aimé la licence, pour ceux qui ont eu un avis mitigé sur le deuxième opus, Décrypter les jeux The Last of Us s’avère un ouvrage tout simplement passionnant, riches d’informations et de détails, une véritable ode aux jeux, sans pour autant oublier de pointer leurs défauts et les circonstances de leur création.
Un passage en coulisses
Un avant-propos permet à Nicolas Deneschau de mettre l’accent sur ce qui fait sans aucun doute la force de l’univers de The Last of Us : un monde post-apocalyptique dans lequel règne la violence, certes, mais aussi l’émotion et l’amour pour ses proches. Un monde effondré, mise en garde de notre propre époque actuelle avec les menaces existantes (pandémie, guerres, dérives sociétales, etc) mais où déjà, tout est à réinventer en l’absence d’un futur meilleur, où le présent reste finalement la seule option. Et dans un tel monde, que reste-t-il ? Pas forcément le patriotisme ou la croyance en un idéal, mais ceux qui restent, les humains survivants, attachés les uns aux autres, se haïssant parfois, mais qui demeurent ceux pour qui il convient de survivre et de se battre. Dans un tel monde, la question est de savoir « jusqu’où aller par amour », un thème qui régit les personnages de The Last of Us du premier au deuxième opus. Qui nous rend les personnages aussi attachants et déchirants, qui nous fait nous impliquer dans ces histoires avec une force émotionnelle intense, orchestrée en arrière-plan par tout le savoir-faire du studio.
C’est pourquoi l’ouvrage va donc se concentrer sur la création du studio Naughty Dog dans les premiers chapitres, ses évolutions et ses progrès techniques, son avancée dans la création des jeux vidéos, le passage de diverses personnalités au sein de l’entreprise, chacune apportant leur pierre à l’édifice. Passer par Crash Bandicoot, Jak et Dexter, puis surtout Uncharted, permet de saisir le contexte de création de The Last of Us. C’est toute l’expérience sur ces précédentes œuvres qui permet de glisser des idées et un savoir-faire pour la future licence, que ce soit d’un point de vue technique, narratif, ou pour proposer une histoire réaliste et sans dissonance ludo-narrative, un aspect longtemps reproché à Uncharted. Toute cette partie sur les origines du studio et son évolution permet de comprendre le travail chez Naughty Dog, leur processus de création d’un jeu, les variations et brouillons au sein d’un même projet, de manière passionnante, à travers ces coulisses qu’on est souvent loin d’imaginer en jouant à un de leurs jeux. Il est fascinant de découvrir ainsi les premières idées qui ont donné naissance à The Last of Us, ses influences, et de voir comment le projet a évolué, des premiers grands traits de l’histoire, jusqu’à parfois quelques mois avant la sortie du jeu pour la création des Infectés.
Une plongée analytique au fil des jeux
Après ce détour nécessaire par l’histoire de Naughty Dog, Nicolas Deneschau passe dans les chapitres suivants à une véritable analyse détaillée et poussée de The Last of Us, dans une première partie (Acte I) consacrée au premier opus, ainsi qu’au DLC Left Behind et au comics American Dreams. L’auteur mêle son analyse des différents niveaux du jeu aux réflexions des créateurs du studio, mais s’appuie également sur diverses chansons évoquant l’atmosphère et le ressenti particulier de la licence. Il utilise aussi des citations de Robert McKee, dont l’ouvrage Story : Ecrire pour le cinéma et la télévision est une référence sur les grandes principes de narration, tels qu’on les retrouve utilisés dans The Last of Us. De références en références, Nicolas Deneschau offre là une profondeur d’analyse véritablement appréciable du premier opus, décortiquant les grands axes de l’histoire comme des détails, qu’on ne voit pas forcément, même après avoir fait les jeux plusieurs fois ! L’auteur nous fait revivre les jeux, pour mieux nous parler de ses différentes strates. L’ouvrage parle aussi bien du lore qu’on peut découvrir en tant que joueur, que de la musique, du choix des couleurs selon le moment du jeu, l’évolution des personnages, les échos en miroir d’une scène à l’autre, la mise en scène de l’environnement et son exploration, le concept des ennemis…
On en découvre beaucoup sur le premier opus, y compris même sur les prémices du second jeu, où en 2014, un événement live permettait d’avoir un aperçu du prologue de The Last of Us Part II. La deuxième partie du livre (Acte II), plus longue, se concentre donc sur le second opus, avec tout autant de richesse et de profondeur, d’analyse à tous les niveaux (technique, narration, doublage, histoire, gameplay, idées abandonnées…). Les premières idées de suite sont décrites, avec une volonté assumée de faire un jeu qui marque et qui ne laissera personne indifférent, quitte à cliver lors de la sortie du jeu. C’est ce qui est effectivement arrivé, avec ce jeu de miroir entre Ellie et Abby, entre vengeance et rédemption, nous faisant traverser deux visions d’un même lieu pour mener à un final aussi tragique que bouleversant.
D’autres aspects appréciables de l’ouvrage se retrouvent aussi dans cette seconde partie, avec un paragraphe consacré notamment à l’originalité des personnages mis en scène dans le deuxième opus : des femmes extrêmement différentes, d’Abby à Ellie en passant par Dina, toutes représentatives d’un caractère précis, sortant des normes et des stéréotypes féminins, au grand dam de certains joueurs. Il n’est pas non plus oublié de parler des conditions de travail qui ont eu lieu chez Naughty Dog, que ce soit les départs de certains salariés et personnes représentatives du studio, ou bien le crunch qui a duré de 2018 à 2020. Ce dernier a entraîné des burn-out pour les employés et des démissions, à force de travailler pour un jeu certes magistral, mais qui condamne aussi le bien-être des salariés. L’auteur nous parle certes des qualités et du savoir-faire de Naughty Dog, mais aussi des défauts du studio, de la même manière qu’il n’hésite pas à mettre en avant les défauts qu’on peut reprocher aux jeux The Last of Us, entre quelques longueurs ou certaines facilités d’écriture manquant parfois de subtilité. Car on peut parfaitement aimer un jeu tout en lui reconnaissant quelques torts ! Un paragraphe est d’ailleurs également consacré aux réactions (parfois violentes) qui ont eu lieu dans la communauté des fans suite à The Last of Us Part II qui n’a pas plu à tout le monde, que ce soit à cause de ses personnages (Abby en tête), parce que l’histoire prenait un chemin auquel on ne s’attendait pas, ou à cause de sa violence. Il est vraiment bienvenu d’avoir pris le temps de s’attarder sur les polémiques qui ont eu lieu, en éclairant chaque fait et en suscitant la réflexion.
Conclusion
Un simple article peine bien à retranscrire la profondeur de Décrypter les jeux The Last of Us, tant le documentaire fourmille de travail de recherche, de détails, de comparaisons, d’analyses, et respire en même temps un profond amour pour cette licence. Les 300 pages se lisent extrêmement bien, certes grâce à la passion portée au sujet, mais aussi grâce à la finesse d’écriture de Nicolas Deneschau, qui fait toujours dans la subtilité et la nuance. Il n’hésite pas à critiquer, et retranscrit en même temps à merveille l’immersion dans le monde viscéral et post-apocalyptique de The Last of Us, empli de violence, d’horreur, de contemplation, d’émotion et d’intensité. L’ouvrage permet de voir tout le travail accompli par Naughty Dog pour créer une licence qui a marqué l’histoire du jeu vidéo. Il propose un nouvel éclairage sur les deux opus, au point de donner envie de replonger dans l’aventure une fois la dernière page tournée. L’auteur nous transmet toute sa passion, son amour et sa réflexion sur le jeu et ses thématiques, de manière palpable et immersive, offrant un livre incontournable et d’une superbe richesse. Et comme d’ordinaire chez l’éditeur, l’ouvrage est également d’une belle qualité en tant qu’objet-livre et en terme de confort de lecture, avec une très belle couverture signée Vin Hill, chargée d’atmosphère et de symbolisme. Un coup de cœur à ne pas manquer, tout simplement.
- Décrypter les jeux The Last of Us : Que reste-t-il de l’humanité ? est publié chez Third Editions et est disponible depuis le 24 juin 2021 dans toutes les librairies.
- Un extrait du livre est disponible sur le site de l’éditeur à cette adresse.
- L’équipe de Pod’Culture avait également consacré un podcast à The Last of Us Part II, riche en débats et discussions.
- Nicolas Deneschau était l’invité du 4ème épisode de Chill Chat pour parler de l’écriture de son livre.