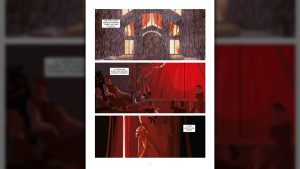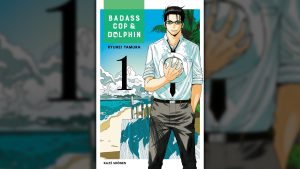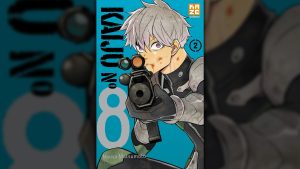On connaît l’amour du public Français pour les J-RPG, et ce depuis les années 1990 où de nombreux titres du genre ont déferlé en Europe après avoir longtemps eu du mal à dépasser les frontières du Japon. Alors il n’y a rien d’étonnant à voir des studios s’essayer à des hommages, ou au moins à des inspirations, à l’image de Astria Ascending dont on parlait récemment. Mais cette fois-ci il s’agit d’un autre jeu et d’un autre studio, puisque Midgar Studio, une boîte basée à Nîmes s’est mis en tête il y a quelques années de créer son propre RPG à la Japonaise. Lancé avec un financement participatif en 2015, le jeu a d’abord connu un accès anticipé débuté en 2018 sur PC, puis une sortie finale le 8 juin 2021. Désormais, c’est un portage sur consoles qui passe entre nos mains, avec une édition PlayStation 5 qui sort ce 10 février 2022.
Cette critique a été écrite suite à l’envoi d’un exemplaire par l’éditeur. Le jeu a été parcouru sur PlayStation 5.
Références et identité
La planète Heryon est en proie à une terrible maladie, la « Corrosion », qui dévaste la population. En guerre, le monde est au bord du précipice, et parmi les soldats se trouve Daryon, un homme qui déserte le front après un terrible événement pour rejoindre sa sœur Sélène, une prêtresse. Tous deux au chevet de leur mère atteinte par la corrosion, ils se lancent dans une quête à travers le monde pour trouver un remède pour leur mère. Evidemment, et dans le plus pur esprit des J-RPG, on s’aperçoit vite que leur quête se mêle aussi au destin du monde et de sa guerre, eux qui incarnent une jeunesse qui cherche à survivre et à changer les choses. Très vite, on sent une démarche sincère et ambitieuse dans Edge of Eternity, tant dans son histoire qui rend hommage à des mastodontes du genre que pour sa volonté de créer sa propre identité. De Final Fantasy par son système de combat à Xenosaga ou Xenoblade pour son univers visuel, ou même Dragon Quest pour quelques thématiques et quêtes, le titre de Midgar Studio multiplie les références mais n’hésite en effet pas à s’en servir comme tremplin pour mieux assumer son identité. Le jeu parvient à façonner son propre ton, sa propre originalité, grâce à une direction artistique (notamment sur les environnements) qui est sublimée par son inventivité et ses belles idées. Il y a en effet quelque chose de très enchanteur dans l’univers de Edge of Eternity, avec un monde très divers, coloré et aguicheur, toujours prêt à nous éblouir par de nouvelles idées visuelles, incitant à l’exploration et donnant envie de toujours aller plus loin pour découvrir ce qu’il nous réserve.
Mais cette direction artistique est plus capricieuse lorsqu’il s’agit des personnages, qui sont eux beaucoup plus classiques et rarement réussis. D’autant plus que les dialogues peinent à nous intéresser dans un premier temps, avec une caractérisation très lente, l’intérêt de nos héros principaux (Daryon et Sélène) n’apparaissant finalement qu’assez tard dans le jeu. C’est peut-être lié à l’histoire qui, elle-même, met du temps à se lancer, alors que le jeu repose énormément sur ses systèmes pour accrocher. Pourtant, l’histoire de Edge of Eternity a de belles choses à raconter, en mêlant des thématiques liées au Divin à des thématiques plus proches de nos préoccupations en matière d’environnement ou de rébellion face à l’ordre établi. Daryon, le héros, incarnant un déserteur prêt à outrepasser les ordres du corps militaire pour sauver les siens, mais aussi porter assistance aux personnes qui sont mises à l’écart ou opprimées par le pouvoir. Il n’est pas pour autant un personnage complètement désintéressé, comme l’indique un dialogue plutôt bienvenu entre lui et sa soeur où ils s’interrogent sur la difficulté à tenir le même esprit face aux personnes qu’ils rencontreront dans leur aventure : faut-il aider tout le monde ? Sauver toutes les personnes qui demandent leur aide ?
La démesure de Edge of Eternity n’est d’ailleurs pas que dans l’amour que le jeu montre pour le genre qu’il référence, mais aussi dans l’étendue de son aventure. Généreux dans ses quêtes, que ce soit en nombre ou en découverte de son lore, le titre de Midgar Studio nous embarque dans une longue aventure qui ne cesse de se renouveler et d’apporter des choses et des idées nouvelles, faisant découvrir que le petit monde d’Heryon n’est en réalité pas si petit. On y voit un monde avec une longue histoire, des habitant·e·s qui vivent leur vie, qui ont leurs tracas et qui ont toujours beaucoup de choses à nous raconter, un peu à la manière d’un Dragon Quest où l’on se déplace de ville en ville pour découvrir les petites histoires du coin. Cela donne au jeu un ton très chaleureux et accueillant, malgré les monstres qui peuplent les plaines. Mais c’est aussi à double tranchant, car l’ambition et la démesure de Edge of Eternity ne peut gommer le fait que le titre a été développé par une petite équipe, qui a parfois eu les yeux plus gros que le ventre. Ainsi le monde est plein de quêtes secondaires peu intéressantes, et c’est surtout dans sa mise en scène que l’on remarque toutes les limites du jeu. Plutôt pauvre, avec une narration qui a des (très) hauts et des (très) bas, la mise en scène des cinématiques est très statique, sans beaucoup de vie, avec des dialogues qui sonnent parfois faux et quelques personnages auxquels on a bien du mal à croire. Mais pourtant, Edge of Eternity arive toujours à retomber sur ses pieds, en fascinant pour son univers, et en faisant bien vite oublier ses défauts. On a envie de l’aimer, et le jeu nous le rend souvent bien. Notamment avec sa bande originale de Cédric Menendez qui convoque là aussi de nombreuses références dans les jeux cités ci-dessus, associé à l’immense compositeur Yasunori Mitsuda (Xenogears, Xenoblade, Chrono Trigger…) qui a fait un beau cadeau à l’équipe de développement en offrant quelques titres très inspirés.
L’originalité de son système
Le système de combat de Edge of Eternity est plutôt atypique. Il ne serait pas bien difficile de se limiter à l’idée d’hommage encore une fois, puisque le jeu récupère le système ATB (active time battle) des Final Fantasy. Ainsi tous les personnages, qu’il s’agisse des protagonistes ou des ennemis disposent d’une barre d’action qui se recharge avec le temps, selon leurs stats de vitesse. Peu importe donc le concept de « tour par tour » puisqu’en réalité, un même personnage peut attaquer plusieurs fois de suite s’il est suffisamment rapide face à un ennemi lent. Un système qui a fait le succès de la saga Final Fantasy, et que Edge of Eternity vient doubler d’une organisation tactique par cases (en hexagones) où il faut placer nos personnages pour prendre l’ascendant. Soit profiter de bonus liés à un objet sur le terrain, pour se remettre face à un ennemi qui nous aurait contourné ou à l’inverse, contourner un ennemi pour le frapper dans le dos et ainsi multiplier les dégâts. Cela permet aussi d’esquiver des magies ennemies qui mettent plus d’un tour à se lancer. Ce mélange de deux systèmes donne un ensemble plutôt efficace, et si le jeu souffre de sérieux problèmes d’équilibrages avec des ennemis qui ont parfois trop de vie (ou qui tapent soudainement trop fort), on prend un malin plaisir à exploiter les forces et faiblesses du système. D’abord en tentant de prendre l’ascendant par le terrain, puis en utilisant à bon escient les magies élémentaires pour faire de sérieux dégâts selon les résistances et faiblesses adverses.
Il y a toutefois des limites au système. Le jeu offre certes plusieurs modes de difficultés pour pallier l’équilibrage qui pousse trop souvent à se lancer dans des sessions de gain d’expérience pour survivre à la suite du jeu. Toutefois, cela ne permet pas de passer outre un aspect visuel souvent confus avec des casques qui ne sont pas affichées de manière évidente, sans parler de la caméra que l’on bouge sans arrêt (malgré l’aspect statique des combats) pour tenter d’y voir plus clair. Il est ainsi parfois compliqué de voir si l’ennemi a l’ascendant, à cause d’un manque de clarté visuelle qui met à mal un système pourtant super intéressant. On peut quand même le surmonter en passant un peu plus de temps à trifouiller la caméra et en mettant en évidence les hexagones, toutefois le jeu n’a pas la finesse et l’évidence des tacticals les plus réputés, malgré ses excellentes idées et son choix malin de mélanger la tactique au système ATB. Un peu malgré lui, Edge of Eternity en devient plus exigeant qu’il n’en a vraiment l’intention, la faute aux quelques ratés de son système de combat plutôt qu’à ses nombreuses qualités. L’équilibre est un des éléments fondamentaux des J-RPG pour que leurs combats restent agréables jusqu’au bout sans que l’exigence ne tombe jamais dans la punition bête et méchante. Le titre de Midgar Studio flirte souvent avec cette limite et a parfois du mal à tomber du bon côté.
La progression des personnages quant à elle repose essentiellement sur l’amélioration des armes, via le craft de cristaux. Un système au départ un peu obscur, mais qui se révèle vite être en réalité une sorte de sphérier qui se laisse manipuler avec plaisir, et qui permet de spécialiser nos personnages dans ce que l’on veut sans être véritablement obligé·e de suivre un fil conducteur défini par la classe d’un personnage, contrairement à beaucoup de J-RPG. Ce système pousse donc à utiliser régulièrement de nouvelles armes, toujours plus puissantes, et à monter leur niveau au fil du temps pour gagner de nouveaux slots afin d’y caser des cristaux que l’on a pu crafter plus tôt en les assemblant pour en varier les propriétés. Ce système a néanmoins quelques limites qui relèvent plutôt des chances de tomber sur des cristaux : ceux-ci sont distribués de manière aléatoire lors des combats contre des ennemis (ainsi que dans des coffres et en récompense de quêtes), ainsi il peut se passer un certain temps avant que l’on obtienne la bonne couleur de cristaux, certaines couleurs disparaissant totalement pendant quelques temps par manque de chance. On peut partiellement y pallier en allant du côté des boutiques pour en acheter, néanmoins le jeu est plutôt avare en argent dans les vingt premières heures de l’aventure, cela n’est donc pas toujours évident. Certes, il était inévitable pour le studio de mettre une dose d’aléatoire dans le drop de tels objets, toutefois on sentait parfois la progression ralentie à cause d’un manque de chance de ce côté-là, alors qu’il arrive inversement que l’on gagne soudainement énormément de puissance en ayant parvenu à faire tomber des cristaux supérieurs qui mettent un sacré coup de fouet aux armes.
Un déficit technique qu’on n’ignore pas
De ses animations jusqu’au chara design parfois à côté de la plaque, malgré quelques réussites sur les personnages principaux, Edge of Eternity est loin de briller. Le titre rappelle régulièrement, et malgré lui, qu’il n’a pas les moyens des mastodontes qu’il référence chaque fois qu’une cutscene intervient et que l’on voit des personnages en gros plans. Les animations apparaissent statiques, quelques protagonistes sont plutôt vilains, et la mise en scène manque d’énergie. L’ensemble tranche complètement avec les qualités de direction artistique du côté des décors et environnements qui sont, eux, malgré des limitations techniques, une véritable invitation au voyage. Et fort heureusement, on passe plus de temps à les admirer qu’à se coltiner des cutscenes que l’on peine souvent à prendre au sérieux, quand les personnages ressemblent à des mannequins sans vie. Ainsi, Edge of Eternity parvient tout de même à donner une bonne impression visuelle, fort de son univers que l’on adore arpenter et que l’on se rêve même à voir revenir dans une forme plus aboutie, avec une éventuelle suite. Le titre souffre toutefois d’une technique compliquée, y compris sur PlayStation 5 où de nombreuses chutes de framerate rendent l’exploration parfois pénible, et ce peu importe le mode graphique choisi. À cela s’ajoutent des collisions hasardeuses, et on en arrive à un jeu qui n’a jamais la technique de ses ambitions, malgré tout l’amour dont il déborde.
Initialement une sorte de fantasme de J-RPG par des personnes qui ont certainement grandi avec le genre, Edge of Eternity a pour lui un univers à l’identité bien marquée malgré les nombreuses références. Des hommages qu’il adresse avec beaucoup de sincérité, sans se réfugier derrière elles, et plutôt en assumant ses emprunts afin de se forger son propre monde. Le jeu déborde d’amour et d’envie de bien faire, ce qui rend sa critique d’autant plus difficile qu’il parvient le plus souvent à séduire. Mais il faut aussi avoir en tête que son histoire met un sérieux temps à démarrer, à tel point que l’on a parfois l’impression d’avancer sans raison, tandis que son déficit technique est clairement handicapant au moment où il débarque sur consoles. Qu’il est bon toutefois de voir des titres qui osent, qui assument pleinement leurs ambitions et qui prouvent que la création de jeux vidéo en France a de beau jour devant elles. Le studio a notamment bénéficié du Fonds d’aide au jeu vidéo du CNC, et c’est plutôt super de voir que ce type de projet, plein de bonnes idées, puisse profiter d’un coup de pouce. En bref, si vous aimez l’imaginaire des voyages dans les J-RPG vous devriez donner une chance au titre de Midgar Studio, et si vous ne connaissez pas le genre, ce ne serait pas une mauvaise idée que de s’y essayer.
- Edge of Eternity est sorti le 8 juin 2021 sur PC en version finale (early access débuté le 5 décembre 2018).
- Le titre sort le 10 février 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S. Il sera en outre disponible dans le Xbox Game Pass.