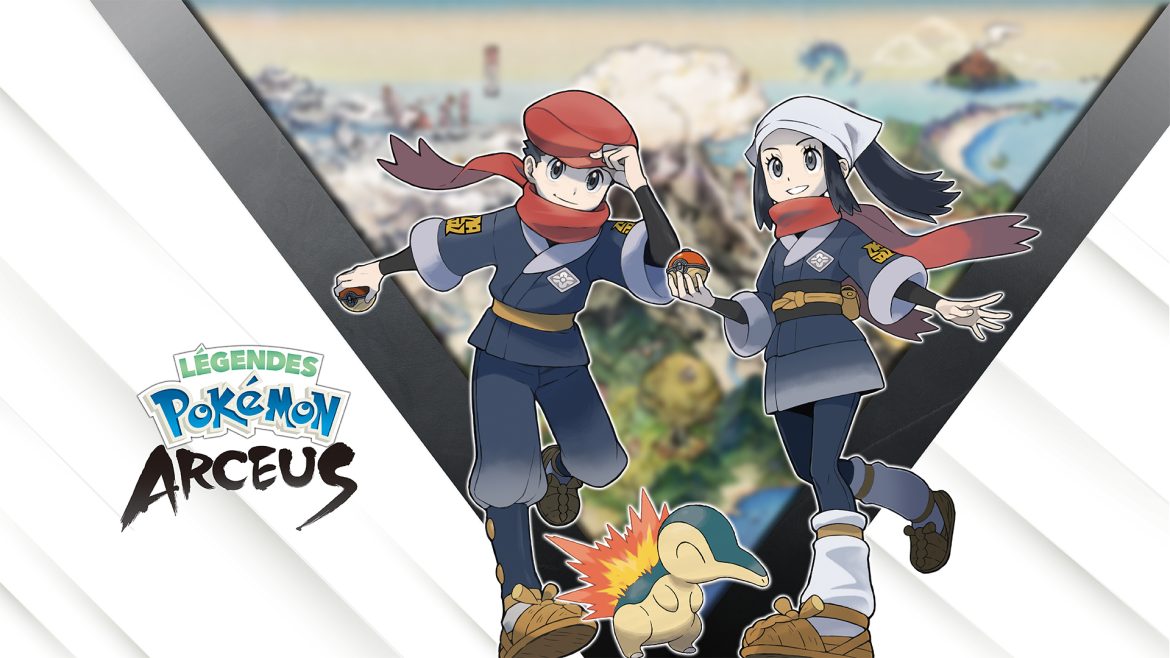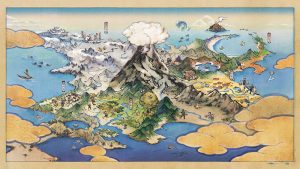C’est après presque 5 ans jour pour jour que la suite du très bon Horizon Zero Dawn, sort enfin sur les consoles de Sony. Horizon Forbidden West développé par Guerrilla Games et édité par Sony Interactive Entertainment, nous propose de continuer les aventures d’Aloy. Après une quête identitaire, pour comprendre ses origines, son statut de paria, le but de son existence et à côté de tout ça, empêcher la fin du monde suite à un soulèvement d’une IA, Aloy se trouve confrontée à une nouvelle menace que l’on croyait éteinte. Le jeu qui se déroule six mois après les événements du premier volume, emmène Aloy dans l’Ouest Américain, afin de comprendre d’où vient cette menace, et si elle est vraiment celle que l’on croit.
Cette critique a été écrite suite à l’envoi d’un exemplaire par l’éditeur. Le jeu a été parcouru sur PlayStation 5.
Un univers riche d’histoires

©2022 Guerrilla. « Horizon Forbidden West », « Guerrilla » are trademarks or registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Europe. All Rights Reserved.
L’une des plus grandes forces de la saga Horizon est son univers. Tout nous pousse à vouloir en découvrir plus, qu’il s’agisse des interrogations des personnages, ou des différents vestiges du passé que l’on peut explorer. Car oui, une fois n’est pas coutume dans le monde du jeu vidéo, en plus de l’histoire qui nous est contée, le lore de ce monde post-apocalyptique s’enrichit grâce aux différents collectables disséminés dans ce grand open-world. Cela va aussi bien d’un message audio enregistré avant l’effondrement, que des différentes boîtes noires, jusqu’aux reliques que le·la joueur·euse sera amené·e à découvrir lors de son périple. Tout un tas de textes, sur des moments de vies ou encore sur la société telle qu’elle était avant le « Zero Dawn » (événement qui mit presque fin à l’humanité). Autant le dire, j’espère que vous aimez la lecture, car vous serez servi·e ! Mais ce n’est pas tant en ça que l’univers d’Horizon apporte quelque chose de différent et de nouveau, c’est plus autour des machines et de la raison de leur existence que je trouve que l’univers brille. Il faut savoir que toutes les machines ont été créées dans le but d’aider à la terraformation, et proposer ainsi une nouvelle Terre, sur laquelle il ferait bon vivre. Évidemment, rien ne se passera comme prévu, et les machines développeront une indépendance complète, au point même d’attaquer les humains et autres êtres vivants. Cependant, Forbidden West nous prouvera à plusieurs reprises que les machines, peuvent aussi apporter une aide aux humains, notamment en les aidant pour de l’agriculture, sans pour autant les pirater.
Ce second opus nous ouvre aussi à trois nouveaux grands peuples, bien différents les uns des autres, et vivant en « paix » seulement parce qu’ils sont obligés de vivre de transactions entre eux afin de survivre. Ces peuples sont bien plus intéressants et mis en avant que lors du premier opus, cela apporte un plus non négligeable au développement de l’univers. Malgré la menace qui pèse sur eux, leur intérêt est avant tout la survie de leur village. Très clairement, la mission d’Aloy n’est pas leur priorité, et là où ça aurait pu passer pour un acte antipathique, l’écriture du jeu est suffisamment bien faite pour apporter des conclusions à chaque arc narratif de ces peuples et ainsi développer pour le·la joueur·euse une empathie et une appréciation des différents personnages qui nous sont présentés.
Une écriture de personnages plus intéressante

©2022 Guerrilla. « Horizon Forbidden West », « Guerrilla » are trademarks or registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Europe. All Rights Reserved.
Ce qui pour moi faisait défaut au premier Horizon, c’est l’écriture des personnages, aussi bien principaux que secondaires. En effet le traitement d’Aloy dans Zero Dawn était très basique, c’est une élue, elle doit accomplir ce pourquoi elle a été « créée » et derrière elle coche toutes les cases du monomythe, à savoir :
« Un héros s’aventure à quitter le monde du quotidien pour un territoire aux prodiges surnaturels : il y rencontre des forces fabuleuses et y remporte une victoire décisive. Le héros revient de cette mystérieuse aventure avec la faculté de conférer des pouvoirs à son prochain. »
Joseph Campbell
Ce qui n’est pas un mal en soit, beaucoup d’œuvres s’appuient sur ce mythe avec plus ou moins de succès. Le revers de l’utilisation de ce procédé d’écriture, c’est que le personnage en devient unidimensionnel. J’ai eu beau apprécier Aloy dans Horizon Zero Dawn, elle ne m’a pas laissé un souvenir impérissable. C’est en écrivant ces quelques lignes que j’en viens à penser que l’utilisation de ce procédé amène certes beaucoup de facilité lors de l’écriture, mais rend le personnage vraiment pauvre, et c’est là qu’interviennent généralement les suites. Car oui, l’évolution d’Aloy dans Horizon Forbidden West n’a eu de cesse de m’impressionner tout le long de l’aventure. On sent que le travail d’écriture du personnage a été bien plus poussé, et il y avait tout intérêt à le faire, notamment au vu des aventures et des rencontres qu’elle vit dans l’Ouest américain. Le premier bon point pour l’écriture est d’avoir mis de côté le fait qu’elle soit une élue, ici, elle va choisir de continuer à sauver le monde, ça ne sera plus une quête qui lui est imposée, mais un choix. Sa personnalité continue d’évoluer au point même d’avoir à faire des choix moraux, qui auront des conséquences, à long terme, aussi bien d’un point de vue à échelle humaine, que mondiale. On retrouve donc Aloy, un personnage que l’on a su apprécier avec une personnalité déjà forte, mais avec ce petit quelque chose en plus, qui la rend plus humaine, plus réelle.
Par ailleurs, ce n’est pas la seule à avoir subi une telle évolution, tous les personnages, qu’ils soient secondaires ou tertiaires ont énormément gagné dans l’écriture. Ils possèdent tous un but, une personnalité qui leur est propre, et s’éloignent totalement de l’univers très lissé du premier opus. C’est notamment lorsque l’on ressent un attachement fort vis-à-vis des personnages secondaires, que l’on en vient à être heureux pour eux, que je me rends compte que le travail d’écriture est un véritable succès. Je continuerai à me souvenir assez longtemps de ces personnages souhaitant découvrir une ville incroyable par le passé, ou encore le rêve de certains de comprendre ce message diffusé par ondes radio. Tous, en dehors des PNJ de services (vente et achat etc…) ont leur histoire, leur quête qui leur est propre. Alors oui, c’est le cas pour 90% des jeux, mais dans l’univers d’Horizon, il est clair qu’un gros travail sur l’écriture a été accompli.
Une réalisation qui n’a pas été oubliée

©2022 Guerrilla. « Horizon Forbidden West », « Guerrilla » are trademarks or registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Europe. All Rights Reserved.
Outre l’amélioration sur l’écriture des personnages et de son histoire, car il est vrai que je me suis essentiellement concentré sur les protagonistes mais l’histoire n’est pas en reste, c’est aussi dans sa réalisation que Guerrilla Games a su s’améliorer et proposer une mise en scène bien plus soignée. Là ou Horizon Zero Dawn proposait des plans, champ-contrechamp, lors des phases de dialogues, dans Forbidden West il n’est plus question de ce genre de plan de caméra. Au contraire celle-ci propose des points de vues bien plus intéressants et vivants. Entre le fait de tourner autour des personnages, de prendre des angles de vue plus travaillés, et le tout accompagné d’une animation et donc d’une gestuelle bien plus organique et humaine pour tous les personnages.
Les cinématiques sont quant à elles toujours aussi somptueuses et même plus encore. Toujours dans une optique d’amélioration de la saga, Guerrilla Games propose des séquences bien plus longues, et encore une fois bien plus travaillées dans leur réalisation. Toujours plus spectaculaires ou au contraire, bien plus intimistes quand il faut l’être.
C’est assez agréable de voir que beaucoup des critiques qui ont pu être faites sur le premier opus ont été corrigées avec cette suite, et notamment au sujet du game design et fatalement du gameplay. Beaucoup de nouvelles features ont été ajoutées à ce monde post-apocalyptique, ce qui permet de renouveler les phases de gameplay. Je pense notamment au grappin, qui apporte une amélioration à la verticalité du game design, la fameuse voile que l’on retrouve dans beaucoup de monde ouvert depuis un certain jeu, mais également des phases d’explorations sous-marines, ou encore d’autres surprises que je vous laisserai découvrir tant ces dernières sont vraiment chouettes et agréables à prendre en main !
Une suite et fin…?
Comme vous pouvez le comprendre avec cette critique, j’ai beaucoup aimé Horizon Forbidden West. Peut-être pas pour ce qu’il propose en tant que jeu, mais bien plus pour ce qu’il propose en tant qu’histoire et développement des personnages. Tout y est vraiment bien mieux maîtrisé que dans le premier opus.
J’irai même un peu plus loin en parlant de la chasse aux trophées, car oui je suis un fervent chasseur de ces petites récompenses numériques. Certes Forbidden West est composé de tout ce qui se fait de classique dans un open-world, entre les quêtes fedex, les contrats pour tuer des créatures bien spécifiques etc… Et également pour tout ce qui est de points d’intérêts et de collectables à récolter. Mais à une différence des autres open-world, il n’est pas nécessaire de toute récolter. Alors ok, il ne s’agit là que d’un point très mineur à soulever, mais il est toujours intéressant de voir qu’un développeur ne va pas pousser inutilement la durée de vie de son jeu, pour les plus complétistes d’entre nous.
Autre point assez triste pour cette saga, telle une malédiction qui se perpétue : les jeux sont souvent évincés par la sortie d’un autre. Ce fut le cas pour Zero Dawn, et c’est le cas avec Forbidden West. Alors toute proportion gardée évidemment, ça reste de très gros AAA, avec un public fidèle et dont les ventes sont très bonnes. Mais dans cette société qui passe rapidement à autre chose, je trouve ça dommage que les sorties de jeux tels que ceux-là, soient dans une telle compétition. Laissez-vous tenter par l’aventure qu’est Horizon Forbidden West, vous serez accompagné·e par des personnages vraiment attachants, une histoire agréable à suivre, et surtout, un cliffhanger ultra maîtrisé, qui me pousse à attendre fébrilement le troisième opus de cet univers post-apocalyptique rempli de grosses bébêtes mécaniques assez spéciales.
- Horizon Forbidden West est sorti le 18 février 2022 sur PS4 et PS5.