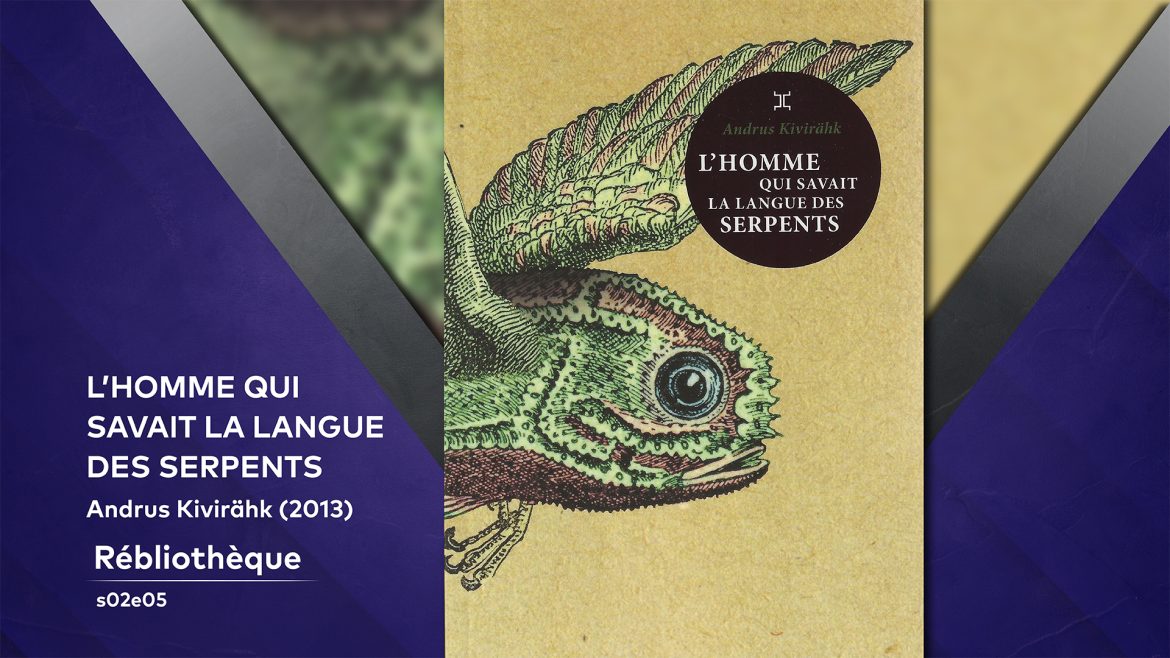Quand on parle des Tortues Ninja, le plus grand public pense souvent à l’enfance et au dessin animé, pourtant les tortues mutantes imaginées à la fin des années 80 sont un peu plus que cela. Au-delà des différentes itérations animées, c’est du côté des comics, leur medium d’origine, que quelques-unes des meilleures histoires des tortues ont été créées, grâce à ses cocréateurs Kevin Eastman et Peter Laird. Et on peut d’ailleurs en France en profiter dans les meilleures conditions grâce à l’excellent travail d’édition de Hi Comics sur la licence depuis quelques années. Mais on n’est pas là pour parler de la série principale, au contraire : ce qui nous occupe, c’est The Last Ronin, un projet né dans l’esprit de Eastman et Laird à la fin des années 80, qui n’a finalement pu voir le jour que l’année dernière, marquant d’ailleurs le retour de Laird sur la licence après plusieurs années d’absence. Allez, une fois admirée la superbe couverture de Santolouco et lu la sympathique préface du cinéaste Robert Rodriguez, on attaque la lecture de l’histoire et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’on ne s’attendait pas à cela.
Cette critique a été écrite suite à l’envoi d’un exemplaire par l’éditeur.
Le dernier survivant
Dans un futur plus ou moins proche, le monde tel qu’on le connaît a été pratiquement détruit. Par les hommes face à une terre qui se rebelle, comme en atteste l’une des premières planches qui suggère fortement les impacts du réchauffement climatique. Le centre-ville est en effet entouré d’une muraille gigantesque pour empêcher l’eau de la submerger. New York n’est plus ce qu’elle était, pas plus que son quotidien désormais rythmé par les décisions d’un tyran, Oroku Hiroto, petit-fils de Shredder. Oui, The Last Ronin imagine le futur, une sorte de conclusion avant l’heure à la longue histoire (qui continue encore) des Tortues Ninja. Et c’est une conclusion amère, faite de souffrance, où seule une tortue a survécu, tandis que les autres ont péri face à leur ennemi de toujours. Celles-ci n’apparaissent que comme des fantômes dans le dos de la tortue survivante, l’épaulant parfois pour la guider, mais lui reprochant aussi d’autres fois leur propre mort. C’est un récit sombre, qui évacue la nostalgie de l’œuvre pour montrer plutôt une facette rédemptrice, où la tortue ninja survivante (qui n’est pas immédiatement nommée, le récit gardant le suspense autour du survivant) cherche la vengeance autant pour l’honneur de ses frères et de Splinter, que pour trouver la paix. Parce que ce récit aborde le douloureux syndrome de culpabilité du survivant, qui doit trouver le moyen d’aller de l’avant sans se laisser tétaniser par les peurs, les regrets et la honte irrationnelle d’être le seul rescapé. Pour trouver vengeance, la tortue décide de s’infiltrer dans le quartier où se trouve une immense tour au dernier étage de laquelle trône Oroku Hiroto, dont le vice et la tyrannie ferait passer Shredder pour un gars sympa. Une mission suicide qui doit autant lui permettre de trouver la paix que de tirer un trait sur le passé.
L’histoire se raconte sur plusieurs époques, de manière non-linéaire, selon les souvenirs et récits des un·es et des autres. Il y a le présent, avec la quête de vengeance de la tortue, mais aussi un évènement décisif du passé où le clan Foot, celui de Shredder, a proposé la paix aux Tortues Ninja et à Splinter pour mettre un terme à des siècles d’affrontement. Et puis il y a la mort des tortues, et le destin des différents personnages habituels de la licence comme April et Casey Jones. Comme un hommage à l’univers des Tortues Ninja, The Last Ronin a pour lui un récit terriblement bien écrit chaque fois qu’il évoque le passé, les rivalités et affrontements clés contre le clan Foot et Shredder ou encore l’importance de Splinter et d’April. C’est un véritable cadeau fait aux fans de la licence, et c’est en plus très référencé par plusieurs décennies d’histoires des tortues, avec même un arrière-goût de Frank Miller tant pour son The Dark Knight Returns (avec son héros vieillissant, en perte de souffle et de repères, qui doit livrer une dernière bataille) que son Ronin. Malheureusement, et parce que rien n’est parfait, le récit perd un peu de sa superbe dans son dernier tiers, avec une écriture moins pertinente et une patte visuelle plus consensuelle quand on tombe dans la confrontation, le combat et le siège de la tour de Oroku Hiroto.
L’avenir comme hommage au passé
Difficile tout de même de lui en tenir pleinement rigueur tant l’ensemble tient très bien debout. Visuellement d’abord, avec de belles réussites. d’ambiance et quelques bonbons offerts avec une poignée de planches de Peter Laird chaque fois que la narration aborde le passé, comme pour marquer un retour aux sources. Le mélange des genres, avec deux styles graphiques différents selon l’époque racontée, marque bien la rencontre entre la « nouvelle » génération qui travaille sur les Tortues Ninja, incarnée par Tom Waltz, et « l’ancienne » génération incarnée par les créateurs de la licence, Kevin Eastman et Peter Laird. D’autant plus que l’on retrouve l’esprit visuel un peu punk des origines, avec une représentation de ce New York futuriste à la manière d’un futur punk que l’on imaginait dans beaucoup d’œuvres des années 1980. Ce côté un peu « old-school » s’accompagne toutefois aussi d’une narration qui va directement à l’essentiel, sans fioritures, à la manière dont on écrivait les comics à l’époque. Mais c’est peut-être aussi ce que l’on vient chercher dans cette imaginaire d’une conclusion qui renvoie aux origines.
The Last Ronin souffre peut-être d’un manque de spontanéité et de surprises, avec un récit cousu de fil blanc qui se déroule face à nous avec moins de subtilité qu’il n’y paraît. Mais est-ce bien un mal ? Le comics raconte exactement ce qu’il faut et met les bons mots sur l’amour que se portent les tortues depuis toujours, un amour fraternel qui s’est souvent vu opposé à la violence d’un monde qu’ils doivent sauver tout en se cachant. Tantôt génial, tantôt émouvant, on lui pardonne son petit coup de mou dans le dernier tiers et on se laisse prendre au jeu d’un hommage qui révèle un amour profond pour un univers qui a accompagné, et continuer d’accompagner beaucoup de monde.
- The Last Ronin est disponible en librairie aux éditions Hi Comics depuis le 16 novembre 2022