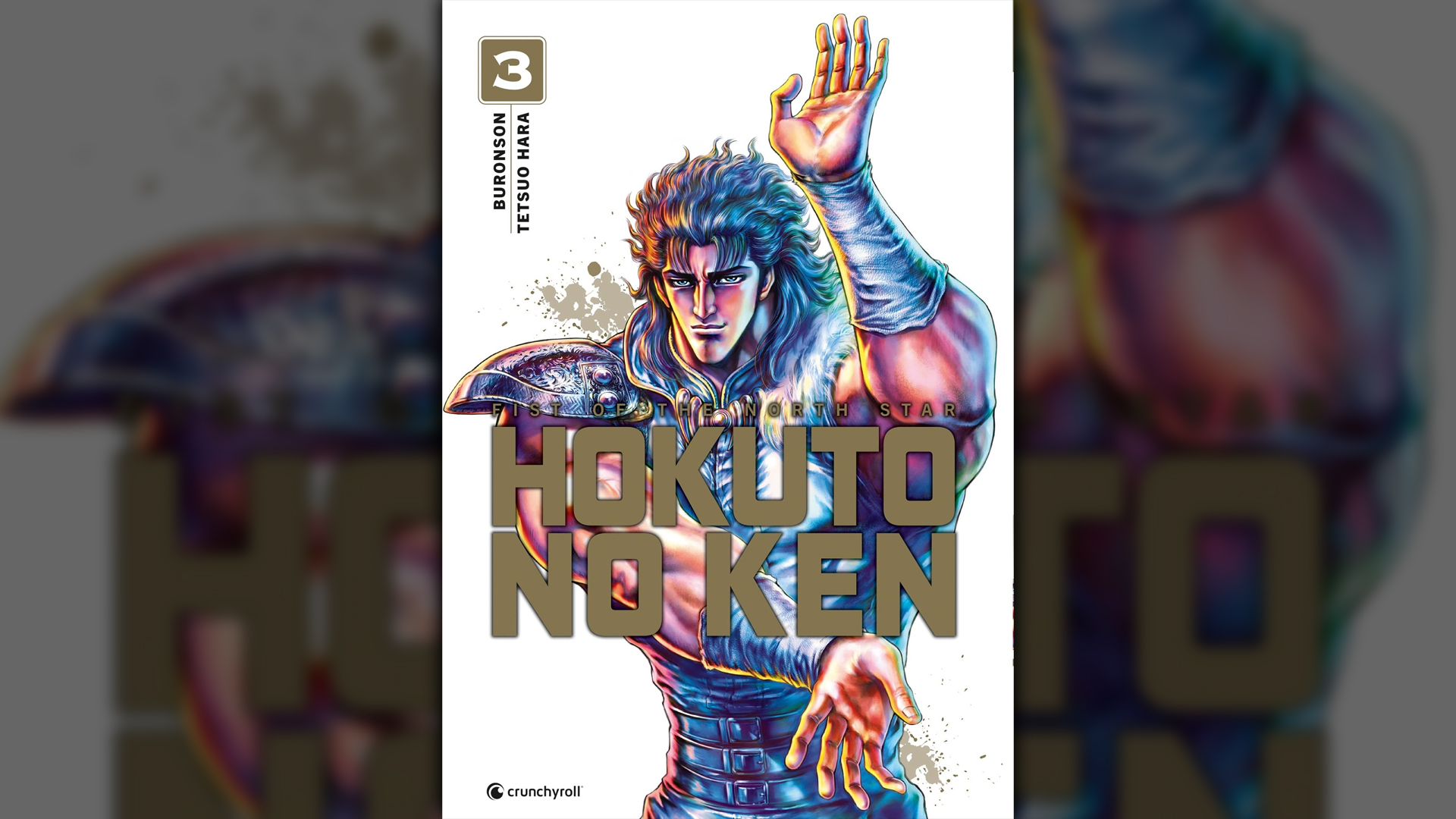Au vu de certaines de mes chroniques, il est palpable que je suis passionnée de musicals. Depuis quelques années, on préfère le terme de musicals à celui de comédies musicales. En effet, bien que le mot « comédie » soit à comprendre au sens large du terme, les musicals peuvent être des plus tragiques. La comédie musicale est une expression que j’utilise encore moi-même, mais qu’il faut pourtant employer avec précaution, car ce genre est supposé obéir à des règles strictes. Un musical mêle la comédie au chant et à la danse, mais de manière cohérente. Les chansons doivent être liées par une continuité dramatique, et destinées à faire avancer l’action ou la psychologie des personnages. C’est pourquoi, à mon sens et à titre d’exemple, A star is born est un film musical, mais pas une comédie musicale. Il y a de la musique car les personnages sont des chanteurs, mais pas parce qu’ils décident de ranger leur chambre ou de boire un médicament, en chantant. Pour mon plus grand malheur, la majorité du public français n’a jamais vraiment adhéré aux comédies musicales. La plupart des gens s’imaginent que l’intrigue n’avance plus lorsqu’il y a une chanson et sortent du film, au point d’en être ennuyés. Ce préjugé est complètement faux mais est expliqué par la construction du spectacle musical francophone, qui s’avère très différente. Mais nous y reviendrons plus tard. Maintenant que nous avons reposé les bases, retournons dans le temps afin d’expliquer les origines et l’évolution des musicals. L’objectif final de cet article étant, bien entendu, de vous faire part des comédies musicales les plus incontournables et marquantes, à mes yeux.
De la scène aux salles obscures
Aussi étonnant que cela puisse sembler, la comédie musicale est un genre assez récent. En allant loin, au peut lui trouver des origines au XVIIIe siècle, en Italie. Jusqu’au XIXe siècle, en France, on se contente tout juste de parler « d’opérette légères ». Certains considèrent que le premier musical date de 1866. Il s’agirait de Black Crook, de C. M. Barras, une œuvre inspirée de plusieurs classiques, à commencer par Faust de Goethe. Mais la comédie musicale commence réellement à émerger dans les années 1930, grâce au cinéma, et plus particulièrement au cinéma parlant. En effet, celui-ci força les créateurs et créatrices à développer plus de cohérence, entre leurs tableaux.
Bien que la comédie musicale soit plutôt un genre théâtral, il doit beaucoup au cinéma. Aux États-Unis surtout, de nombreux musicals marquent les années 40 et 50, quand bien même les règles du genre ne sont pas encore délimitées. On peut mentionner Carmen Jones (1943), inspiré de l’opéra Carmen, Chantons sous la pluie (1952), My Fair Lady (1956) ou encore La Mélodie du Bonheur (1959). C’est en 1957 qu’un musical fige les codes du genre. Inspiré de Roméo et Juliette de William Shakespeare, West Side Story rencontre un succès retentissant, au point d’être considéré (aujourd’hui encore), comme un chef-d’œuvre. La comédie musicale a d’ailleurs été remise au goût du jour par un remake signé Stephen Spielberg, en 2021. De fait, les années 60 verront naître d’autres classiques, comme Hello Dolly (1964) ou Man of the Mancha (1965). Ce musical revisitant les aventures de Don Quichotte sera d’ailleurs popularisé en français, par Jacques Brel. (Retrouvez la chronique de L’homme de la Mancha, sur Pod’Culture).
Entre Broadway et West End of London
Le genre rencontre un tournant à la fin des années 60 et dans les années 70, avec la révolution hippie. Certaines comédies musicales, comme Hair (1967) se veulent plus subversives. Par-dessus tout, de nombreuses salles de spectacles commencent à accueillir des musicals, dans le même quartier de New York… Vous l’aurez compris, Broadway se développe. Je pourrais mentionner d’autres musicals, comme Rocky Horror Show (1973), Grease (1978) ou Sweeney Todd (1979) mais nous allons nous intéresser à un homme qui a révolutionné le genre. Il s’agit d’Andrew Lloyd Webber.
Andrew Lloyd Webber rencontre un succès retentissant avec un musical particulièrement provocateur baptisé Jésus-Christ Superstar, en 1971. Alors que les comédies musicales ne se renouvellent plus, aux États-Unis ; le West End of London voit naître de nombreux chef-d’œuvres de Webber, comme Evita (1978), Cats (1981) et bien sûr The Phantom of the Opera (1986), l’une des comédies musicales les plus représentées au monde. Pour vous donner une idée, Le Fantôme de l’Opéra est, aujourd’hui encore, joué presque quotidiennement à Londres, et continue à faire des salles combles. L’autre grand succès de la comédie musicale, tout autant joué depuis 1985, voit le jour grâce aux français. C’est toutefois l’adaptation londonienne qui popularise le spectacle. Je parle cette fois-ci des Misérables, adapté du roman de Victor Hugo. Avec ces deux monstres de la comédie musicale, on peut sans problème parler d’âge d’or des musicals, dans les années 80. De nombreuses comédies musicales sortent au cinéma ou au théâtre, depuis. On peut mentionner les long-métrages Disney, le film Moulin Rouge (2001) ou le musical le plus récompensé, Les Producteurs, sorti la même année. Mais d’un point de vue historique, le Fantôme de l’opéra et Jean Valjean ont de bonnes chances de demeurer sur leur trône.
La vision francophone du genre
J’ai beaucoup parlé des États-Unis et de l’Angleterre, où la comédie musicale a trouvé ses origines et ses lettres de noblesse. Le genre est populaire dans beaucoup d’autres pays du monde, comme en Inde ou en Corée, mais moins dans les pays francophones. Il y a pourtant un développement à part entière et quelques beaux succès. Je pense essentiellement à Starmania (1979) et Notre-Dame de Paris (1998). Leur conception est différente d’une comédie musicale traditionnelle. Les anglophones élaborent une réelle continuité dramatique entre les chansons. Les spectacles sont représentés sur scène avant qu’on envisage de sortir un album. Les budgets peuvent être colossaux et les salles sont tellement aménagées pour la mise en scène qu’une comédie musicale anglophone est supposée demeurer longtemps à l’affiche du même théâtre. Les pays francophones n’ont pas la même démarche. On imagine d’abord un album, dont les tubes vont être liés avec moins de continuité dramatique. Le spectacle musical est ensuite représenté sur scène, à travers divers tableaux. Pour finir, on accorde plus de place au chant, mais moins à la danse. Si Starmania et Notre-Dame de Paris sont de très belles œuvres, elles ont montré le chemin à toute une flopée de spectacles musicaux français qui n’ont, malheureusement, ni queue ni tête et qui contribuent à faner la popularité du genre, chez nous. Heureusement, plusieurs comédies musicales anglophones sont adaptées en français, au théâtre Mogador de Paris, notamment.
Maintenant que nous en savons plus sur le genre des musicals, laissez-moi vous initier à dix œuvres à (re)découvrir, d’après moi.
Jésus-Christ Superstar (1970)

Confrontation entre un Judas et un Jésus modernes © Jésus-Christ Superstar, Live à l’Arena Tour, 2012
Jésus-Christ Superstar est un opéra-rock composé par Andrew Lloyd Webber en 1970. Il s’agit ni plus ni moins d’une réécriture moderne et relativement provocatrice d’un passage de la Bible. L’histoire se concentre sur la popularité montante du Christ, qui sera sacrifié, notamment à cause de la trahison de l’un de ses proches, Judas, ou de l’amoralité de Pilate. Dit comme ça, le musical ne donne pas forcément envie, et pourtant les personnages sont touchants, les chansons entraînantes, et le contraste entre l’époque moderne et la fondation du christianisme fonctionne très bien. Bien sûr, tout dépend de la version du musical que l’on regarde. Les premières versions appartiennent plus au mouvement hippie qu’au rock. Les personnages nécessitant des voix bien particulières, certains castings sont ridicules. Je conseille, sans l’ombre d’une hésitation, le Live à l’Arena Tour de 2012. Tim Minchin y est assez incroyable dans le rôle de Judas. Sa prestation de Superstar est particulièrement satirique vis-à-vis de la religion, mise en parallèle avec le monde du show-business. Mention honorable pour Alexander Hanson, incarnant un Ponce Pilate terriblement doucereux et manipulateur, comme en témoigne sa version de Pilate’s Dream.
Starmania (1979)
Starmania est aussi un opéra-rock, mais francophone. Le spectacle musical naît en 1979 grâce à la plume de Luc Plamondon et aux compositions de Michel Berger. Starmania, c’est tout d’abord un album contenant des tubes légendaires, comme SOS d’un Terrien en Détresse ou le Blues du Businessman. Ces chansons sont tellement connues que leur dramaturgie échappe à la plupart des gens. Starmania est une dystopie critiquant le monde du show-business et la recherche insatiable de la gloire. Une présentatrice vedette nommée Cristal est kidnappée par un groupe terroriste d’extrême gauche, les Étoiles Noires. Contre toute attente, elle va se joindre à leur cause afin de tenir tête à Zéro Janvier, un politicien fasciste n’ayant rien à envier à Big Brother. Je ne peux que conseiller l’écoute de l’album original, si vous souhaitez entendre de belles voix, à commencer par celle de Balavoine. Si vous désirez voir le spectacle, il existe une version filmée de 1989, qui a vieilli, certes, mais où les frères Groulx proposent des prestations mémorables, dans les rôles de Johnny Rockfort et Zéro Janvier. Enfin, Starmania va être en tournée dans toute la France, en 2023. (Retrouvez la critique de Starmania (2022) sur Pod’Culture).
Les Misérables (1980)
Les Misérables est l’un des musicals les plus populaires au monde. Le spectacle naît en France, en 1980, grâce à Claude-Michel Schönberg, Alain Boublil et Jean-Marc Natel. Il ne devient légendaire que cinq ans plus tard, via son adaptation anglophone. Comme dans Jésus-Christ Superstar ou Starmania, d’ailleurs, les chansons ne sont pas entrecoupées de dialogues. Il s’agit tout simplement d’une adaptation du roman mythique de Victor Hugo. Au XIXe siècle, un ancien forçat du nom de Jean Valjean essaie de se racheter, en veillant sur une fillette nommée Cosette, et en tentant d’échapper à la cruauté de l’inspecteur Javert. Il est impossible de résumer l’intrigue des Misérables car les destins de nombreux personnages s’entrecroisent, à travers plusieurs générations, afin de dépeindre les mœurs et les crises de la France du XIXe siècle. On peut notamment évoquer la malheureuse Fantine ou les effroyables Thénardier. C’est une œuvre profondément humaniste et bouleversante. Si vous n’avez ni l’énergie ni le temps de lire le pavé de Victor Hugo, je ne peux que conseiller ce musical qui en synthétise l’essence et l’émotion, en lui rendant honneur. Il existe une adaptation cinématographique du musical, avec Hugh Jackman dans le rôle de Jean Valjean, mais je suggère plutôt le visionnage du Live du 10e anniversaire, sorti en 1995. Il s’agit d’un concert, aussi n’y a-t-il que peu d’éléments de mise en scène, mais Colm Wilkinson et Philip Quast incarnent parfaitement Jean Valjean et Javert. Leur version de The Confrontation est vraiment intense, et si vous souhaitez un aperçu de tout le casting, il y a toujours One Day More.
Nine (1982)
J’ai hésité à conseiller Nine, qui n’est objectivement pas l’une des meilleures comédies musicales. D’autres auraient pu la remplacer dans ce classement, comme Sweeney Tood, Moulin Rouge ou même éventuellement Le Petit Prince. Mais j’ai une affection étrange et très personnelle pour ce musical, que je ne connais qu’à travers le film réalisé par Rob Marshall en 2009.
Le long-métrage n’est pas exempt de défauts, Daniel-Day Lewis n’est pas crédible en dandy italien, et la mise en scène est un enchaînement de clips mettant en scène des comédiennes glorifiées sous un regard décidément bien masculin. Et pourtant… Pourtant… Nine est une réécriture du film Otto e Mezzo, de Federico Fellini. Il rend non seulement hommage au cinéaste italien, mais aussi à Marcello Mastroianni, à travers le personnage principal, et Sophia Loren, puisqu’elle interprète la mère de celui-ci. Autant dire que Nine touche la corde sensible et me rend nostalgique. Et puis, mine de rien, les chansons sont marquantes, à commencer par Be Italian, ici interprétée par Fergie.
The Phantom of the Opera (1986) & Love Never Dies (2010)
The Phantom of the Opera est, au même titre que Les Misérables, un mastodonte de la comédie musicale. Le musical naît en 1986 grâce au génie d’Andrew Lloyd Webber. Il s’agit d’une adaptation du roman de Gaston Leroux, dans lequel un être mystérieux commence à hanter l’opéra Garnier, avant de tomber sous le charme d’une cantatrice nommée Christine. Le long-métrage de 2004, réalisé par Joel Schumacher, donne un bon aperçu de la mise en scène gothique du musical. Si toutes les chansons du livret ne sont pas marquantes, The Phantom of the Opera est un son ni plus ni moins mythique et inoubliable. Le Fantôme de l’Opéra est un être atteint de folie et auto-destructeur. Il est aussi énigmatique et mélancolique. Mon interprète favori du Fantôme est certainement Ben Lewis, qui a d’ailleurs aussi été la tête d’affiche de Lover Never Dies, suite du musical. L’histoire se passe des années après et certains éléments semblent sortir du chapeau, mais la narration, les chansons et la mise en scène sont tellement beaux qu’on le pardonne aisément. La version filmée de Love Never Dies, datant de 2012, est incontournable, d’autant que Ben Lewis et Anna O’Byrne incarnent un Fantôme et une Christine liés par une alchimie inégalée à ce jour. Vous pouvez le constater par vous-même avec Beneath a Moonless Sky. Si vous préférez le rock, ou l’univers des freaks show, je suggère The Beauty Underneath.
Le Roi Lion (1997) & Autres classiques Disney
Et oui, la plupart des classiques Disney sont des comédies musicales. Le Roi Lion, sorti en 1994, est l’un de mes films préférés de tous les temps. Il est donc bien naturel que j’évoque la comédie musicale inspirée du long-métrage, et datant de 1997. Le musical apporte une vraie plus-value au film, car l’histoire et les personnages sont développés. On y trouve une chanson du Roi Lion 2, mais aussi des chansons inédites. De plus, les costumes donnant vie aux animaux, sans effacer les comédiens et comédiennes, sont révolutionnaires. Il s’agit d’un musical destiné à toute la famille. Il est certainement moins déprimant que tout ce que j’ai pu citer, auparavant. Certains passages sont même humoristiques. Cela n’empêche pas l’histoire de se révéler aussi émouvante que dans le long-métrage. Je sais ce que vous allez dire, j’ai un sérieux problème avec les personnages de méchants, mais Scar est assez incroyable dans ce musical, notamment grâce à l’étoffement de Soyez Prêtes ou l’intégration de La Folie du Roi Scar. J’ai aussi beaucoup d’affection pour Nala, chantant notamment Terre d’Ombre. Si je devais mentionner d’autres comédies musicales signées Disney, Mary Poppins (1964), L’étrange Noël de Monsieur Jack (1993) et Le Bossu de Notre-Dame (1996) me semblent assez incontournables. (Retrouvez la chronique du Roi Lion, sur Pod’Culture).
Notre-Dame de Paris (1998)
Diantre, il faut tout de même bien citer quelques spectacles musicaux francophones. Comme Starmania, Notre-Dame de Paris de Richard Cocciante et Luc Plamondon, est plus une succession de tableaux qu’une comédie musicale au sens propre du terme. Au reste, on ne présente plus les chansons qui commettent l’exploit de résumer, comme Les Misérables, l’essence et l’émotion d’un pavé de Victor Hugo. Contrairement aux Miz, Notre-Dame de Paris est une œuvre romantique où les personnages se font broyer par leurs sentiments ainsi que par la fatalité. Le titre le plus connu du spectacle est certainement Belle, mettant en exergue les sentiments qu’éprouvent le bossu Quasimodo, le prêtre Frollo et le soldat Phoebus, pour une bohémienne nommée Esmeralda. Le premier est habité par de nobles sentiments mais il est monstrueux aux yeux du peuple médiéval. La gitane se laisse plutôt séduire par le soldat, agréable à regarder, mais pourtant infidèle. Au milieu de cette tragédie, il y a Frollo qui, loin d’être le méchant caricatural de Disney, est le protagoniste du roman. Il s’agit d’un prêtre qui perd la raison et devient monstrueux, à force d’être tiraillé entre son amour et sa foi. Oui, Notre-Dame de Paris est, entre autres choses, une dénonciation du dogme religieux. Si je ne suis pas forcément fan du casting original, la prestation de Daniel Lavoie est très proche du Frollo du livre, comme en témoignent Tu vas me détruire ou Être prête et aimer une femme. Et pour cela, je l’aimerai toujours.
Mamma Mia (1999)
Comme on a le droit d’avoir des plaisirs coupables, ou de rire, tout simplement, je confesse que j’adore Mamma Mia. Il s’agit d’un musical particulier dans la mesure où, en 1999, l’histoire a été écrite à partir des tubes du groupe ABBA. L’exercice n’est, mine de rien, pas si aisé, et bien qu’il s’agisse d’une intrigue typique de comédie, pleine de quiproquos, on se laisse aisément entraîner par l’histoire et la dramaturgie nouvelle des chansons.
J’ai de l’affection pour le film de 2008, réalisé par Phyllida Llyod et avec Meryl Streep, dans le rôle titre. Comme si être une actrice de génie ne lui suffisait pas, la comédienne se révèle également être une chanteuse talentueuse, comme le démontre Money Money Money. Le reste du casting est aussi alléchant, puisque ses prétendants sont incarnés par Pierce Brosnan, Colin Firth et Stellan Skarsgård, lesquels poussent la chansonnette à l’unisson dans Our Last Summer.
Les Producteurs (2001)
Les Producteurs est un musical de 2001, inspiré d’un film de Mel Brooks, datant des années 60. Il s’agit d’une satire de Broadway, dans laquelle Max et Leo décident de produire le pire musical jamais créé, afin de gagner de l’argent, grâce à une faille dans le système. Les personnages sont tous plus hauts en couleurs les uns que les autres et l’humour très irrévérencieux voire provocateur. En dépit d’un début un peu longuet et théâtral, je conseille vivement le film de 2005. Il s’avère prenant et terriblement drôle. De plus, on retrouve dans les rôles titres, les acteurs originaux de Max et Leo : Nathan Lane et Matthew Broderick. J’ai beaucoup d’affection pour Max qui, bien qu’il semble véreux et manipulateur, désespère simplement de trouver un réel ami, voire un frère, dans le milieu où il évolue. Bien qu’elle ait été coupée de la version cinématographique, la chanson The King of Broadway est certainement ma favorite. Notons que Les Producteurs ont, pour la première fois, été traduits et interprétés, en France, il y a très peu de temps. La pièce a d’ailleurs remporté pas moins de deux Molières, en 2022. (Retrouvez la critique des Producteurs, sur Pod’Culture).
The Greatest Showman (2018)
Et non, je n’aurai pas seulement parlé de vieux coucous. The Greatest Showman est une comédie musicale réalisée par Michael Gracey et sortie, exclusivement au cinéma, en 2018. Force est de constater que j’avais pris une claque, dans les salles obscures, tant les chansons et la mise en scène sont prenantes.
Il s’agit d’un biopic assez libre et édulcoré de Phineas Taylor Barnum, alors incarné par Hugh Jackman. Celui-ci décide de fonder un spectacle de freaks, afin de rencontrer le succès. Malgré cette thématique délicate, il s’agit d’un feel-good movie, transmettant des valeurs sur l’acceptation de soi ou de la différence. Une mention honorable pour la chanson d’introduction : The Greatest Show.
Maintenant que vous savez tout – ou presque – sur les musicals, il ne vous reste plus qu’à vous laisser entraîner par toutes ces chansons pourvues d’une dramaturgie précise, et souvent illustrées par des mises en scènes ingénieuses. The show must go on.