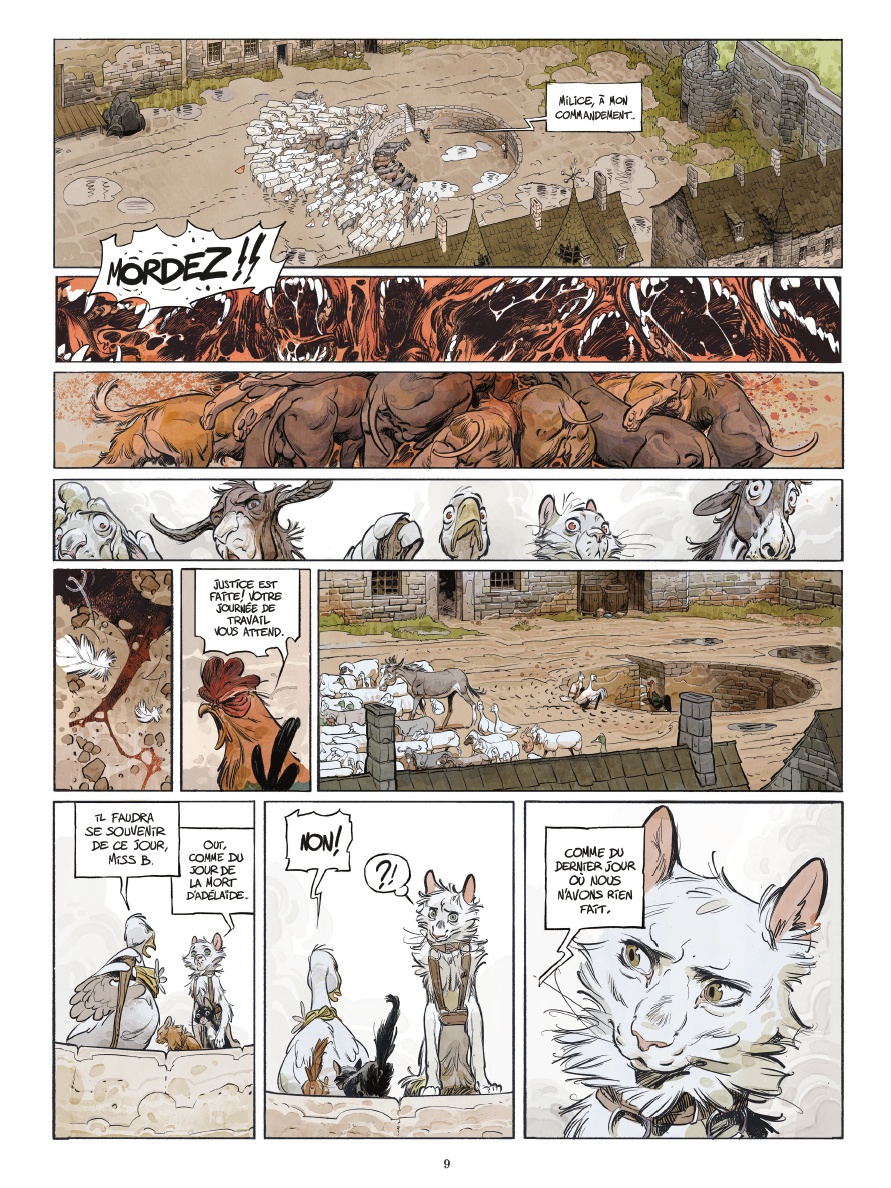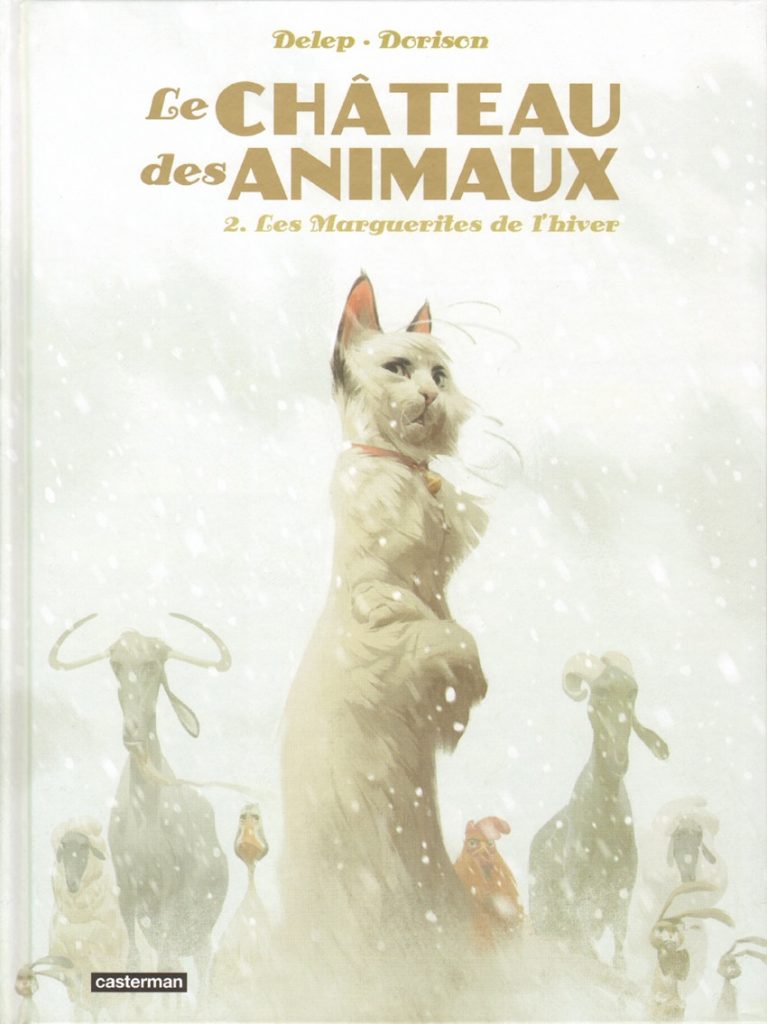Satoru Iwata… Même si vous n’êtes pas familier avec l’univers de Nintendo, vous avez forcément entendu ce nom au moins une fois. Il est une figure emblématique du paysage vidéoludique. C’est en proposant tellement de nouveautés, et en révolutionnant l’esprit Nintendo, grâce notamment au fait qu’il soit un véritable amoureux et passionné du média, qu’il en est devenu le 4e président de la firme nippone pendant 13 ans (de 2002 à son décès en 2015).
Mais avant ça, Satoru Iwata a commencé en tant que programmeur dès son plus jeune âge, en codant des jeux sur des calculatrices. Puis, de fil en aiguille, il est entré dans le monde du jeu vidéo avec la société HAL Laboratory (Pinball [1984], Kirby’s Dream Land [1992], Super Smash Bros [1999] …) et enfin il a intégré Nintendo comme mentionné juste au dessus.
Outre cette succès story, il y a une part de l’homme que l’on connaît moins. Qui est-il réellement ? Comment travaille-t-il ? Et surtout, quelle est sa vision du monde ? C’est ce que propose, au travers de plusieurs interviews croisées, « Ainsi parlait Iwata-San », édité par Mana Book en France.
Cette critique a été rédigée grâce à un exemplaire envoyé par l’éditeur.
Ainsi parlait Iwata-San
Si vous me connaissez un minimum, vous n’êtes pas sans savoir que je suis un très grand fan de Nintendo. Je suis de ces enfants qui ont grandi avec la firme de Kyoto, et depuis, je continue à suivre tout ce qu’ils peuvent proposer comme contenu vidéoludique.
La lecture d’un tel recueil de plusieurs interviews de l’homme à la tête de Nintendo pendant 13 années a été pour moi d’une évidence même. Pour ne rien vous cacher, je ne m’attendais pas à un tel plaisir. Il faut savoir que j’avais déjà beaucoup d’admiration pour Iwata, pour ce qu’il a apporté à Nintendo et donc de surcroit, à nous les joueurs. Mais jamais je n’aurais imaginé un tel homme, un tel manager. Une grande partie de ce recueil repose sur la façon dont Iwata voyait le jeu vidéo, et qui plus est, dont il avait de manageait ses différentes équipes. Toujours rempli de bienveillance, il tenait avant tout à comprendre les gens, et pourquoi telle ou telle chose n’était pas possible lors de la réalisation d’un jeu.
D’ailleurs un fait assez rare pour le signaler, Iwata a été célébré en tant que chef d’entreprise. Il faut dire que sa façon de faire change drastiquement des chefs d’entreprises « lambda ». Au fil des années les témoignages de ses collaborateurs on vanté un chef d’entreprise toujours à l’écoute de ses employés. Lors de sa présidence, il tenait à voir chaque employé au moins deux fois par an, pour établir une sorte de bilan, les écouter et ainsi comprendre les attentes de chacun, et apporter des améliorations dans la mesure du possible évidemment.
Au travers de différentes interviews, on apprend à découvrir quel homme passionné il était. Par ailleurs le choix de ces extraits sont parfaitement mis en place, et se répondent de la plus belle des manières. Alors certes je ne m’attendais pas à ce que ce recueil soit autant porté sur le management, mais plus sur lwata en général. Mais force est de constater qu’il était cet homme. Prêt à tout pour rendre possible un projet. Quitte à recommencer ce projet de zéro, l’exemple le plus parlant étant avec le jeu Mother 2.
Le calme après la tempête
Le jeu Mother 2 subissait un retard terrible, car le gameplay, l’histoire et tout un tas d’autres paramètres empêchaient le bon déroulement du développement. Quand Iwata est arrivé à la rescousse du projet, et voyant les problèmes de production du titre, il a proposé deux solutions ; continuer dans cette voie et mettre alors deux ans supplémentaires pour tirer partie au mieux de ce qui existe déjà, ou tout reprendre à zéro et finir en six mois.
Évidemment, c’est la seconde solution qui a été choisie, et pour autant, mettre à la poubelle une bonne partie des choses qui existaient déjà est loin d’être évident. Alors dans les faits, ils ont mis une année pour finir le projet, mais cette envie de finir en un semestre était réalisable, tout en sachant que tous les assets (sprites, musiques et autres) existaient déjà.
Je parlais en introduction de la façon dont Iwata a révolutionné l’histoire de Nintendo. Car en plus d’être une personne d’une bienveillance incroyable, il était aussi visionnaire dans la façon de consommer des jeux vidéo. C’est grâce à lui que l’on a eu ce début d’ouverture d’esprit du grand public envers le média vidéoludique, avec la création de consoles mythiques.
C’est donc grâce à la Nintendo DS, et la Nintendo Wii, dont il a été le concepteur principal, qu’il a su élargir le marché des consommateurs. Je suis certain que vous avez tous des souvenirs de jeux avec vos parents, vos grands-parents, sur ces jeux dont seul Nintendo à le secret. Ces jeux qui fédèrent la famille autour d’un écran, pour un amusement réel et concret. Je pense notamment à Wii Sports, ou encore Programme d’entraînement cérébral du Dr Kawashima : Quel âge a votre cerveau ? Ces jeux qui ont su amener les plus anciens à s’intéresser aux jeux vidéo.
Une passion, une quête…
Satoru Iwata était un homme que j’admirais profondément. Maintenant, avec ces connaissances supplémentaires, je dois bien vous l’avouer, il est devenu un « objectif » à atteindre pour moi. Tant il est inspirant, touchant et surtout un passionné qui souhaite partager sa passion avant tout.
Monsieur Iwata, merci pour tout.
On my business card, I am a corporate president. In my mind, I am a game developer. But in my heart, I am a gamer.
Sur ma carte de visite, je suis un président d’entreprise. Dans ma tête, je suis un développeur de jeux vidéo. Mais dans mon cœur, je suis un joueur.
- Ainsi parlait Iwata-San est paru ce 1er avril 2021 aux éditions Mana Books.