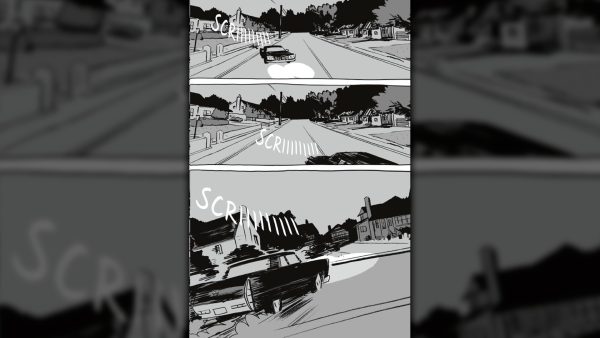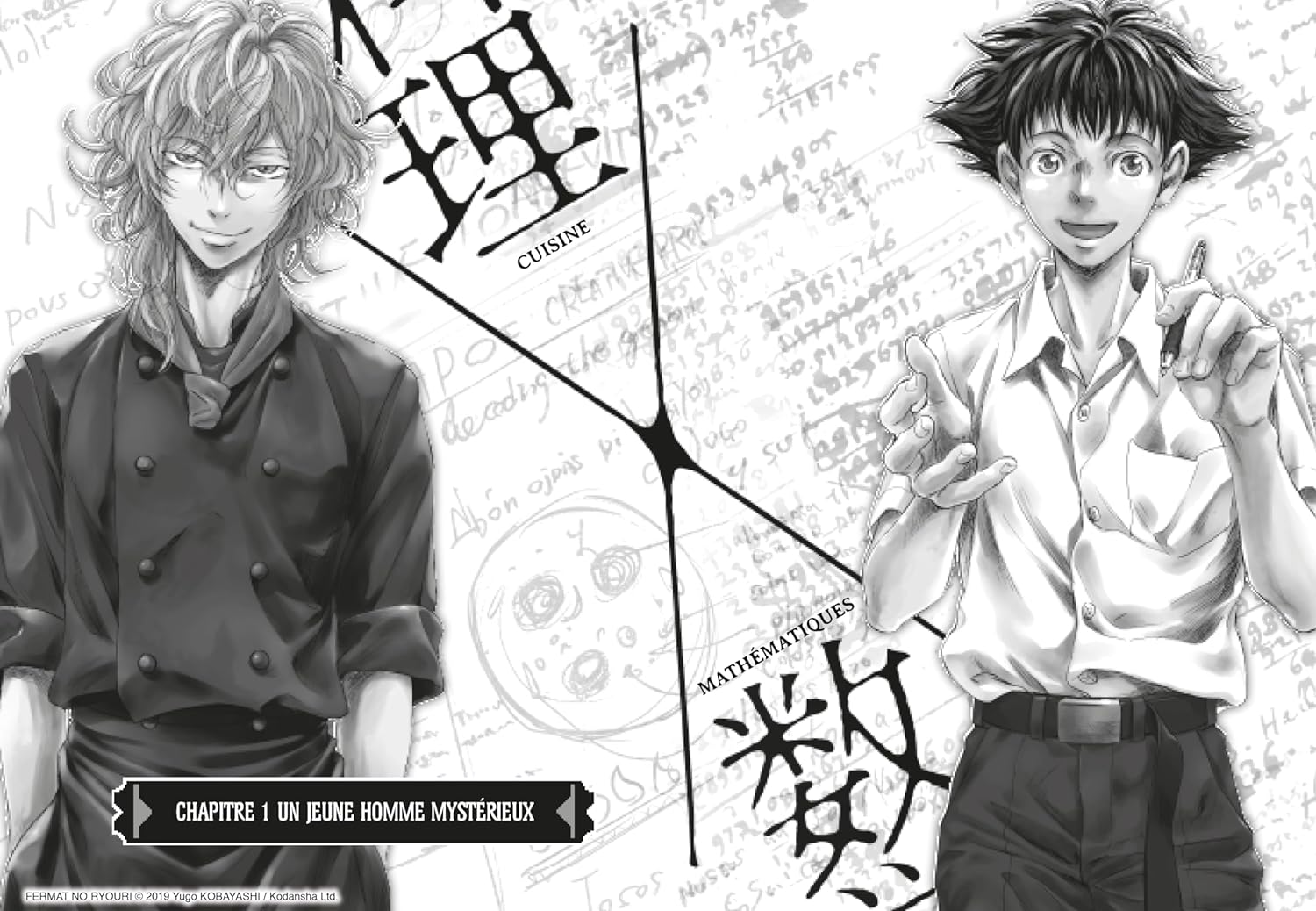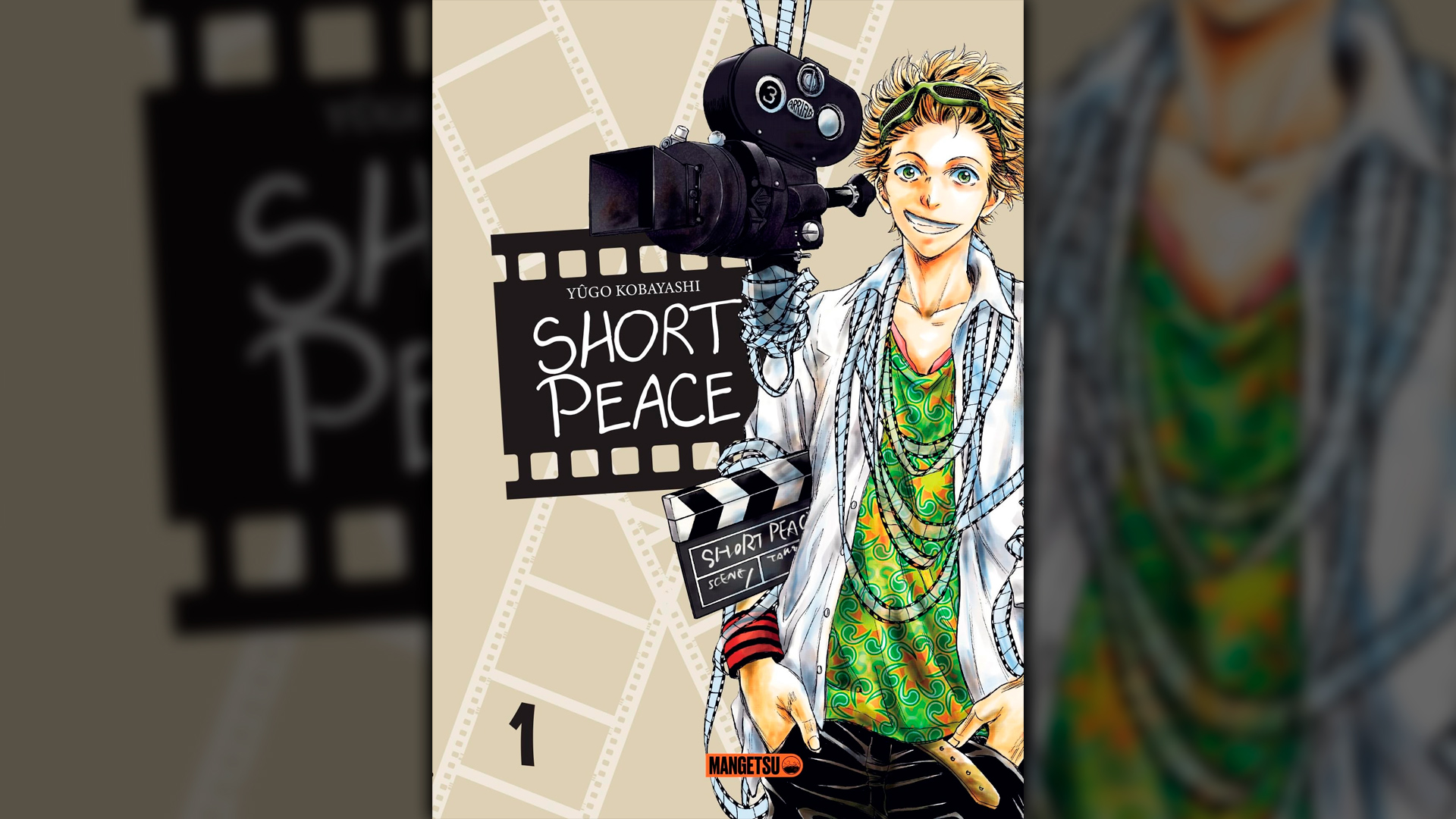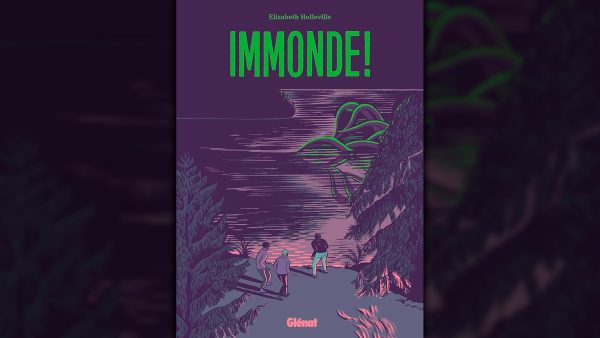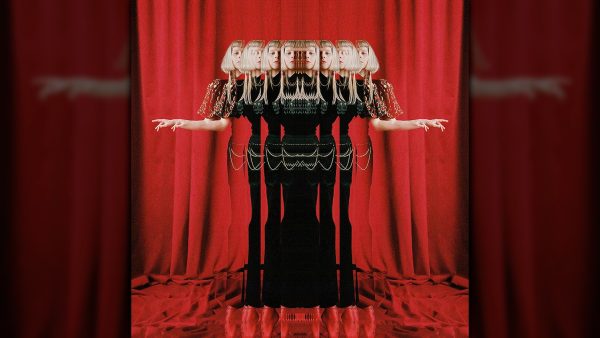Nous sommes en décembre, il ne reste que peu de temps avant les fêtes de fin d’année. Que nous les célébrions ou non, le temps devient hivernal dans bien des régions, ce qui donne envie de se faufiler sous un plaid, non pas devant la cheminée, mais devant un jeu vidéo. (Certes, les deux ne sont pas incompatibles, à condition de ne pas placer la console trop près du feu). Le moment est donc venu de se concentrer sur un jeu indépendant relativement récent. Endling – Extinction is Forever est un jeu d’aventure et de survie développé par les espagnols de Herobeat Studios et édité par German HandyGames. Le titre est sorti, en 2022, sur toutes les plateformes.
The Last of Fox
Endling nous plonge tout de suite dans le feu de l’action, puisqu’une renarde tente d’échapper à une forêt incendiée. A peine s’est-elle mise à l’abri d’une tanière improvisée, qu’elle donne vie à quatre adorables renardeaux. La jeune mère devra s’aventurer, chaque jour, dans un monde post-apocalyptique, afin de leur trouver à manger. Malheureusement, très vite, l’un des petits sera kidnappé par un être humain. Dès que les trois autres renardeaux seront en mesure de marcher, leur mère se mettra à arpenter la région, afin de retrouver l’enfant perdu. Cela n’a rien à voir avec Peter Pan, mais peut rappeler Stray, où nous épousions le point de vue d’un chat errant, explorant un futur peu enviable. Endling est plus crédible, ce qui rend son message écologique à la fois plus implicite et plus fort. L’avenir semble beaucoup plus proche, et cela fait froid dans le dos. Ainsi, le changement brutal des saisons, la pollution mais aussi des Hommes masqués et haineux barreront la route de notre famille renarde. Endling ne vole pas son titre de jeu de survie. Les joueuses et joueurs doivent s’aventurer durant trente jours distincts hors de la tanière, mais toujours revenir avant la nuit. Il convient de suivre des pistes pour retrouver le renardeau volé, de chasser des proies mais aussi d’échapper à des prédateurs et autres dangers. Le jeu n’est pour autant pas très compliqué. Les renardeaux peuvent apprendre plusieurs compétences, pour soutenir leur mère. Cela n’empêche pas de rester vigilants, car un ou plusieurs petits peuvent périr, à cause de la famine ou d’un hibou mal luné.
Gotta feed ’em all !
Dans tous les cas, Endling demeure un jeu très doux, chill et presque addictif. Les quelques événements émergeant sur la carte donnent envie de découvrir ce qu’il se passera le jour d’après, ou comment finira cette histoire. Il y a peut-être aussi un effet Tamagotchi car l’on s’attache aux renardeaux, et on ne souhaite pas les voir dépérir. Le lien émotionnel entre la renarde et ses petits est fort bien tissé, car l’on se sent responsable d’eux. A ce titre, je ne peux que complimenter le gameplay à la fois simple et ingénieux. Il nous plonge vraiment dans le quotidien d’un animal sauvage, pour lequel il n’est pas aisé de survivre. Cette efficacité passe par de petits détails. Le jeu ne se contente pas de dissimuler des pièges à loup ici et là ; la renarde peut par exemple s’étrangler avec du plastique en cherchant de la nourriture dans les détritus. Mais Endling doit aussi énormément à sa direction artistique, qui le rend si doux et somptueux à arpenter. Herobeat Studios a choisi des graphismes empruntant leur style à la 2D, bien que les personnages évoluent de manière latérale dans un monde en 3D. Le résultat est assez original et dans tous les cas joli. Pour finir, Endling ne me semble pas répétitif, dans la mesure où sa durée de vie est assez brève. J’y ai joué environ 9 heures, et je l’ai fait trois fois ; non pas que j’ai des troubles de la mémoire immédiate, mais parce que j’espérais décrocher le Platine. Malheureusement, le trophée nécessitant de nourrir les renardeaux avec tous les aliments possibles du jeu comporte des bugs sur PS5. (Mais j’ai fini par l’avoir !). Passons.
Conclusion
Endling est, en ce qui me concerne, un véritable coup de cœur. C’est un jeu de survie doux, chill, efficace, étrangement addictif, et surtout extrêmement touchant. Bien que l’histoire soit assez conventionnelle, je ne cache pas avoir été émue par son dénouement. Aussi ne puis-je que vous conseiller de tenter l’aventure et – si vous fêtez Noël – de l’offrir à l’un de vos proches. Les jeux mettant en vedette des renards me semblent décidément gage de qualité, comme je l’avais évoqué dans un précédent article.
- Endling – Extinction is Forever est disponible sur toutes les plateformes, depuis 2022.