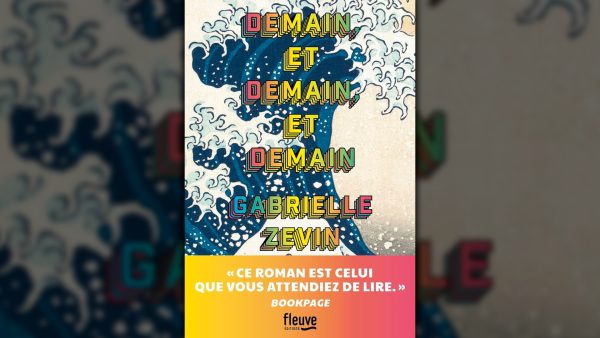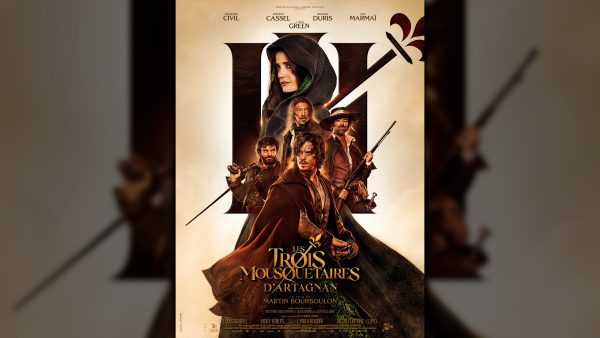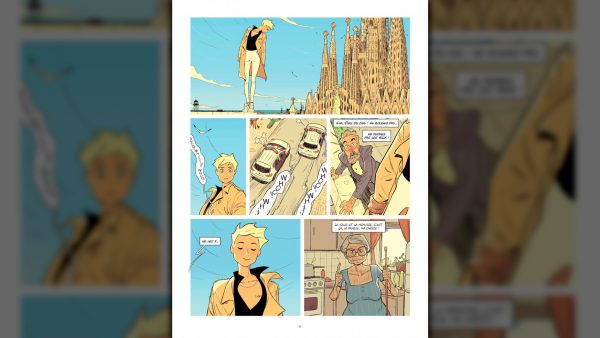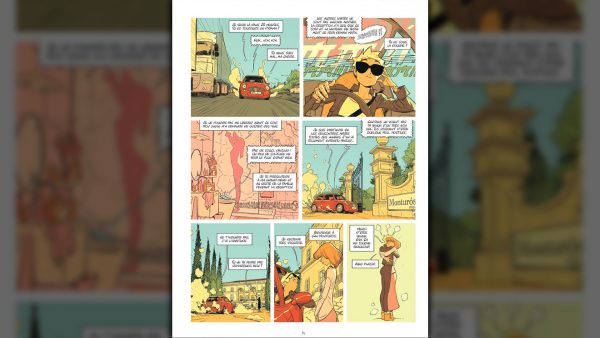Insomniac Games a pris tout son monde par surprise en 2018 sur PlayStation 4 en proposant Marvel’s Spider-Man, leur premier jeu adapté d’une licence de super-héros. Un titre qui a su convaincre autant le public que les critiques, alors que la licence Spider-Man avait connu beaucoup de ratés côté jeux vidéo. C’est en proposant une histoire solide, pleine d’émotions, mais aussi un gameplay grisant, que le titre s’était fait une belle place dans le cœur des fans. Puis un opus sous-titré Miles Morales avait pointé le bout de son nez au lancement de la PS5, mettant en scène le héros du même nom. Un titre moins ambitieux, plus condensé, mais pas moins sympathique, qui faisait office de transition en attendant le prochain grand jeu, sorti finalement le 20 octobre dernier. Alors Marvel’s Spider-Man 2 est-il capable de sublimer la formule initiée par son aîné ?
La force de l’amitié… sans clichés
Le premier jeu sorti en 2018 nous faisait découvrir un Peter Parker qui tentait d’entrer dans la vie active, aux côtés d’un scientifique qu’il admirait, Otto Octavius. Les choses ont évidemment mal tourné, celui-ci finissant par devenir Dr. Octopus, mais c’est dans cette proximité avec l’humain derrière le masque que les têtes pensantes de Insomniac Games trouvaient de très belles choses à dire sur Spider-Man et son univers. Il pourrait pourtant paraître éculé, le super-héros ayant connu un nombre incalculable d’adaptations, sans même parler des milliers de numéros de comics où il apparaît. Plus encore, le premier jeu prenait assez peu de risque en abordant le héros sous un angle déjà bien connu, celui du jeune premier, et de son éternelle confrontation avec Octopus. Mais cela a parfaitement fonctionné grâce à deux ingrédients : d’abord, le héros étant ancré dans son quotidien, entre les interventions de son amour de toujours Mary Jane, celles de sa tante May, et les nombreuses missions qui ne visaient à rien d’autre qu’à aider les habitant·e·s des quartiers qu’il traversait. L’autre ingrédient, c’était celui d’une amitié formée avec le grand méchant, dans le privé, jusqu’à ce que celui-ci devienne le « vilain » que l’on connaît si bien. Ces deux éléments étaient fondamentaux dans la réussite narrative du premier titre, et cette suite les reprend évidemment. Mais avec des subtilités supplémentaires, car on n’incarne plus uniquement Peter Parker, puisqu’il est rejoint ici par Miles Morales. Ce dernier a d’autres préoccupations. Il vient d’un milieu différent et il est plutôt en fin de lycée, en vue d’intégrer une université. Son entourage est différent, moins mature, mais cela n’empêche pas Insomniac Games d’y remettre les mêmes ingrédients, en racontant un héros proche de son quartier, de sa communauté, même s’il doit apprendre à jongler entre ses impératifs personnels et sa nouvelle vie de super-héros. Tout ce qu’a déjà appris à faire il y a longtemps son mentor Peter Parker.
En s’inspirant de nombreux comics comme La Dernière Chasse de Kraven ou King in Black, ce nouveau jeu embarque néanmoins, à la différence du premier, ses héros dans un ton infiniment plus sombre. Il y a Kraven d’abord, un vilain redoutable qui incarne à lui seul l’essentiel de la violence que l’on trouve dans l’univers de Spider-Man. Il ne semble obéir à aucune règle, n’hésitant pas à tuer (alors que le Spider-verse est habituellement plus doux sur ce point là), cherchant à éliminer tout le monde, jusqu’à isoler et traquer le héros. Et puis il y a le symbiote, l’incarnation de Venom, dont la brutalité n’est un secret pour personne, et que le jeu retranscrit plutôt très bien, poussant ses héros vers un gouffre qui semble sans fond. Toute la deuxième partie du jeu ressemble à une descente aux enfers, et ça a été une sacré surprise. Car c’est presque inattendu, Insomniac Games ayant tenté de rester plutôt « tout public » dans son premier jeu et qui là, sans que ce soit d’une violence insupportable, n’hésite pas à surprendre, voire à choquer, à l’occasion de quelques scènes où le symbiote montre son vrai visage. Et ce changement d’orientation fonctionne d’autant mieux que le jeu s’est attaché dans toute sa première partie à raconter les amitiés qui unissent les protagonistes concernés par ces évènements dramatiques. Il y a l’amitié de Peter Parker et Harry Osborn, que les précédents jeux ont suggéré, mais aussi l’amour qui unit le premier à Mary Jane. Enfin, la relation naissante – mais terriblement mignonne – entre Miles Morales et Hailey Cooper fonctionne très bien, donnant même l’occasion d’offrir de très nombreuses scènes en langage des signes, un point d’attention remarquable et un risque narratif maîtrisé : c’est une autre manière de livrer des dialogues, malheureusement rare dans les jeux vidéo, et celui-ci s’en sort très bien.
Il y a peut-être quelques reproches à lui faire, la place notamment de Miles Morales qui apparaît parfois en retrait, l’essentiel des scènes les plus importantes tournant autour de Peter Parker. Mais c’est peut-être aussi parce que l’histoire se raconte comme une passation de pouvoir, entre l’ancien et le nouvel héros. Car Miles Morales incarne un certain renouveau, entouré de sujets plus modernes, de soucis similaires à ceux des jeunes d’aujourd’hui. Il incarne la volonté de parler d’inclusivité et de diversité, de résilience de communautés mises à l’écart, de la nécessité de tendre la main à celleux qui n’ont pas eu la même chance au départ de leur vie. Et cela répond très bien à ce qu’incarne Peter Parker, qui est raconté dès le premier jeu comme très investi dans le volontariat (aux côtés des plus pauvres notamment), tandis que ce second jeu a un sous texte écologique plutôt intéressant. De manière plus générale on sent que Insomniac Games, qui s’est entouré de plusieurs jeunes auteurices venu·e·s des comics ou des romans young adult, avait envie de raconter des choses différentes, déjà esquissées dans le jeu Marvel’s Spider-Man : Miles Morales, quitte à déplaire aux franges les plus réactionnaires du jeu vidéo. Et cela a le mérite en plus d’interroger ses héros sur le sens de leur action, sur leur impact pour leurs communautés, mais aussi l’intérêt d’une action individuelle au regard du collectif. Cela se ressent notamment du côté de Miles qui est tiraillé entre son action et celle de sa mère élue au conseil municipal.
« More of the same », mais il le fait bien
En dépit d’une structure très similaire à celle de son aîné, le monde ouvert de Marvel’s Spider-Man 2 gagne en profondeur. Et ce grâce à une ville considérablement agrandie, quasiment doublée, avec l’arrivée du quartier de Brooklyn en complément du Manhattan du premier jeu. Il y a un plaisir certain à enfin pouvoir franchir le fameux pont de Brooklyn, d’autant plus que tous les jeux Spider-Man sortis depuis vingt ans se limitaient à Manhattan, mais en plus ce nouveau quartier apporte une nouvelle manière de jouer. Car à la différence des gratte-ciels de la part la plus bourgeoise de New York, Brooklyn (qui n’a pas évité la gentrification, et ça se voit d’ailleurs dans le jeu) est composé de plus petits immeubles, et même d’un quartier pavillonnaire où il est évidemment plus difficile de se déplacer dans les airs. Et c’est là qu’une nouvelle manière de se mouvoir prend tout son sens : le « delta-toiles ». Inspiré par ce que l’on a vu dans plusieurs comics, les deux Spider-Man bénéficient sur leurs tenues de toiles déployées sur leurs flancs, sous les bras, afin de pouvoir planer dans les airs. Si ce système ne permet pas de voler de manière infinie et la distance parcourue dépend de l’élan pris initialement, il permet toutefois d’emprunter des « couloirs » d’air qui donnent un boost sur une certaine distance, tandis qu’en dehors des couloirs, cela permet de planer sur de longues distances en attendant de pouvoir atteindre un immeuble, une grue ou encore un hélicoptère de passage qui pourraient être utilisés pour se balancer à l’aide des toiles plus classiques.
Quant à sa forme, Brooklyn est plutôt sympathique à l’oeil, et offre de nouveaux lieux et références à l’univers de Spidey, à commencer par le lycée Brooklyn Visions où étudie Miles Morales. Un lieu où l’on peut réaliser quelques quêtes secondaires assez sympathiques, marquant narrativement la proximité de Miles avec ses camarades, loin des considérations plus adultes d’un Peter Parker. Il est d’ailleurs possible de passer d’un personnage à l’autre à tout moment dans les séquences libres en monde ouvert, mais la plupart des missions exigent de jouer un personnage en particulier, même si certaines missions à deux nous montrent les deux araignées se battre ensemble. Quant à la progression, chacun dispose de son propre arbre de compétences à maximiser, bien qu’un troisième arbre, en commun, permet d’obtenir des compétences valables pour les deux. Mais c’est côté combat qu’il y a le plus de similarités avec le premier jeu.
Certes les combats bénéficient de quelques ajouts, notamment de nouveaux pouvoirs pour les deux personnages, à commencer par ceux du Symbiote pour Peter Parker, et un « filin de toile » à utiliser dans les phases d’infiltration pour se mouvoir en hauteur de manière plus libre, permettant d’installer une longue toile d’un mur à l’autre pour s’y balader et choper les ennemis en contrebas. Mais dans l’ensemble, on retrouve les mêmes dynamiques de combat, le même type d’ennemis, et des objectifs secondaires quasiment identiques entre les bases d’ennemis à nettoyer et les courses poursuites avec des malfrats à arrêter. Heureusement, c’est l’enrobage qui fait la différence, avec un jeu jamais avare en dialogues bien sentis et plein d’humour, qu’il s’agisse des podcasts réactionnaires de JJJ diffusés dans les oreilles de Spidey, ou les rencontres avec divers personnages. Mais aussi, chaque mission, aussi banale soit-elle, est souvent une bonne occasion pour le jeu de nous rappeler quelques références à son univers, à faire du fan service et des clins d’œil à des choses qu’on n’imaginait pas trouver là. C’est probablement facile, mais pour un fan de cet univers comme je le suis, ça fait mouche. À l’image du premier jeu, on sent que le titre a été pensé par des fans de Spider-Man, et c’est toujours plaisant.
Une réussite artistique, un univers savoureux
Le fait d’être imaginé par des fans n’est pas toujours gage de qualité, mais on sentait dès le premier épisode, son extension Miles Morales et maintenant avec ce second épisode, que Insomniac Games et ses auteurices, artistes et développeurs·euses ont toujours voulu aborder la licence en gardant une proximité importante avec les comics qui ont fondés ces personnages. Si le jeu n’hésite pas à prendre des libertés, que cela soit à cause de contraintes de structure vidéoludique ou pour offrir leur propre conception des personnages, le titre ne cesse de référencer quelques aventures les plus populaires et, quand il réinvente son univers, il le fait toujours dans le respect des valeurs des originaux qu’il référence. Cela se sent par exemple dans la création de leur Venom, différente des matériaux dont iels s’inspirent, mais qui reste dans le ton très similaire à ce que les auteurices de comics voulaient raconter initialement. Cette envie de bien faire l’empêche parfois de prendre des risques, n’allant pas toujours au bout de ses idées pour rester assez conventionnel. À l’exception évidemment de la quête principale, qui prend une tournure surprenante dans sa deuxième partie, et son insistance autour de l’inclusivité et de la diversité qui donne une place importante à des thématiques qu’on voit rarement dans les jeux vidéo AAA.
Le jeu profite en plus, artistiquement, de la beauté d’un monde ouvert où le plaisir de se balader reste toujours l’un des meilleurs arguments de la licence. Le premier jeu avait su convaincre pour le plaisir procuré et les sensations de liberté au moment de se balancer avec ses toiles entre les gratte-ciels de Manhattan, et cette suite reprend entièrement ces sensations. En y ajoutant une touche supplémentaire avec un delta-toiles qui fonctionne très bien, mais surtout un sentiment de pouvoir explorer sans limites grâce à l’agrandissement de la carte. Plus encore, ce sont les effets de lumière, les reflets plus réalistes, les intérieurs des appartements que l’on aperçoit en se baladant le long d’un immeuble, qui donnent beaucoup de vie à la ville. De la même manière, les voitures et les piétons sont plus nombreux dans les rues, la distance d’affichage accrue par rapport au premier sur PS4, et les effets de particules plus solides. Sans pour autant révolutionner l’aspect visuel du jeu, celui-ci est plus organique, plus vivant, plus agréable à parcourir.
Je n’avais que peu de doutes sur le fait que cette suite saurait m’emporter et me séduire, en tant que fan de Spider-Man, mais aussi après avoir adoré les deux précédents jeux. Mais je ne m’attendais pas à ce que la narration ose autant dans la deuxième moitié de la quête principale, ce qui ajoute une jolie surprise à un ensemble qui peine parfois, sur ses autres éléments, à apporter de la nouveauté. Mais parfois, une recette qui fonctionne est aussi satisfaisant, Marvel’s Spider-Man 2 étant la garantie de retrouver toutes les bonnes choses de ses prédécesseurs. Insomniac Games avait trouvé la bonne formule en 2018 et l’agrémente cette année de quelques détails en plus pour qu’elle ne perde rien de sa fraîcheur, pour offrir dans l’ensemble un jeu capable de séduire autant pour le plaisir qu’il procure quand on explore son univers, que pour les émotions qu’il sait transmettre à quelques moments clés de son histoire. Une belle réussite.
- Marvel’s Spider-Man 2 est disponible sur PlayStation 5 depuis le 20 octobre 2023.



















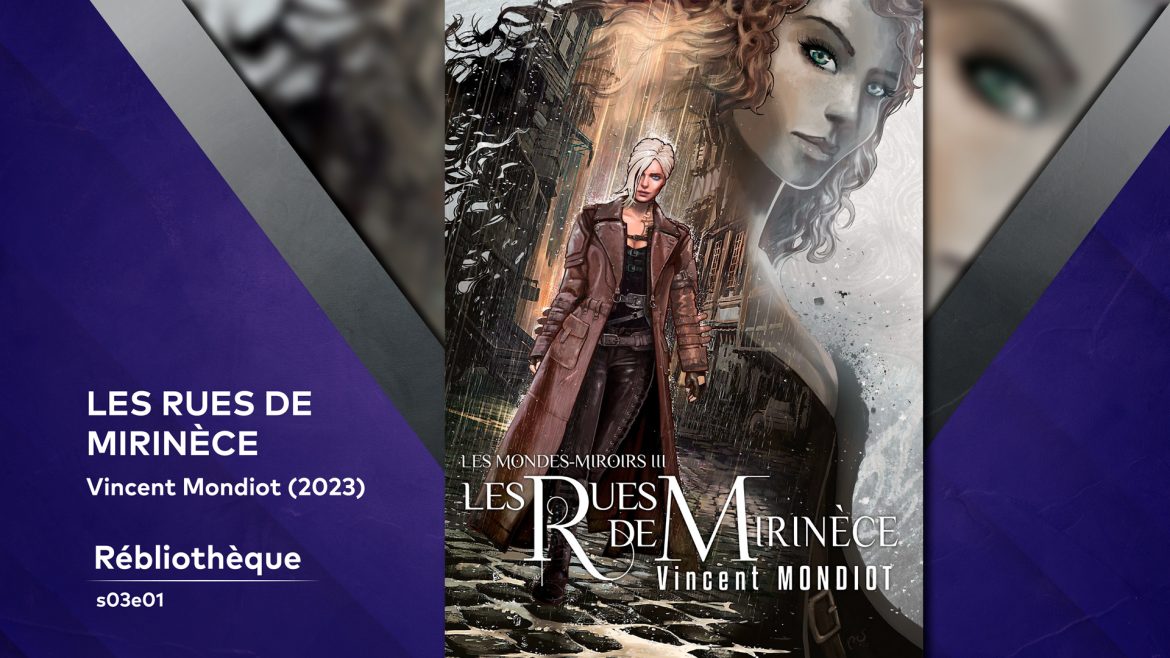




 Côté jeux vidéo, cette année, la palme revient sans doute à The Wreck (The Pixel Hunt), dont j’avais proposé mon avis sur
Côté jeux vidéo, cette année, la palme revient sans doute à The Wreck (The Pixel Hunt), dont j’avais proposé mon avis sur