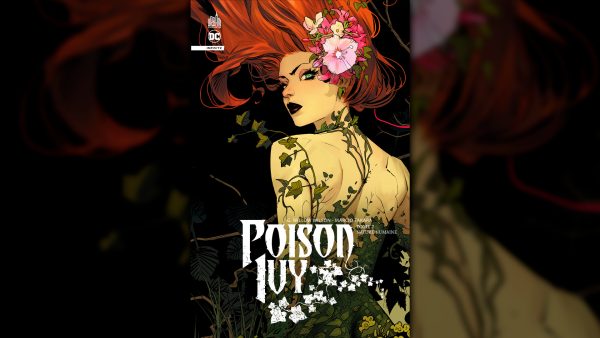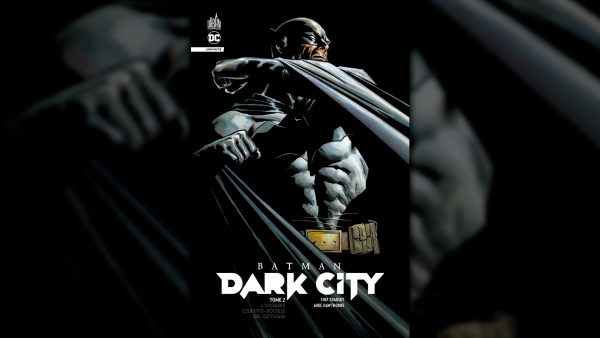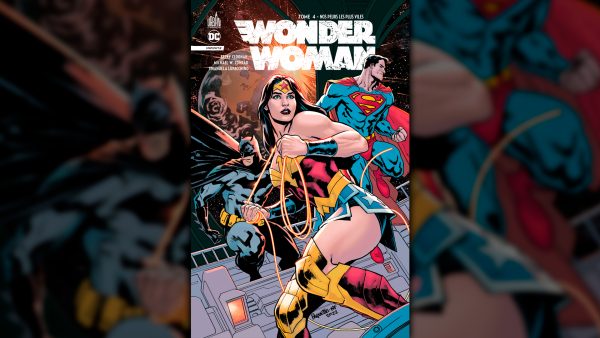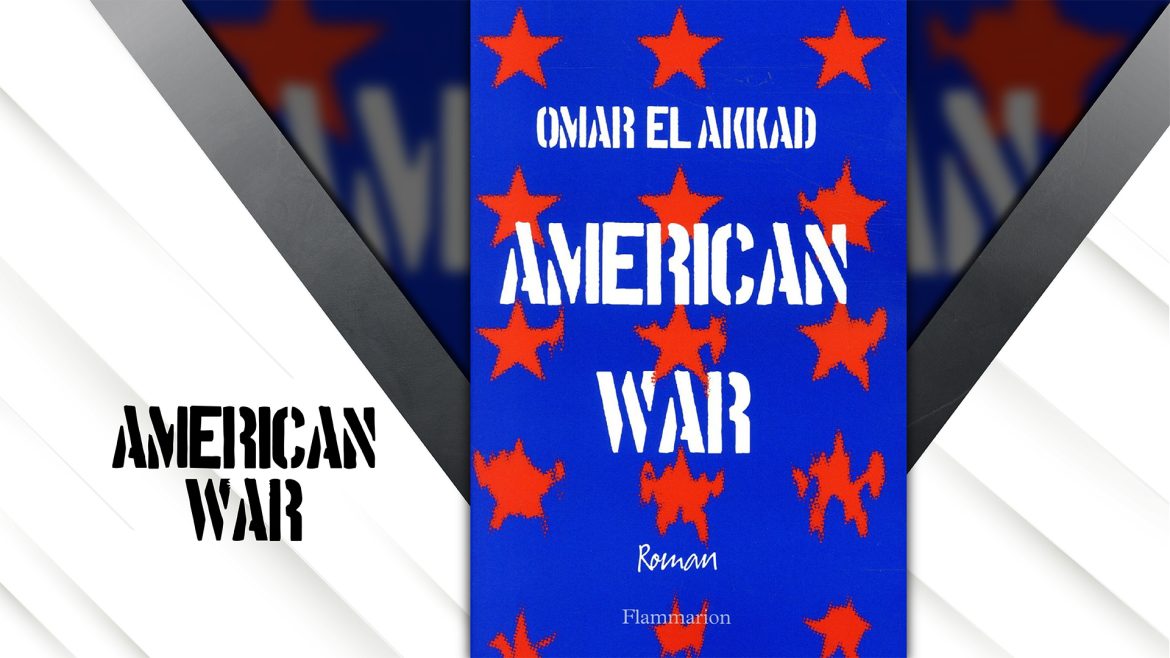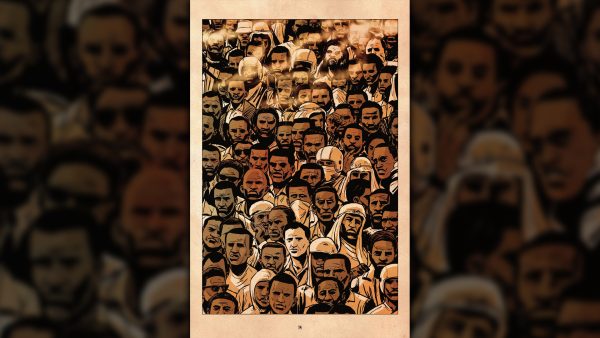A l’approche de la fin d’année, Urban Comics redouble d’efforts pour proposer, assez peu de temps après les publications US, les tomes reliés de ses différentes séries de l’univers DC Infinite. Faute d’article le mois dernier, on se rattrape avec les sorties de septembre et octobre, où quelques séries majeures et forcément très populaires, notamment celles de Batman et Wonder Woman, connaissent de nouvelles avancées.
Cette chronique a été écrite suite à l’envoi d’exemplaires par l’éditeur.
Nightwing Infinite – Tome 4, à l’heure des choix
Je ne le cache pas, depuis ses débuts, la série Nightwing Infinite m’a complètement conquis. Probablement l’une des meilleures choses depuis le début de l’ère Infinite, avec le duo de Tom Taylor et Bruno Redondo qui excelle dans sa manière de raconter et de mettre en scène le personnage. Un Nightwing qui n’a pas toujours été l’un de mes héros préférés, mais dont le potentiel est parfaitement exploité dans cette série de comics. Et ce grâce à une écriture capable d’allier des volontés d’action à un côté plutôt intimiste, parfois drôle, et souvent pertinent. Grâce notamment aux cases dessinées par Redondo qui ne cessent d’étonner pour leur ingéniosité. Et ce quatrième tome est un peu la somme de toutes ces qualités, avec une action certes omniprésente, comme de grandes scènes sorties d’un blockbuster, mais surtout pour le choix d’orienter le récit vers quelque chose de plus intime, plus concentré sur le héros. Et ce quitte à ce que le récit se mette en pause quelques instants, en préférant raconter le passé -et son impact sur le présent- avant de repartir sur un nouvel arc, maintenant que le grand méchant du précédent arc (Blockbuster, justement) est mort. On y voit un Nightwing/Dick Grayson qui s’émancipe définitivement, qui grandit, et qui assume être un leader, face à une ville de Blüdhaven où tout est à reconstruire maintenant que celui qui y maintenait crime et corruption n’est plus.
Il est évident qu’avec les mois, le récit a gagné en épaisseur et en intérêt au sein de cet univers là. On sent la volonté de DC de donner à Nightwing une place considérable, comme un alter ego de son père adoptif Batman, enfin émancipé de l’ombre de celui-ci. Certains auteurs par le passé ont donné une grandeur au personnage qui lui permettait déjà de s’assumer au-delà du carcan de père et mentor, mais Tom Taylor parvient à aller encore un peu plus loin, symbolisant même ce choix dans une scène très émouvante entre Nightwing et Batman, où les deux justiciers posent enfin des mots sur leur difficile relation père-fils adoptif. Une scène peut-être un peu tire-larmes certes, néanmoins très réussie, un vrai moment de grâce qui fait évidemment plaisir aux lecteur ·ices qui aiment ces personnages-là. Alors oui, au final, il ne se passe pas tant de choses que ça dans ce tome, mais c’est un bonbon à savourer, une récompense pour les personnes qui ont suivi les précédents comics et qui ne peuvent rester insensibles face à cet élan de tendresse en quelques chapitres.
Batman Nocturne – Tome 2, au fin fond de la mythologie
Suite des Detective Comics écrits par Ram V, ce deuxième tome de Batman Nocturne continue sur le même ton que le premier. Phagocyté par les démons, Gotham est abandonnée à de nouveaux prédateurs, qui ont un impact considérable sur un Bruce Wayne rattrapé par ses vieux démons, mais aussi sur Harvey Dent qui lutte entre sa volonté de retrouver la lumière, et sa moitié maléfique. Disons le d’entrée, c’est encore meilleur que le premier tome, grâce à un auteur qui explore en profondeur la mythologie de Batman et l’utilise pour tourmenter son personnage. La proximité entre Batman et une créature de la nuit, maléfique, n’a jamais été aussi prégnante, tandis qu’un James Gordon désabusé et traumatisé par les évènements de ces dernières années (comme on le voyait dans la série de comics Joker Infinite par exemple) refait son apparition et incarne, malgré lui, ce Gotham qui n’a plus trop d’espoirs. Violent, le récit nous emmène dans ce que Gotham a de plus poisseux, de plus sombre, avec une population prise dans un cauchemar perpétuel où un flic se met même à raconter que l’explosion d’une station et un immeuble en feu, c’est une bonne journée pour Gotham, d’habitude c’est encore pire.
Il est évident que Ram V prend un plaisir fou à écrire sur le personnage, en convoquant les aspects de cet univers qui l’intéressent le plus et qui correspondent au mieux à son propre monde : mysticisme, mythologie, l’impossible devient possible et la ligne entre réel et irréel est plus fine que jamais. Difficile parfois de savoir ce qui est vrai ou non, ce qui n’est qu’une vue de l’esprit de ses personnages tourmentés et ce qui est un fait établi, mais c’est aussi ce que fait le charme du récit. C’est cette manière de raconter son histoire sans s’imposer de limites, en sortant des codes habituels des récits Batman, qui font de Batman Nocturne un excellent comics. Et avec les très beaux dessins de Ivan Reis et Stefano Raffaele notamment, on se retrouve avec une œuvre absolument délicieuse, qui corrige les quelques errements de son premier tome en amenant le récit sur quelque chose d’encore plus fort, et de plus personnel aussi peut-être.
Poison Ivy Infinite – Tome 2, une Terre à purifier
Suite de l’aventure meurtrière de Poison Ivy, las d’un monde qui a détruit sa nature, déterminée à exploiter le cordyceps, ce fameux champignon parasite qui transforme ses hôtes en « zombies » afin de donner une sacré leçon au monde. Dès ses premiers instants, ce tome 2 s’attarde sur le sens de sa quête, mais surtout sur la destruction environnementale à laquelle s’adonne une corporation, amenant le récit vers la question écologique mais pas seulement. Si celle-ci est une évidence et fait partie de la mythologie de Poison Ivy depuis toujours, G. Willow Wilson y ajoute là aussi des considérations politiques relatives au vol des terres agricoles aux populations natives des États-Unis. La corporation en question, nommée FutureGas, exploite la terre et la pollue, donnant vie de manière involontaire à des espèces de créatures sorties de la nature qui s’en prennent aux gens autour du site. Allégorie de la destruction et le vol des terres et leur impact à long terme tant sur l’environnement que sur la survie des populations amérindiennes, cette séquence illustre plutôt bien le fond d’un comics qui ne dépeint jamais Poison Ivy comme la méchante de l’histoire. Si sa quête est faite d’une vengeance presque aveugle, elle n’en reste pas moins une réaction face à la destruction méthodique à laquelle s’adonne un capitalisme qui n’a pas grande considération pour l’environnement, les populations locales et leur bien-être.
En parallèle, c’est l’histoire d’amour de Ivy et Harley Quinn qui intéresse G. Willow Wilson. Elle écrit leur amour avec beaucoup de tendresse et de douceur, expliquant l’importance que chacune revêt pour l’autre. Deux âmes torturées qui trouvent un équilibre lorsqu’elles sont ensembles, chacune apportant à l’autre le chaînon manquant pour trouver une certaine forme de bonheur. C’est très beau, et avec les jolis dessins de Atagun Ilhan et Marcio Takara, le comics continue les excellentes choses vues dans le premier tome. C’est aussi bien une œuvre militante qu’une quête de sens, saupoudrée d’attaques contre un monde en perdition et de moments intimes où l’amour prend le pas sur la haine. Le personnage de Poison Ivy a connu le meilleur comme le pire selon les auteur·ices qui ont pu écrire ses aventures, parfois caricature de séductrice, d’autres fois personnage mystique. Mais G. Willow Wilson l’aborde plutôt sous un angle humain, avec ce fond d’humanité qu’il reste à un personnage qui pensait avoir abandonné cette facette en se dévouant pleinement à la nature. Elle retrouve d’ailleurs son humanité dans Janet, une de ses victimes qu’elle finit par épargner, un personnage haut en couleurs qui lui fait confiance un peu par dépit. Une très belle lecture.
Batman Dark City – Tome 2, l’herbe est moins verte ailleurs
Suite aux évènements du premier tome de cette histoire de Chip Zdsarsky, Batman a été envoyé dans un monde alternatif du multivers par Failsafe, l’espèce de robot et intelligence artificielle qu’il avait créé inconsciemment -la faute à son subconscient- pour se neutraliser lui-même s’il venait à mal tourner. Détruit par son œuvre, Bruce Wayne se retrouve sans rien, loin de son entourage, dans un monde qu’il ne connaît pas. Un moyen inévitablement pour Zdarsky de faire ce qu’il fait de mieux, s’amuser, en imaginant quelque chose de complètement différent. C’est ainsi qu’il balance son héros dans un monde alternatif aux inspirations très orientées vers Judge Dredd, avec un Harvey Dent qui règne en maître sur les rues, incarnant la police, procédant aux arrestations, et la justice, en tuant immédiatement les malfrats. Un monde d’une violence inouïe qui a une particularité, celle de n’avoir aucun·e héros·ïne, pas même un Batman. Alors notre héros en profite pour faire régner un semblant de peur sur les malfrats et sur la police ultra-corrompue qui suit Harvey Dent, surtout pour trouver une personne capable de le renvoyer dans sa propre réalité.
Plutôt bon délire, ce deuxième tome permet à Chip Zdarsky de lâcher les chevaux en tourmentant encore un peu plus son Batman après lui avoir opposé un subconscient mal intentionné dans le premier tome. Fort d’un récit sans temps mort, le comics se lit d’une traite avec beaucoup de plaisir, dans le plus pur esprit du Chevalier Noir, avec une touche d’enquête et d’impossible, le personnage s’amusant lui-même d’un fait désormais établi : même face à une situation désespérée, Batman s’en sort toujours. En outre, le récit nous gratifie de quelques dernières pages qui permettent d’explorer le multivers et de s’offrir un petit trip sympathique dans les univers des vieux films, série et séries animées de Batman. Et ce comme un hommage à de nombreuses incarnations d’un héros qui, peu importe les versions, reste toujours animé par la même détermination à se battre, à s’en sortir et surtout, au centre de ce récit, à triompher sur son ennemi de toujours, le Joker. Comme toujours, il faut adhérer au style de Chip Zdarsky, mais pour peu que l’on soit fan, c’est un véritable plaisir de parcourir cette histoire.
Wonder Woman Infinite – Tome 4, le retour à la réalité
Quatrième et ultime tome du récit chorale qu’est la série de comics Wonder Woman Infinite, cette nouvelle sortie recentre l’intrigue de la déesse de Themyscira vers le « monde des hommes ». Celui-là même qu’elle s’est jurée de protéger, et qu’elle avait un peu mis de côté depuis le début du run de Becky Cloonan et Michael W. Conrad alors que son île et ses sœurs amazones étaient tourmentées par les Dieux. Après la perte de sa mère Hippolyte, elle revient vers Etta et Steve Trevor, ses fidèles compagnons, tandis que de nouvelles menaces apparaissent. À commencer par une drôle de marque laitière à laquelle est lié le Dr. Cizko, éternel opposant à Diana, qui distribue des bouteilles de lait qui semblent permettre de contrôler les foules. Sorte d’émanation des Produits Laitiers à la française, ce lobby qui veut faire bouffer du lait de vache à toute la population semble cacher de bien sombres présages, mais je n’en dirai pas plus, puisque l’intrigue tourne essentiellement autour de ça.
Ce qui m’a surtout intéressé dans cet ultime tome, c’est le retour à la réalité, comme une fin d’aventure pour l’amazone. Loin des côtés mystiques et parfois franchement confus, il faut l’avouer, de la quête divine, le duo d’auteur·ices Cloonan et Conrad ramène leur personnage à quelque chose qui m’a parfois évoqué le run de Greg Rucka à l’époque, qui ancrait le personnage dans une réalité proche de la nôtre. C’est aussi l’occasion d’un chapitre de retrouvailles avec Batman et Superman, un peu cringe, et surtout le moment de retrouver une super dynamique avec ses allié·es de toujours qui semblent rayonner de mille feux maintenant qu’ils·elles peuvent combattre à nouveau aux côtés de leur héroïne. D’autant plus que ce tome se paie le luxe de faire collaborer quelque un·es des meilleur·es artistes de ces dernières années, comme Marguerite Sauvage, Emanuela Lupacchino, Amancay Nahuelpan, Joëlle Jones, Terry Dodson ou encore Jen Bartel, faisant de cette dernière aventure un joli condensé de ce que le personnage peut inspirer aux dessinateur·ices de comics en vogue.
- Les comics cités dans cet article sont disponibles en librairie aux éditions Urban Comics.