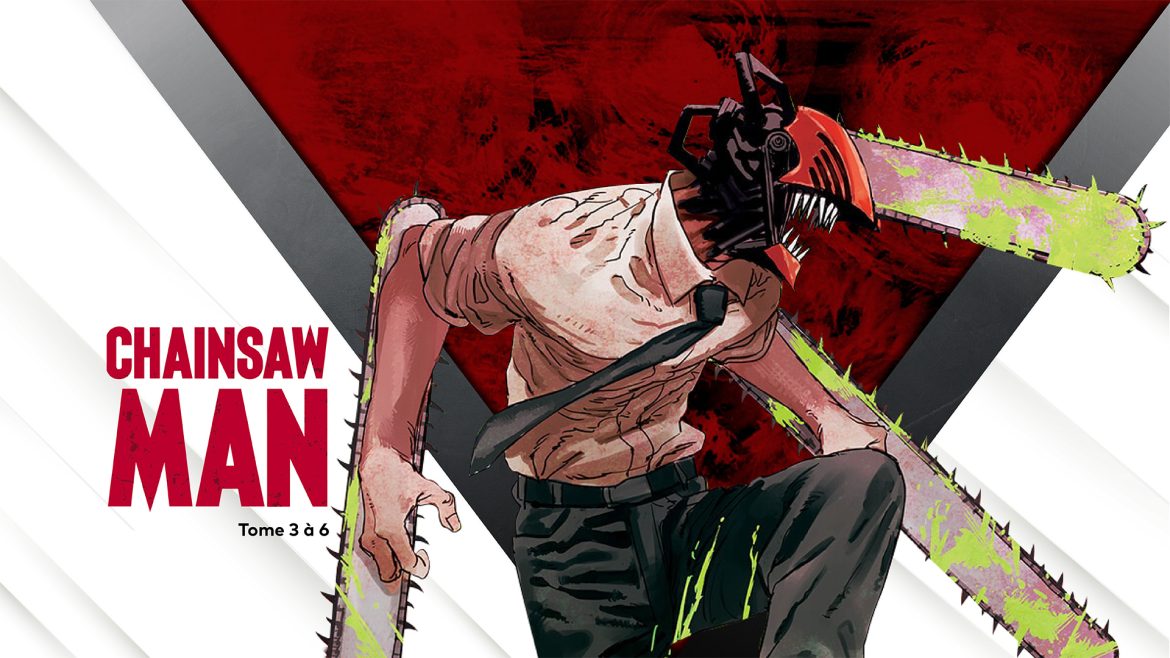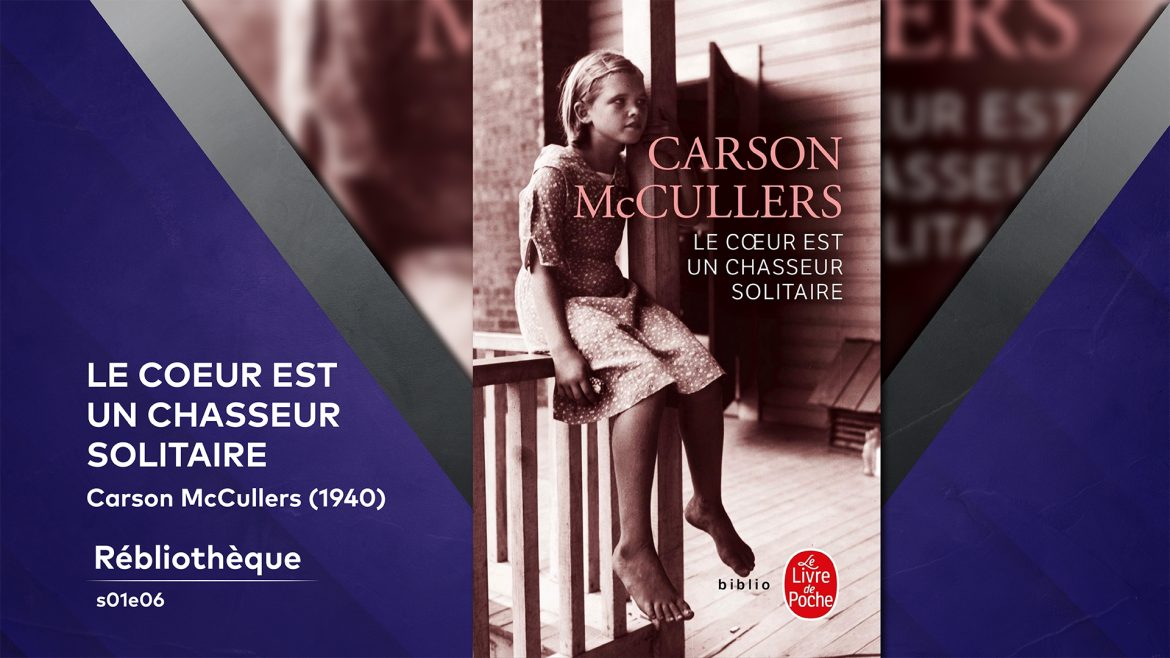En 2017, la première partie de La Casa de Papel fut diffusée sur Netflix. La série espagnole devint très tôt un phénomène mondial, si bien que, à force d’en entendre parler, je préférai ne pas la regarder du tout. Mon entourage fut assez persuasif pour m’encourager à tester la série. Et, aussi surprenant que cela puisse paraître, je n’ai même pas accroché au premier épisode ! Pour une raison qui m’échappe aujourd’hui, je décidai, quelques temps plus tard, de lui accorder une seconde chance. Ce fut, cette fois-ci, une révélation. Je tombai amoureuse de cette série et par-dessus tout de ses personnages, destinés à me suivre durant quelques années.
À mes yeux, La Casa de Papel est de ces œuvres qui vous accompagnent, dans les bons puis les mauvais moments. Certains personnages deviennent étrangement proches comme s’ils étaient de vieux amis, voire des reflets de vous-même.
Comme bien des séries, La Casa de Papel n’a jamais été exempte de défauts. Certains se sont même aggravés, au fil des saisons. Pour être tout à fait honnête, je n’ai pas été particulièrement emballée par les cinq premiers épisodes de cette dernière partie, diffusés en septembre dernier. En dépit du rebondissement final très émouvant, La Casa de Papel avait oublié toute une partie de son ADN pour raconter une simple guerre. J’avais néanmoins assez foi en la série pour lui pardonner ses fautes de parcours. J’étais même impatiente de découvrir ce qu’Álex Pina, le créateur, allait nous proposer comme final.
Oui, La Casa de Papel s’est terminée le 3 décembre dernier. A l’instant où j’écris ces mots, j’ai encore un peu de mal à le réaliser.
J’ai parfaitement conscience que vous avez ouvert cette page pour lire un avis (sans spoiler) sur les derniers épisodes, et non pas le récit de mes états d’âme. Mais l’un ne va pas sans l’autre. Et je crois que, en dépit de sa popularité exacerbée et de son aspect commercial, La Casa de Papel est demeurée une série intimiste et émotionnellement importante, pour beaucoup de téléspectateurs et téléspectatrices.
Les créateurs ne s’en sont jamais cachés : la série espagnole est plus l’histoire d’une tradition familiale que celle d’un braquage. C’est pourquoi une grande partie des épisodes se concentre sur les émotions des personnages. La Casa de Papel ne serait pas non plus ce qu’elle est sans une tendance pour l’épique et le sensationnel. Contrairement aux cinq premiers épisodes de la partie finale (excusez ce jargon, les découpages Netflix deviennent compliqués), l’arc final n’est pas dans la surenchère à outrance. La série renoue avec son côté picaresque espagnol, qui explique entièrement le dénouement.
Une famille de braqueurs
Les cinq épisodes finaux de La Casa de Papel racontent la fin du braquage de la banque d’Espagne, imaginé par le Professeur, pour sauver Rio, qui était retenu prisonnier par l’Etat, dans des conditions contraires aux droits de l’homme. A ce stade du récit, les braqueurs doivent encore trouver un moyen d’expulser l’or puis de s’échapper, avant que les forces militaires du pays ne parviennent à envahir l’édifice. C’est grâce à un rythme moins effréné ainsi qu’à l’utilisation d’analepses (une manière plus française et plus prétentieuse de parler de flash-back) que la saison prend le temps de se poser et de retranscrire les émotions des personnages, comme l’évolution de leurs relations. Les créateurs de la série ont toujours cherché à raconter un braquage dans lequel les voleurs s’aiment mutuellement et ressentent des émotions crédibles, afin de faciliter l’identification envers eux. Loin d’être une simple histoire de braquage, La Casa de Papel est un récit familial. Les protagonistes tiennent les uns aux autres et cet amour est communicatif, si bien que l’on craint pour leur vie ou que l’on se laisse prendre au jeu, même quand ils font tout autre chose que s’inquiéter pour le braquage.
De coutume, je suis plutôt friande des ces apartés sentimentales. Cependant l’une d’entre elles m’a ennuyée, voire agacée au fil des épisodes. Si le triangle amoureux entre Stockholm, Denver et Manille ne m’a jamais passionnée ; j’ai fini par m’en désintéresser totalement. Le stress post-traumatique de Stockholm et les états d’âme de Denver les isolent du reste du groupe et ne sont pas particulièrement bien écrits. Malgré cela, il est toujours appréciable de voir les braqueurs interagir ensemble, se disputer lorsqu’il le faut, mais aussi et surtout veiller les uns sur les autres.
Sans grande surprise, j’ai été particulièrement transportée par les flash-back mettant en scène Berlin. L’ancien braqueur est suffisamment imprévisible pour nous surprendre, après toutes ces années. Son interprète lui-même, Pedro Alonso, le considère comme une « poupée russe ». Soyons honnêtes, les scénaristes de La Casa de Papel ont toujours regretté d’avoir tué Berlin, ce qui explique l’omniprésence des flash-back. Il s’agit d’un fan service ayant le mérite d’enrichir le lore de la série et, par-dessus tout, d’expliquer de manière plus ou moins explicite, l’action principale. Accessoirement, ils sont aussi annonciateurs du spin-off prévu par Netflix, sur Berlin. Dans cette partie finale, les flash-back permettent d’aborder une autre facette des relations familiales, que je ne peux décemment expliquer sans divulgâcher l’intrigue, mais qui a une importance cruciale pour certains rebondissement inattendus.
S’appesantir sur les émotions des personnages, c’est aussi un moyen de les montrer sous différents jours. Pour ce qui est de présenter un protagoniste détestable, puis plus humain, la série n’en est pas à son coup d’essai. Il s’agit même d’un coup de maître en ce qui concerne Alicia Sierra. La policière en vient à partager une réelle alchimie avec le Professeur, sans pour autant devenir une copie paresseuse de Lisbonne. Finalement, chaque personnage se retrouve là où il devait être, et c’est là le signe d’un épilogue réussi.
De Clark Kent à Superman
Aussi surprenant que cela puisse paraître, j’ai aussi envie de considérer La Casa de Papel comme une histoire de super-héros. Et ce justicier masqué, c’est le Professeur. Le Professeur a souvent été comparé à Clark Kent, par les créateurs de la série ; et pas seulement à cause de ses lunettes ! Son interprète, Álvaro Morte, confie lui-même avoir particulièrement travaillé la gestuelle et la posture de son personnage. Habituellement, le Professeur avançait de manière gauche, penchée et repliée sur lui-même. Réservé de nature, il a toujours eu quelque chose à dissimuler aux autres, voire à lui-même. Dans cette partie finale, nous assistons à sa métamorphose. Pour la première fois, le Professeur se tient droit et avance sans ciller. Non seulement il est redoutable, car il a la faculté de se soustraire aux pires situations, in extremis, mais il ne tremble pas face à l’adversaire. Le Professeur n’a pas besoin de retirer ses lunettes ni d’endosser une cape (ou une combinaison) rouge, pour devenir L’homme d’acier. L’évolution du personnage est époustouflante et laissera, forcément, un souvenir impérissable.
Mais ce qui est appréciable, c’est qu’il n’est pas idéalisé pour autant. En reconnaissant qui il est, le Professeur admet enfin qu’il n’est pas vraiment un résistant luttant pour de justes causes. Il reconnaît qu’il est l’héritier d’une dynastie de voleurs et qu’il agit par l’amour de l’or et surtout du défi. C’est très important car la série devenait parfois confuse quand il s’agissait d’aborder les messages défendus et véhiculés par le gang. Les voleurs étaient de plus en plus glorifiés, au contraire d’une police ridiculisée, voire diabolisée.
Les policiers n’ont pour autant pas le bon rôle dans cette dernière partie. J’ai toujours considéré le Colonel Tamayo, le chef des opérations, comme un personnage grotesque et vulgaire. Une attitude hyperbolique entièrement recherchée par son interprète, Fernando Cayo. Parfois détestable, parfois drôle malgré lui, le personnage n’incarnait plus une réelle menace pour les braqueurs. Au reste, il m’a agréablement surprise. Bien que Tamayo n’en soit pas toujours le responsable direct, le plan du Professeur est menacé à plusieurs reprises. On en vient à ressentir la pression éprouvée par les personnages. Et bien qu’il ait toujours l’air sur le point d’exploser, (pour l’anecdote, Fernando Cayo s’est notamment inspiré de la gestuelle de Colère, dans Vice-Versa), le colonel Tamayo tient bon jusqu’au dernier arc, dans lequel il entreprend un réel bras de fer avec le Professeur. C’est de cette rivalité entre deux camps que naît toute la tension de la série.
La quête de l’impossible rêve
La Casa de Papel est l’étrange mariage entre une histoire familiale et une bataille épique. Mais le dernier ingrédient de la série, celui qui la rend unique, c’est son héritage des romans picaresques espagnols, comme Don Quichotte. Il est fréquent que les personnages, en particulier le Professeur, se retrouvent dans des situations tout à fait improbables, qui entretiennent la tendance héroï-comique de la série. La Casa de Papel n’a jamais eu pour vocation d’être une série réaliste. Il est toutefois heureux que ces épisodes finaux évitent la surenchère à outrance qui caractérisait notamment le dernier volume. On pourrait aussi considérer la série comme une histoire romantique, au sens étymologique du terme. L’écriture des personnages est très lyrique. La plupart sont dominés par leurs élans sentimentaux, même quand tout menace de s’écrouler autour d’eux. Le Professeur et Palerme tiennent après tout à réussir le braquage, pour finir leur deuil, après la mort de Berlin. Le romantisme se définit aussi par la quête de l’impossible. Comme le Chevalier à la triste figure, les braqueurs s’évertuent à réaliser l’improbable. Mais ce qui les caractérise le plus, c’est l’optimisme. En dépit des moments de doute ou de certaines pertes douloureuses, La Casa de Papel est et restera une série incurablement optimiste.
Conclusion
Un peu refroidie par la première moitié de cette saison finale, je n’étais pas certaine d’apprécier le dénouement de La Casa de Papel. Force est de constater que ces derniers épisodes m’ont remémoré tout ce qui m’a fait aimer la série : des personnages bien écrits et des relations travaillées, une mise en scène spectaculaire et épique, digne d’un grand tour de magie, mais aussi un côté pittoresque et lyrique. Il n’est pas aisé de terminer une série d’une telle ampleur, mais je pense que le pari est tenu. Nulle question n’est restée en suspens, et aucun désagrément n’est venu gâter mon visionnage, à l’exception de défauts somme toute mineurs. Si j’ai un regret, c’est que l’épilogue ne soit pas plus long, ou que certains personnages soient restés en retrait, mais c’est incontournable lorsque nous quittons une œuvre que nous aimons. Comme toujours, il est probable que la fin divise les fans de la série ; elle n’en demeure pas moins logique. Une fois rachetée par Netflix, La Casa de Papel n’a pas toujours égalé les prouesses des premières parties. Elle finit toutefois en apothéose, et restera, à mon sens, l’une des séries les plus incontournables dans les années à venir. Pour en savoir plus, je vous invite vivement à visionner le documentaire « De Tokyo à Berlin », disponible sur Netflix. Una mattina, mi sono alzato…
- Toutes les saisons de La Casa de Papel sont disponibles sur Netflix.