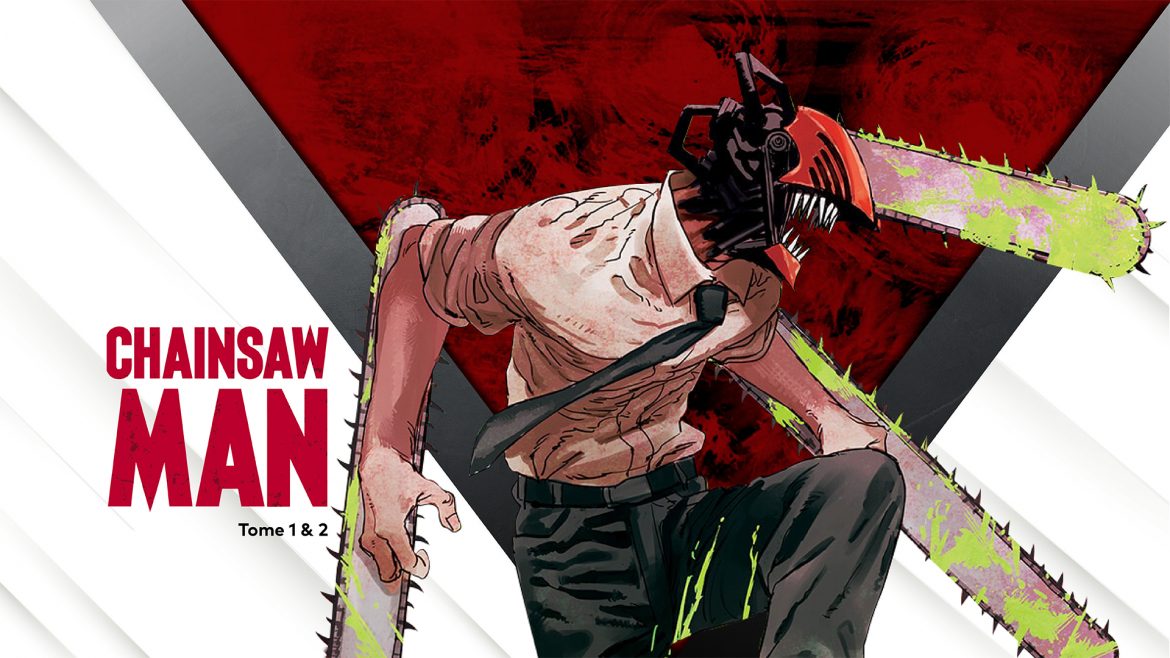Au vu de mes articles sur Pod’Culture, on se rend compte que j’ai une légère préférence pour le genre du survival horror. C’est donc avec une certaine curiosité que je me suis lancée dans In Sound Mind, jeu d’horreur psychologique produit par le studio We Create Stuff, édité par Modus Games et sorti le 28 septembre 2021. Il semblait promettre une aventure empreinte de psychologie tout en laissant une place importante à la musique, composée par The Living Tombstone, qui a également œuvré sur la bande originale du jeu Five Nights at Freddy’s.
Ce test a été rédigé suite à l’envoi d’une clef Xbox Series S par l’éditeur.
Âmes en errance dans des mondes personnifiés
In Sound Mind débute avec Desmond Wales, thérapeute vivant à Milton Haven, et dont on pourrait croire qu’il se réveille d’un lendemain de cuite. Pour cause, il se retrouve au sous-sol de son immeuble, incapable de se souvenir comment et pourquoi il est arrivé là. Et les choses commencent déjà à être inhabituelles, puisque son immeuble n’est plus le même : empli de portes fermées à chaque couloir, de caisses et produits chimiques étranges – tandis qu’à l’extérieur, la ville semble prise dans une terrible inondation. En rentrant dans son cabinet, Desmond constate que son ancien animal de compagnie a également ressuscité. Et un mystérieux homme le contacte par téléphone, parlant d’anciens patients qu’il n’aurait su aider par le passé. Poussé par la culpabilité, Desmond doit alors retrouver chaque cassette d’enregistrement de séances avec ses patients, et plonger dans leur esprit pour essayer de les sauver…
Car chaque cassette mène en effet à un monde différent, reflet de l’esprit du patient enregistré. Chaque univers débute dans la maison du patient, laissant entrevoir sa personnalité et ses problèmes, avant de basculer totalement dans leur psyché. L’enregistrement de Virginia nous mène à explorer un supermarché obscur et labyrinthique, où une spectre n’hésitera pas à tuer Desmond si celui-ci la regarde. La cassette d’Allen nous mène dans un monde balnéaire surplombé par la lueur rouge d’un phare, tandis que celle de Max nous entraîne dans une usine mécanique à la tonalité jaune. Si les graphismes ne sont pas aussi beaux et réalistes que ceux d’autres jeux next-gen, loin de là, ils nous immergent tout de même dans une tonalité distincte à chaque cassette. Chaque lieu est évidemment symbolique, et In Sound Mind a créé pour chaque protagoniste un monde bien distinct. Les couleurs et les motifs, tous différents, évoquent divers décors et objets – un phare, les écrans d’un supermarché, des rails de chemin de fer – qui sont liés tant au passé du patient qu’à leurs traumatismes psychologiques. L’idée est bonne, mais sans doute aurait-on aimé une immersion encore plus poussée, avec davantage de détails ici et là, et des mondes aux structures moins répétitives.
En effet, l’un des intérêts de In Sound Mind est d’évoquer des sujets psychologiques tout en les liant à son aspect horrifique. Le jeu aborde ainsi divers problèmes mentaux comme l’agoraphobie, l’achluophobie, ou la colère autodestructrice. Pour ne prendre que la première cassette sans spoiler les autres, l’univers de Virginia représente ainsi le supermarché où elle a dû essayer de vaincre son agoraphobie, un nouveau lieu où elle est également obligée de s’exposer au regard des autres, chose qui la terrifie depuis un accident survenu dans sa vie. On y croise des miroirs que le fantôme s’empresse de briser, des télévisions évoquant la surveillance… Et l’une des armes qu’on y ramasse est un éclat de miroir qui sert ensuite à révéler des choses cachées, ou à se défendre. Ce sont des décors, des mécaniques qui se retrouvent ensuite dans les mondes suivants, chacun apportant un nouveau mécanisme, une nouvelle arme – étoffant l’inventaire composé initialement d’un pistolet et d’une lampe-torche.
Notes discordantes dans le noir
A travers ce fil narratif, on trouve ainsi quelques tropes des jeux de survival horror – la lampe-torche, les mondes changeant selon l’esprit du patient visité – et In Sound Mind coche en effet de nombreuses cases du genre. Pourtant, rassurez-vous, vous n’aurez guère peur dans ce jeu horrifique, ni par l’ambiance, insuffisamment oppressante, ni par les screamers qui n’ont rien de bien original. Tout au plus, vous aurez une petite seconde de surprise en voyant le mystérieux homme du téléphone passer, puis s’évanouir derrière vous, ayant bloqué le chemin précédent ; et une vague seconde de tension en croisant des mannequins bougeant mystérieusement (mais vous avez déjà vu ça dans Layers of Fear 2 ou Resident Evil VII). On croise des monstres composés d’encre (comme les taches de Rorschach) qu’on peut fuir ou combattre, les boss de chaque monde, tous uniques, nous obligent à nous cacher et à les fuir avant de pouvoir les affronter véritablement. Ils sont à la fois la personnification du traumatisme de chaque patient, mais aussi le patient lui-même.
Face à ces ennemis, Desmond peut compter, très classiquement, sur des armes récupérées en cours de route qui vont du pistolet au fusil, en passant par la fusée de détresse ou des produits chimiques explosifs. Il peut également trouver, en plus des soins, des pilules permettant d’augmenter ses capacités de furtivité, d’endurance, de force, etc. Le jeu incite donc à fouiller les moindres recoins et à se montrer acharné.

© In Sound Mind, We Create Stuff, Modus Games, 2021
Car il faut aussi beaucoup de persévérance pour avancer dans le jeu. Si ce dernier se montre classique dans le genre du survival horror, tout en créant sa propre histoire, y progresser n’est pas chose aisée. Lors de ma partie, j’ai plusieurs fois buté sur une difficulté majeure : le level design qui n’était pas assez clair pour m’indiquer où et comment je devais aller pour avancer dans le jeu. J’ai été contrainte de faire des nombreux aller-retour, de peiner dans diverses pièces avant de trouver ce que je devais faire, parfois au bout de très, très longues minutes. Une chose qui n’est pas aisée quand on est en plus poursuivi par un boss temporairement invincible et qui nous fait mourir au milieu de nos recherches. Cela a rendu certains moments infernaux, voire désespérants, au point de me faire augmenter la luminosité du jeu au maximum lors d’un passage avec le boss du deuxième monde, incapable de voir par où je devais m’enfuir ; puis de faire basculer le mode normal en mode facile. Et ne parlons pas des énigmes qui sont carrément tirées par les cheveux par moments – où là aussi, j’ai fini par céder à aller voir la soluce après de longs moments de recherche frustrante.
Tous les points précédents ont fini par mener à une saturation tout au long de ma partie…que je n’ai d’ailleurs pas achevée. Je me suis arrêtée au tout début de la quatrième cassette, après 16h de jeu, In Sound Mind pouvant être terminé en une douzaine d’heures. Tout simplement parce que l’absence de repères pour me guider et trouver quoi faire, devenait de plus en plus insupportable à chaque niveau. Pourtant les mondes sont globalement basés sur la même structure : visite de la maison du patient, chemin en plate-forme, puis monde légèrement plus ouvert avec différentes zones où le boss nous poursuit la moitié du temps, retour au chemin en plate-forme. Les nombreux moments à tourner en rond, à mourir en boucle à cause des boss alors que je cherchais juste quoi faire, sans compter une précision de gameplay plutôt moyenne (surtout pour les sauts) sur console, ont fait que j’ai fini par lâcher le jeu après d’énièmes morts. Même la petite récompense à la fin de chaque univers ne servait plus à me motiver.
La musique n’adoucit pas toujours les mœurs
Car dans In Sound Mind, il y a « sound » pour une raison bien spécifique. La musique est composée par The Living Tombstone, et si, honnêtement, je n’ai pas retenu les musiques d’ambiance du jeu, la récompense de chaque niveau est de pouvoir entendre le vinyle personnalisé de chaque patient. Grâce aux capacités acquises lors du monde précédent, Desmond peut en effet accéder à des pièces auparavant inaccessibles et récupérer le vinyle du patient, pour l’écouter dans son cabinet. Quatre airs reflétant les états d’âme du personnage, ses tourments, dans un style bien propre à chacun : de la chanson éthérée au morceau de jazz entraînant (Bottom of the Pit, ma favorite), en passant par une chanson métal. C’est là l’une des meilleures idées du jeu.
Bien sûr, je ne saurai jamais l’identité du mystérieux homme qui traque Desmond, pas plus que je ne verrai la fin d’un jeu qui ne m’a pas beaucoup surprise, en tant que fan du genre horrifique. Mais aller jusqu’au bout aurait été un acharnement qui m’aurait fait oublier les quelques qualités du jeu, déjà presque perdues de vue face aux défauts de level design, de gameplay et des nombreuses morts en boucle, qui ont vite pris le pas sur tout le reste durant ma partie. In Sound Mind propose quelques bonnes idées, mais est demeuré une déception et surtout un jeu aux mécanismes extrêmement frustrants.
- In Sound Mind est disponible depuis le 28 septembre 2021 sur PC, Xbox Series, PS5, et prochainement sur Nintendo Switch.