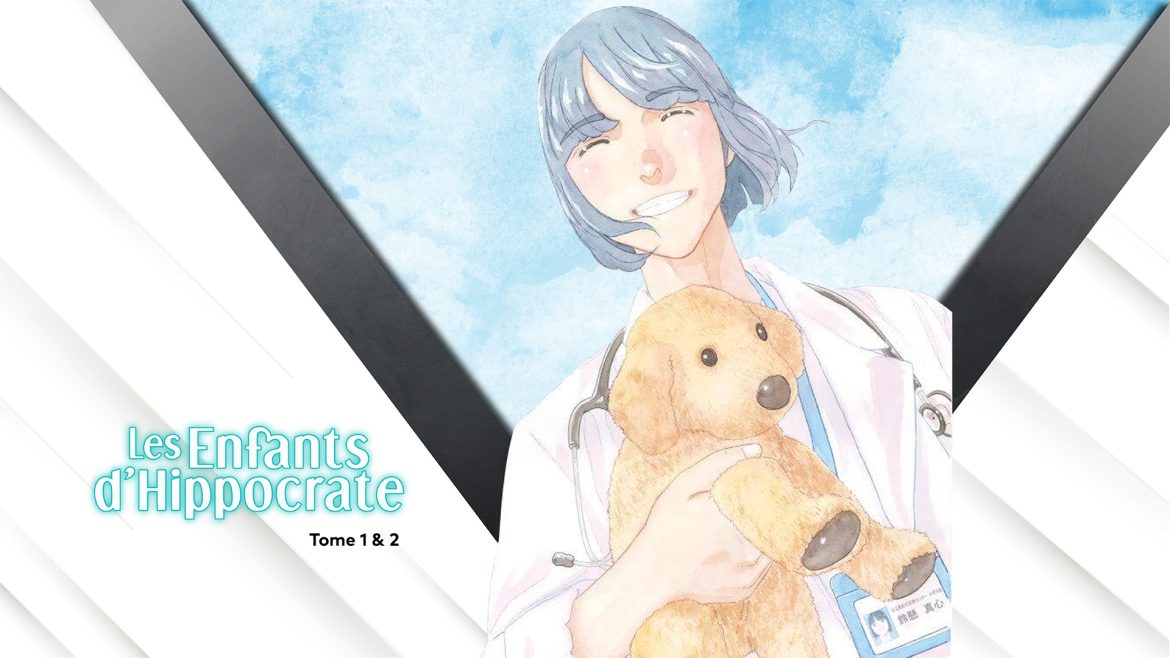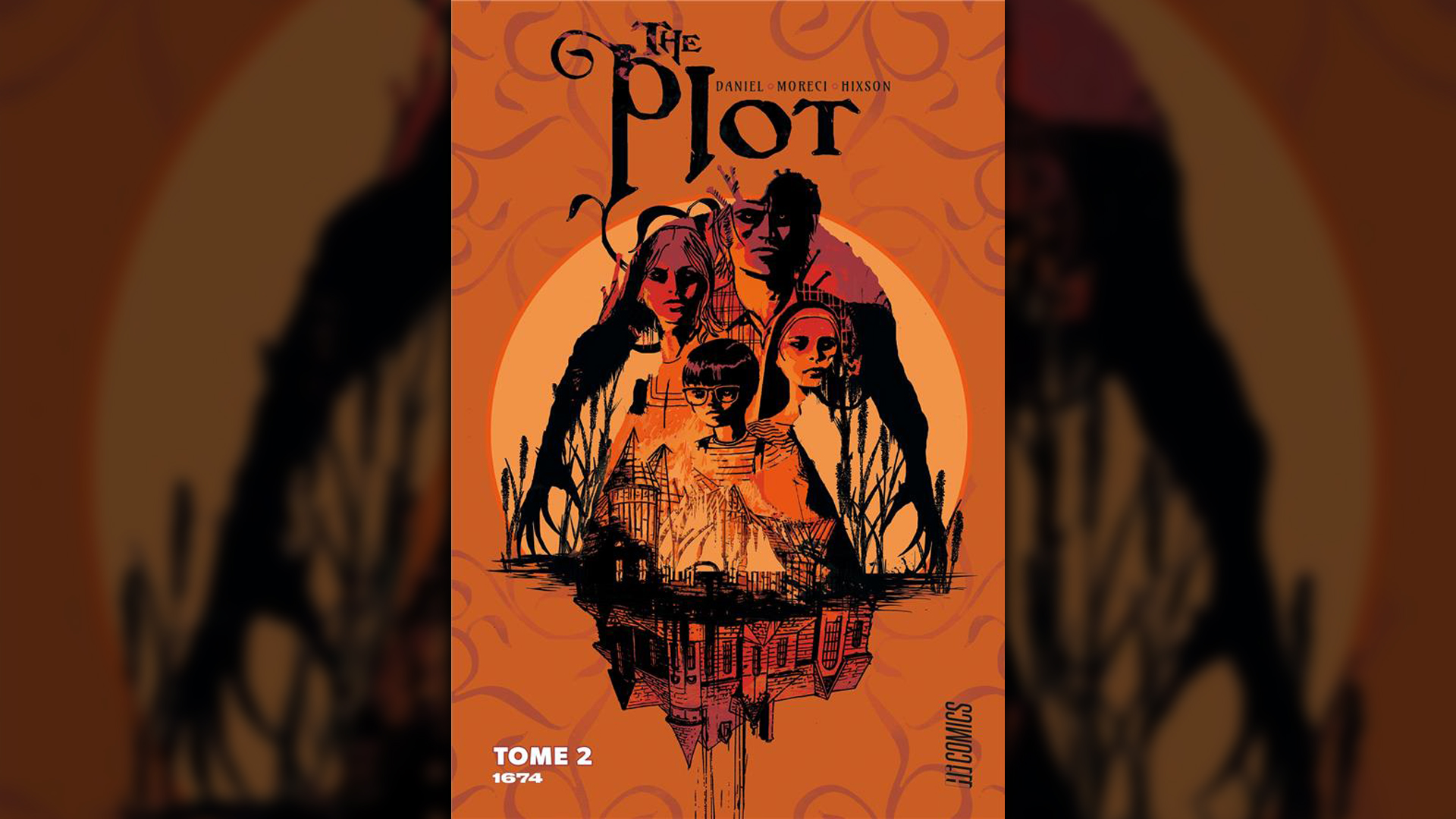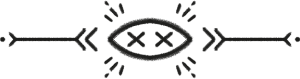Silt est le tout premier jeu du petit studio indépendant Spiral Circus, situé à Bristol. Le studio est composé de quatre personnes : les deux fondateurs, Tom Mead et Dom Clarke, ensuite rejoints par Antonenko Anto et Nick Dymond. Et dès le lancement du titre, Silt (limon en anglais) nous fait plonger dans les profondeurs abyssales de l’océan, nous laissant incarner un plongeur vulnérable face à des créatures surréalistes. L’aventure sous-marine vaut-elle le détour ?
Ce test a été rédigé suite à l’envoi d’une clef Xbox Series S par l’éditeur.
Un jeu dans la lignée de Limbo et Inside

© Silt, Spiral Circus Games, 2022
En débutant le jeu, il est difficile de ne pas penser aux jeux indépendants Limbo et Inside. Silt possède la même tonalité monochrome, toute en nuances de noir, gris et blanc, conférant à l’univers une ambiance inquiétante et mystérieuse. D’ailleurs, le gameplay du jeu en est très proche : notre plongeur passe de tableau en tableau, devant résoudre des énigmes ou échapper aux créatures sous-marines l’attaquant. Plusieurs passages nécessitent un certain doigté, et aussi de mourir plusieurs fois avant de comprendre où on doit en venir pour atteindre le tableau suivant.
Silt, à l’instar d’autres jeux ayant inspiré ses créateurs (de Little Nightmares à Limbo, sans oublier David Lynch ou Junji Ito), se révèle également cryptique, laissant le·la joueur·se déchiffrer l’histoire du jeu par son environnement et ses phases de gameplay. Le seul indice narratif est donné au tout début : le personnage doit traquer et éliminer les Goliaths, afin de pouvoir ensuite réveiller la Grande Machine, puissance de vie dans ces eaux sombres. Le scénario du jeu tient donc en une phrase et ne nous explicitera pas plus son univers, nous laissant naviguer dans ses eaux sépulcrales. Notre personnage est solitaire, attaché par une chaîne. Un rai lumineux sortant de lui, lui permet de posséder un piranha dont les mâchoires brisent la chaîne. Alors, le plongeur débute son chemin, sortant de la gueule d’un monstre marin… et s’engouffrant dans un labyrinthe aquatique peuplé de merveilles et de créatures étranges. Car la surface est bien trop loin pour l’instant.
Ici une ville enfouie, là de nombreuses statues d’animaux anthropomorphes et intimidantes, comme des divinités oubliés, et puis là-bas les silhouettes fantomatiques d’autres plongeurs comme nous. Des collectibles, certes, mais qui font se demander si d’autres plongeurs ont perdu la vie dans la même quête que nous…
Une exploration silencieuse et lugubre

© Silt, Spiral Circus Games, 2022
Ainsi, les quelques heures du jeu se résument à une nage aux sons étouffés, où la quasi-absence de bande-son évoque l’assourdissement des sons sous l’océan. De quoi rendre la surface encore plus lointaine qu’elle ne l’est déjà, d’autant que notre plongeur ne dispose que d’une lampe frontale pour éclairer son chemin. C’est par cette même lumière que nous pouvons admirer le soin apporté à la direction artistique du jeu. Les décors, créatures marines, rouages sombres peuplant Silt sortent tout droit de l’imagination de Tom Mead, dont les illustrations évoquent à la fois le surréalisme, les dessins de Tim Burton ou encore l’art de H.R. Giger (Alien). Son site personnel démontre toute l’imagination sombre et ahurissante dont il est capable. De quoi donner quelques cauchemars mais en même temps… c’est simplement fascinant.
La direction artistique de Silt est à la fois lugubre et belle, détaillée avec une profusion de soin (il fallait même empêcher l’artiste de rajouter trop de tentacules ici et là), hantée par un clair-obscur organique qui met inévitablement mal à l’aise. L’ambiance est vraiment réussie, nous plongeant dans les profondeurs de l’océan avec toute la splendeur qu’il peut révéler, mais aussi en évoquant la thalassophobie héritée de son dessinateur.
Mais Silt ne se hasarde pas à être une copie de Limbo version sous-marine. Le jeu dote le plongeur d’une mécanique qui va lui permettre d’agir indirectement sur son environnement : la possession. Tout au long de l’aventure, il peut être amené à posséder des anguilles extrêmement rapides et électriques, des piranhas pouvant croquer des lianes, des raies se téléportant de quelques mètres, des méduses explosives… Et la possession peut se faire d’une créature à l’autre ! Si notre plongeur est en lui-même très vulnérable, car lent et sans moyen de se défendre, c’est en possédant ces divers animaux qu’il peut résoudre les puzzles sur son chemin, créer de nouveaux passages et surtout vaincre les Goliaths.
Quatre boss croiseront en effet notre chemin et offriront des combats incitant à utiliser l’environnement ou les créatures présentes pour les vaincre. Il faudra donc un peu de jugeote et de logique, quitte à piétiner parfois sur certaines énigmes pas évidentes, ou surtout mourir sur certaines phases délicates au niveau des mouvements du personnage. La patience est de mise dans cette aventure. Heureusement, en cas de mort, le jeu nous ramène automatiquement au début du tableau.
L’originalité d’une atmosphère surréaliste

© Silt, Spiral Circus Games, 2022
Silt a sans doute des défauts de premier jeu et quelques bugs mineurs, quoique le gameplay en soit bien maîtrisé et le cheminement assez logique. Par sa proximité avec Limbo, il ne marque sans doute pas autant la mémoire que s’il avait été le premier jeu de ce type dans le monde du jeu vidéo. Il a de quoi faire passer un bon moment, tout en manquant d’un je ne sais quoi qui le rendrait véritablement mémorable. L’histoire est après tout cryptique et (trop?) courte, peut-être manquant d’un sous-texte de lecture surtout ; certains mécanismes peuvent se révéler répétitifs, mais l’ensemble est loin d’être désagréable.
Là où il dénote le plus, c’est bien par la beauté de son univers, aussi obscur soit-il. L’aspect dessin à la main des décors confère un aspect unique, organique et donc assez dérangeant lors de l’exploration : on se sent mal à l’aise, oppressé, et il n’est pas étonnant que le jeu ait été une catharsis pour Tom Mead de sa peur des espaces marins. Qui ne serait pas angoissé par des profondeurs aussi abyssales, où la lumière disparaît ? Et pourtant, quand enfin la lumière se fait sur certains passages, illumine les décors, on ne peut s’empêcher de trouver une beauté macabre à l’ensemble.
Les fois où nous sommes à l’intérieur de la Machine, le décor a beau être un peu familier, il n’est pas moins effrayant non plus. Les bibliothèques et escaliers, abandonnés et déserts, se dressent au milieu des statues animales anthropomorphes, qui là encore déstabilisent et dérangent. Pourquoi sont-ils là ? Que représentent-ils ? L’extérieur, avec ses créatures aquatiques étranges, ses boss hybrides entre serpent, fleurs, tentacules, anguilles, ou encore certains tableaux (l’arbre où il faut donner aux « hommes-oiseaux » à manger pour qu’ils s’envolent et le déracinent) ont vraiment un côté surréaliste perturbant, entre familiarité et détournement de celle-ci. On se demande même si l’on n’est pas tombé dans un des cauchemars de Lovecraft, lui dont l’œuvre est peuplée d’étranges divinités et entités souterraines, qu’il vaut mieux ne pas réveiller…
Conclusion
Silt se base sur les mêmes mécaniques qu’un Limbo, alternant combats, puzzles et découverte d’un environnement monochrome. Il faudra un peu de patience pour réussir les passages les plus délicats, et accepter de réfléchir, tenter des choses, mourir et recommencer plusieurs fois. On peut regretter qu’il manque le « quelque chose » qui en aurait fait un jeu marquant, mais qui se trouvera sûrement dans les prochaines productions mûrissantes du studio. Mais là où le jeu brille, c’est par sa direction artistique : l’originalité du décor, cette impression de plonger tout au fond des profondeurs océaniques, éloigné de la lumière et de toute vie, d’arpenter des abysses peuplées d’étranges créatures et coraux. Silt réussit à nous happer dans cet étouffement sous-marin avec une atmosphère presque silencieuse, envoûtante, avec un clair-obscur aussi miroitant qu’inquiétant. Comme une plongée dans un cauchemar surréaliste qui, heureusement, finira par se dissiper, et dont le héros se réveille peut-être…
- Silt est disponible sur PC, Xbox Series X/S, PS4/PS5 et Switch, depuis le 1er juin 2022.