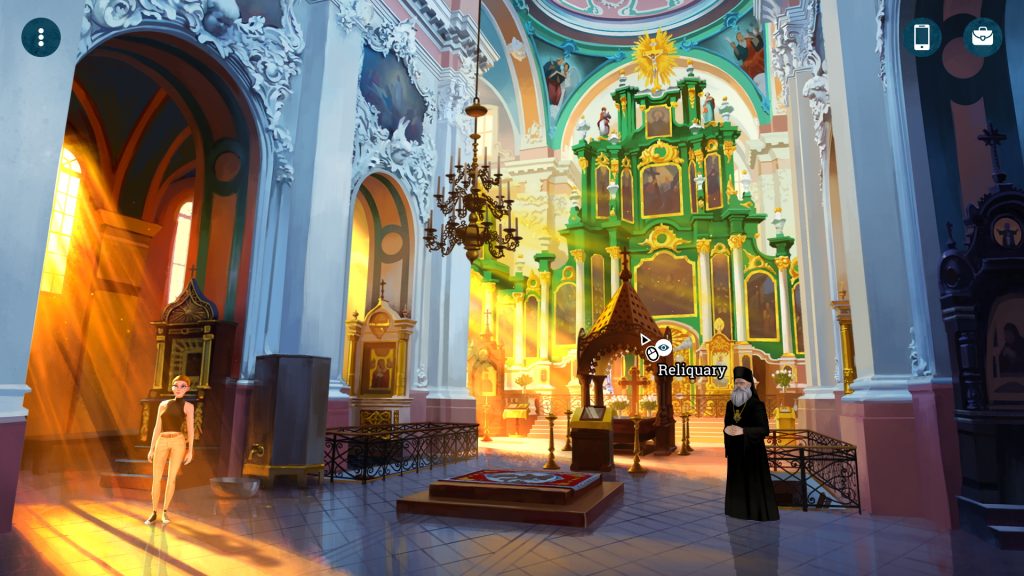Nous sommes en 2022, sur ce site je vous ai parlé en long, en large et en travers de tout le travail publié en France, de Tatsuki Fujimoto. Tout ? Non ! Un travail de cet irréductible mangaka a résisté aux différentes chroniques que j’ai pu en faire. Et la vie n’est pas facile tant que je n’avais pas découvert les histoires courtes qu’a pu faire Fujimoto entre ses 17 et 26 ans, d’où les titres des mangas. Cependant, l’idée de sortir ces histoires sous un format anthologique est arrivée. C’est ainsi que naquit 17 -21 Anthologie (et je vous parlerai de 22 – 26 Anthologie lors de sa sortie en France) publié aux éditions Kazé.
En revanche, étant donné que nous ne sommes pas sur une histoire continue, mais sur des histoires courtes qui n’ont aucun lien les unes entre les autres, l’intérêt principal de cette anthologie est donc l’analyse de l’œuvre de Fujimoto. Comprendre et voir d’où viennent ses inspirations pour ses mangas qui ont été publiés par la suite, et surtout se rendre compte que ce type est fantastiquement barré et ce depuis le début !
Cette critique a été écrite suite à l’envoi d’un exemplaire par son éditeur.
4 Histoires et des motifs déjà présents
S’il y a un bien un motif qu’utilise Fujimoto et qui est reconnaissable dans toutes les histoires qu’il écrit, c’est celui de son protagoniste. Toujours un rebut de la société, marginal à l’extrême, un espèce de looser magnifique, qui malgré la naïveté dont il fait preuve, devient un héros malgré lui. Car ce dernier est toujours plongé dans une aventure qui le dépasse, que ce soit à un niveau humain, où galactique.
Sur ces 4 histoires, il y a un extraterrestre qui ne souhaite pas manger les humains à contrario de ses semblables. Un jeune homme suffisamment amoureux de sa professeur pour sauver toute une classe malgré le danger imminant. Un autre jeune homme qui veut avouer ses sentiments amoureux, et sauve notre planète malgré la vicissitude dont il fait preuve. Et enfin un vampire qui s’ennuie à cause de sa trop longue vie et va retrouver un intérêt grâce à un personnage féminin haut en couleur, qui n’est pas sans rappeler une certaine autre jeune femme…
Rien que déjà avec ces courts résumés d’histoires, on retrouve tout ce qui est cher et important à Fujimoto. Comme je le disais plus haut, un héros marginal, mais surtout des aspects de la vie qui peuvent parler à beaucoup d’entre nous. Entre la recherche de l’amour sans vraiment comprendre ce qu’est l’amour, et ce que cela apporte réellement. L’ennui du monde dans lequel on vit. Et la dépression latente que les personnages subissent, et ne jugent pas être suffisamment importante pour faire ce qu’il faut, afin de se soigner.
« Parce que la vie c’est de la merde, que dans la vie au début on naît, à la fin on meurt et entre les deux il se passe rien »
[Bref – Épisode 80 : Bref, j’ai fait une dépression]
Mais malgré tous ces thèmes abordés, il y a une certaine quiétude. Les personnages peuvent souffrir, mais passent très vite à autre chose, ou en tout cas, ne se laissent pas abattre par les difficultés de la vie. Et je crois que c’est ça qui me fascine autant avec ce mangaka. Il ose parler de sujets compliqués, le tout assez frontalement, mais malgré ça, il y a toujours cette lueur positive. À contrario d’Inio Asano dont j’aime énormément le travail, mais qui se trouve être de l’autre penchant, à proposer des histoires déprimantes, et qui vont jusqu’au bout de la dépression, Fujimoto au contraire va profiter de ses personnages naïfs pour toujours apporter une conclusion si ce n’est satisfaisante, positive.
C’est assez fou de se dire que Fujimoto, avait déjà ces motifs d’écriture dès 17 ans. Rien d’étonnant donc de le voir performer aujourd’hui avec des œuvres comme Fire Punch ou encore Chainsaw Man, et en plus il se permet de révolutionner le shonen tel qu’on l’entendait il y a encore quelques années. Il apporte un coup de fraîcheur au genre, qui avait vraiment besoin de se renouveler et ce depuis plus de 10 ans déjà. La question qui se pose maintenant est de savoir si cette anthologie a du sens en tant qu’œuvre isolée où s’il est essentiel de connaître l’univers du bonhomme. Et bien je dirais aussi bien l’un que l’autre. Car si on aime ce que propose le mangaka, alors il est évident que ces deux tomes vont plaire aux fans, mais on peut tout aussi bien passer par cette porte d’entrée pour découvrir le monde de Fujimoto et ainsi s’acclimater tranquillement mais avec une passion naissante et certaine pour ce qu’il a pu proposer par la suite.
- Anthologie 17 – 21 est disponible en librairie depuis le 18 mai 2022.