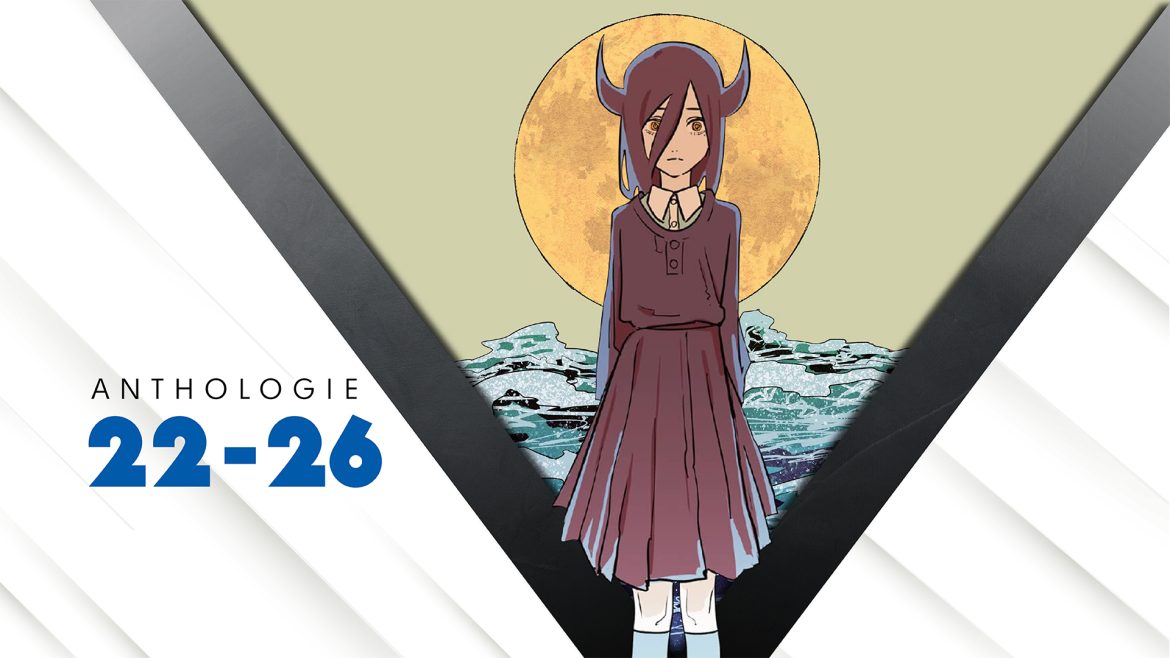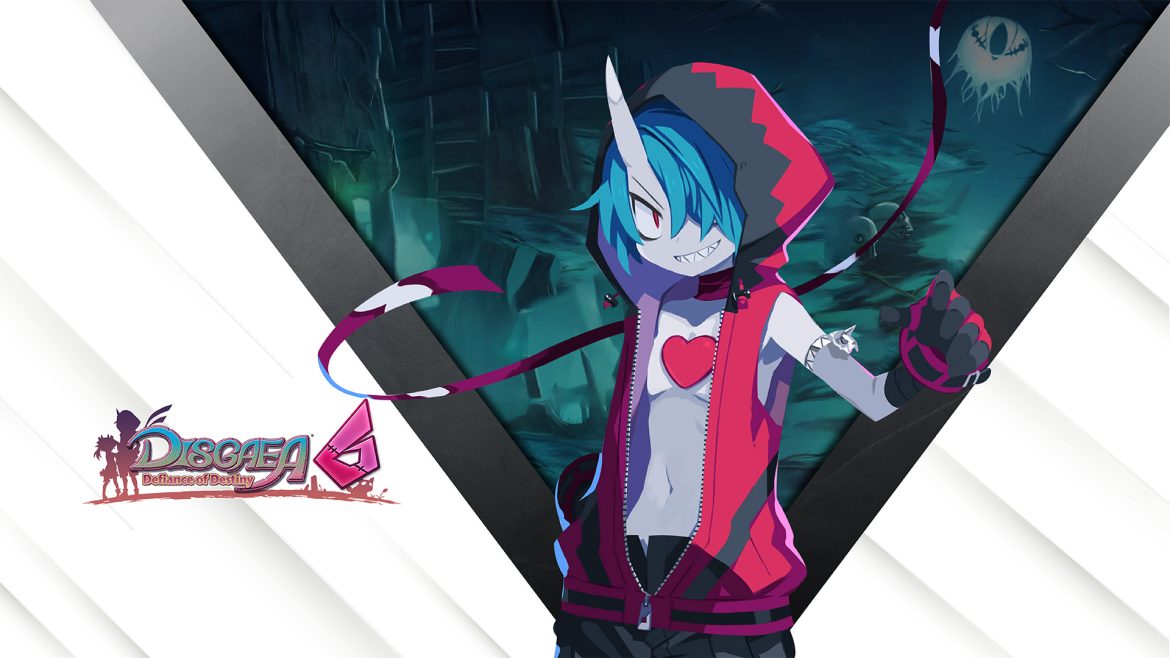Bien avant que J. K. Rowling ne devienne le croque-mitaine de Twitter, Stephen King était le maître incontesté de l’horreur, dans la littérature américaine. C’est avec Carrie (1974) que le romancier débuta une carrière très prolifique. Stephen King n’en doit pas moins une part de son immense popularité au cinéma et à la télévision. Il est l’un des auteurs les plus adaptés au monde, aux côtés de mastodontes tels William Shakespeare ou Agatha Christie. L’exploit est d’autant plus remarquable que l’auteur l’a réalisé de son vivant, alors qu’il est encore en activité. Ce n’est pas une coïncidence pour autant. Il n’est pas rare que Stephen King échange les droits de l’un de ses bouquins contre un dollar symbolique. C’est notamment le cas des Dollar Babies, des adaptations réalisées par des étudiants ou de futurs réalisateurs et réalisatrices. A ce jour, on recense plus de 80 adaptations (officielles) de l’auteur, sur petit ou grand écran. Aussi est-il tout à fait adéquat de parler de Stephen King Cinematic Universe.
Bien que ce ne soit pas toujours le cas, de nombreuses histoires de l’auteur s’entrecroisent où se déroulent dans le même univers. Ses villes de prédilection sont Castle Rock, Derry et Haven, toutes trois fictives et situées dans le Maine. Si le regretté Stan Lee faisait l’objet de caméos, dans la majorité des films du Marvel Cinematic Universe, Stephen King n’est pas avare non plus en matière d’apparitions. Elles lui permettent même de compléter un CV fictif très hétéroclite. Chef d’orchestre dans Shining et avocat dans La tempête du siècle, l’auteur devient livreur de pizza le temps d’une scène de Rose Red, et prêtre dans Simetierre. Il incarne même un jardinier à la main très verte dans Creepshow. Or, cette liste est loin d’être exhaustive. Il n’est pas rare non plus de retrouver les mêmes comédiens ou réalisateurs, dans plusieurs adaptations du SKCU. Rob Reiner réalisa Stand by me et Misery tandis que Frank Darabont, grand fan de l’auteur, mit en scène Les évadés, La ligne verte puis The Mist.
Le SKCU comprend de nombreux chefs-d’œuvre, demeurant toutefois minoritaires face à une quantité non négligeable de films oubliables voire de véritables nanars. Cet article a pour vocation d’arpenter les thématiques centrales de l’œuvre cinématographique de Stephen King, avec le moins de spoilers possibles ; mais aussi de ne conseiller que le haut du panier, (bien que certaines pommes pourries puissent parfois servir d’exemples intéressants ou amusants). Il va de soi qu’il s’agit d’un point de vue subjectif, et d’autant plus biaisé que je n’ai pas eu l’occasion de voir l’ensemble des adaptations. Certaines sont aujourd’hui très difficiles à trouver, quand d’autres sont des séries dont le visionnage aurait été trop chronophage. Mais qui sait ? Nous nous retrouverons peut-être dans quelques (dizaines) d’années pour une étude complète de l’œuvre audiovisuelle et littéraire de Stephen King ?
Les leitmotivs de Stephen King
Bien qu’il soit considéré comme un maître de l’horreur, Stephen King – qui écrivit parfois sous le nom de Richard Bachman – est aussi l’auteur de récits plus réalistes et humanistes. Il n’en demeure pas moins un grand amateur de récits angoissants et fantastiques, dans lesquels les forces antithétiques du bien et du mal s’affrontent inexorablement. L’auteur se nourrit de son quotidien ou d’angoisses très personnelles pour donner vie à des archétypes de personnages. De nombreuses histoires dénoncent les excès de la religion, la nouvelle technologie ou encore l’addiction. Comme de nombreux auteurs avant lui, le romancier se nourrit de la réalité pour donner vie à ses monstres et engendrer la peur. Aussi violentes ses œuvres soient-elles, il reste convaincu de leur effet cathartique. Les lecteurs et spectateurs ont besoin de cette décharge émotionnelle. Et ce n’est pas cela qui les incitera à se montrer violents dans la réalité, comme se plaisent souvent à le stipuler les médias. Malgré tout, Stephen King demanda à son éditeur d’arrêter la publication de l’un de ses premiers ouvrages, en 1999. Il s’agit de Rage (1977), dans lequel un lycéen tue sa prof de maths avant de prendre sa classe en otage. A la fin des années 80 et dans les années 90, quatre tueurs de masse différents auraient eu Rage en leur possession avant de commettre l’impensable dans leur école respective. Suite à la fusillade du lycée Columbine, l’auteur renonça définitivement à ce récit. L’œuvre de Stephen King aborde des thèmes douloureux, avec parfois beaucoup de cruauté. C’est peut-être pourquoi nombre d’adaptations en édulcorent des scènes ou le sort de certains personnages. Elle n’en demeurent pas moins le témoignage de la richesse des thématiques chères à l’auteur.
« Le diable et le bon dieu »
A l’instar des récits dont elles sont issues, de nombreuses adaptations sont manichéennes. Elles opposent les forces du mal à celles du bien. Si certains personnages sont profondément bons, d’autres sont des entités purement diaboliques. L’une d’elles est d’ailleurs la première image qui s’insinue de notre esprit apeuré, dès lors que l’on prononce le nom de Stephen King. Sa réputation la précède. A défaut de l’avoir inventé, elle a déclenché de nombreuses vagues de coulrophobie depuis 1986. Elle effraie tellement qu’elle est innommable… Ça terrorisa les enfants des années 90, grâce au téléfilm mettant en scène Tim Curry. En 2017, Bill Skarsgard contribua à la réanimation du clown amateur de chair (très) fraîche, confirmant que les thématiques de King sont indémodables. Ça est bien plus qu’un clown tueur d’enfants. Il est une entité métamorphe dont l’ombre plane sur la ville de Derry et en corrompt les habitants, depuis le fond des âges. Bien qu’elle soit absente des adaptations, il existe dans le roman une force bénéfique équivalente, prenant la forme d’une tortue. Celle-ci reste toutefois très en retrait et n’intervient que de manière indirecte, contrairement à son Némésis.
D’autres antagonistes ressemblent à s’y méprendre au diable. C’est le cas de Leland Gaut (Max von Sydow) dans Le Bazaar de l’épouvante (1994) ou d’André Linoge (Colm Feore) dans La tempête du siècle (1999, le script fut directement écrit pour la télévision). Le premier ouvre une boutique unique, à Castle Rock, dans laquelle les habitants peuvent trouver ce qu’ils désirent le plus. En échange, ils devront rendre un service… Oh, trois fois rien ! Fin manipulateur, Leland Gaut profite pourtant de cette affaire pour retourner les citoyens les uns contre les autres, et faire de la ville un véritable enfer. Pour André Linoge, l’enfer c’est la répétition. « Donnez-moi ce que je veux et je m’en irai, » dit-il, depuis les barreaux derrière lesquels on l’a enfermé. Alors, les habitants de Little Hall finissent par réaliser que ce sont eux qui sont pris en otages sur leur propre île.
Si le diable est une entité puissante, les hommes cruels sont légion dans l’œuvre de King. Il n’est pas toujours question du combat entre le bien et le mal mais parfois d’une lutte des classes. Il est inconcevable d’évoquer les grands antagonistes du SKCU sans mentionner Warden Norton (Bob Gunton). Tandis que plusieurs directeurs de prison se succèdent dans la nouvelle initiale ; Frank Darabont fait le choix judicieux de n’en présenter qu’un seul dans Les évadés (1994). Sous ses apparentes bonnes manières et ses airs dévots, Warden Norton est un homme cupide et impitoyable, qui n’hésite pas à oppresser les détenus ou à bafouer la vérité, pour parvenir à ses fins. Je pourrais aussi mentionner Kurt Dussander (Ian McKellen) dans Un élève doué (1999). Après avoir échappé aux autorités, cet ancien nazi vit paisiblement ses vieux jours, du moins jusqu’à ce qu’il reçoive la visite d’un adolescent pas comme les autres. Le jeune homme commence à le faire chanter : Kurt doit lui raconter les choses les plus sordides auxquelles il a assisté s’il ne souhaite pas être dénoncé. S’ensuit un jeu du chat et de la souris, dans lequel le vieux nazi finit par reprendre le dessus et corrompre une jeunesse déjà bien entachée.
Heureusement, d’autres vieillards ont une influence plus bienfaitrice. C’est le cas de Ted Brautigan (Anthony Hopkins) dans Cœurs perdus en Atlantide (2001). Doté de capacités extraordinaires, il se lie d’amitié avec son jeune voisin, à qui il laissera un souvenir impérissable. Protecteur mais mystérieux, Ted est pourchassé par des « hommes en noir » dont on ne peut qu’imaginer la provenance. Enfin, l’une des figures du bien les plus marquantes est incarnée par un homme dont le nom ne s’écrit pas du tout comme le café. En revanche, les initiales de John Coffey (Michael Clarke Duncan) sont significatives. Dans La ligne verte (2000), ce colosse est condamné à la peine de mort après qu’on l’ait retrouvé auprès des dépouilles de deux fillettes. Les gardiens du pénitencier, menés par Paul Edgecomb (Tom Hanks) le trouvent néanmoins doux comme un agneau. Il semblerait même que John Coffey ait la capacité d’aspirer le mal et les maladies, chez les autres… Oh, et puis il y a Mr. Jingles.
« Huis clos »
Ces luttes manichéennes sont d’autant plus intenses qu’elles se déroulent bien souvent dans un huis clos. C’est là que le mal s’insinue le mieux et que les victimes sont les plus vulnérables. C’est là que la tension atteint son paroxysme. C’est ainsi que de pauvres âmes en peine se retrouvent prises en otage dans une ville, un lieu fermé ou parfois même dans une voiture… Les évadés et La ligne verte prennent place dans une prison, où les personnages sont tenus en étau par leur propre destin…
Le huis clos le plus iconique de l’œuvre de King est certainement l’hôtel de Shining (1980). Ce n’est un secret pour personne : l’écrivain ne porte pas dans son cœur Stanley Kubrick, dont le film culte est très peu fidèle au roman original. Alors que Jack Torrance est d’abord supposé être un homme ordinaire, King regrette que la prestation de Jack Nicholson lui donne l’air immédiatement fou. Elle n’en demeure pas moins aussi marquante que les allées et venues du petit Danny dans les dédales de l’hôtel, ou encore la vision des jumelles se tenant par la main. Comme d’autres adaptations, Shining accuse le coup des années et a beaucoup vieilli. Au reste, il demeure l’un des films les plus iconiques du SKCU. Il témoigne, par ailleurs, de l’affection de l’auteur pour les terrains enneigés hostiles.
Quand les personnages ne sont pas enfermés dans un hôtel, ils deviennent les prisonniers d’un manoir inspiré du Winchester Mystery House, une maison hantée de la Sillicon Valley. Dans Rose Red (2008, script écrit pour la télévision), le professeur Reardon (Nancy Travis) entraîne une équipe de médiums dans un manoir hanté, qui a la réputation de continuer à se bâtir seul. Il s’agissait – comme on s’en doute – d’une mauvaise idée. Quitte à choisir, il vaut peut-être mieux être enfermés dans un magasin… Ou pas. C’est le cas des survivants de The Mist (2007), qui tentent d’échapper à la Brume, ou du moins des choses qui s’y cachent. La boutique devient alors un microcosme reflétant la société et ce qu’on y trouve de pire. The Mist est un film inoubliable grâce au rebondissement final, différent de la nouvelle.
L’espace se rétrécit et nous voilà enfermés dans une seule chambre : La chambre 1408 (2008). L’auteur et chasseur de lieux hantés Mike Enslin (John Cusack) n’écoute pas les mises en garde du directeur de l’hôtel, en pénétrant dans cette chambre qui serait habitée par le diable. Un autre auteur est cloué dans une chambre, et même dans un lit. Il s’agit de Paul Sheldon (James Caan) dans Misery (1991). Le romancier est soigné par une infirmière qui manie le marteau à ses heures perdues. La prestation de Kathy Bates dans le rôle d’Annie Wilkes a tellement impressionné Stephen King qu’il a tout de suite imaginé les traits de la comédienne, lorsqu’il a commencé à écrire l’histoire de Dolores Claiborne. Retenue à son lit par des menottes, cette fois, Jessie (Carla Cugino) fait face à ses propres démons dans le film Netflix (2017) signé Mike Flanagan (The Hauting of Hill House, 1922). Enfin, Donna (Dee Wallace) est enfermée avec son petit garçon dans une voiture, en pleine canicule, pour se protéger du saint-bernard enragé répondant au nom de Cujo, dans un film de 1983.
J’ai, personnellement, eu toujours beaucoup d’affection pour les histoires se déroulant dans un huis clos. Un cadre aussi restreint permet d’accentuer la tension et de se rapprocher des personnages. Ces différentes adaptations sont plus ou moins réussies mais ont du moins le mérite de renouveler les péripéties, en disposant finalement de très peu d’outils.
« Le club des ratés »
Que seraient une bonne histoire ou même un lieu iconique sans des personnages marquants ? Stephen King utilise à foison les mêmes archétypes de personnages, si bien qu’ils nous deviennent familiers. Pour cause, l’auteur s’inspire de ce qu’il connaît voire de ce qu’il a vécu. Avant de commencer à écrire, il regrettait que les romans fantastiques ou gothiques qu’il appréciait tant se déroulent principalement dans l’Europe du dix-neuvième siècle. Stephen King a permis aux Américains moyens du troisième millénaire d’imaginer le pire, chez eux ou au coin de la rue. Ils ne le remercieront sans doute jamais assez pour cela, n’est-ce pas ?
Ce n’est pas un hasard si les personnages principaux du SKCU sont souvent des enfants. Leur imagination est débordante. Ils ont encore la faculté de s’étonner de tout. Mais ils sont aussi des proies vulnérables, tant pour les monstres que pour les parents. Enfin, l’apparition de dons surnaturels chez eux est souvent la métaphore de l’arrivée de la puberté. (Cela est particulièrement évident dans Carrie). Ainsi, il est fréquent qu’une bande de copains s’apprête à affronter l’adversité. On ne présente plus le Club des Ratés, apparaissant dans Ça. Dreamcatcher (2003) met également en scène des amis d’enfance originaires de Derry, avant qu’ils ne soient dérangés par un homme souffrant de… flatulence. Mais la plus belle ode à l’amitié se trouve certainement dans le film Stand by Me (1986), inspiré de la nouvelle Le Corps. Quatre garçons décident de partir à l’aventure pour retrouver le corps d’un enfant, fauché par un train, près de la rivière. Aucun événement surnaturel ou horrifique ne vient déranger ce voyage, ou devrais-je dire ce récit initiatique. Comme dans la nouvelle, le narrateur fait le constat nostalgique suivant : « Je n’ai plus jamais eu des amis comme à douze ans. »
Malheureusement, tous les enfants du SKCU ne disposent pas de pouvoirs comme Carrie, Danny (Shining) ou Annie (Rose Red). Ils constituent des cibles d’autant plus vulnérables pour les croque-mitaines et surtout, les adultes malintentionnés. Stephen King semble avoir une opinion particulièrement négative des pères. Serait-ce parce que le sien l’a abandonné lorsqu’il était enfant ? Jack Torrance est un homme alcoolique qui a déjà battu Danny, par le passé. Le prix des pires géniteurs possibles revient certainement à ceux de Jessie et Selena (Dolores Claiborne). Mais nous reviendrons sur ce dyptique quelque peu féministe plus tard.
Même quand ils ne sont pas maltraités par leurs parents, il n’est pas rare que les enfants connaissent un sort néfaste et possiblement funeste, comme c’est le cas dans Cujo, La tempête du siècle ou Simetierre. Le film Simetierre (de 1989, pas le remake !) est probablement l’un de ceux m’ayant le plus affectée. Le long-métrage de Mary Lambert a vieilli mais demeure oppressant. L’histoire persiste à glacer le sang en abordant l’angoisse la plus sourde et taboue qui puisse nous tordre les entrailles : la perte d’un être que l’on aime et que l’on essaie de protéger. Louis Creed (Dale Midkiff) perd son chat, heurté par un camion. L’un de ses voisins lui conseille de l’enterrer au cimetière des animaux. Le chat sort de la terre et retrouve son foyer. Malheureusement, l’animal de compagnie chéri n’est plus tel qu’il était autrefois… Et puis l’histoire se répète, le petit garçon du couple, Gage, se fait à son tour heurter par un camion…
Les héros de Stephen King peuvent – heureusement – atteindre l’âge adulte. Comme leur créateur, ils occupent régulièrement les professions d’enseignants ou d’écrivains (Shining, Misery, Chambre 1408,…)
« La machine à assassiner »
De nombreuses histoires du SKCU persistent à dénoncer les même travers, si bien qu’on devine que l’auteur a quelques comptes à régler. Il ne fait pas l’ombre d’un doute que King est technophobe et qu’il redoute les engins à roues.
Est-il bien utile de présenter Christine, un film de 1983 dans lequel Arnie (Keith Gordon) se fait posséder par une voiture tueuse ? En dehors de Christine, la plupart des films abordant cette thématique sont des nanars. Est-ce une coïncidence ? Je ne pense pas. Il est difficile de garder son sérieux quand les personnages de Maximum Overdrive (1986) sont pourchassés par une armée de véhicules tueurs. Dans Cell Phone (2015), les gens deviennent des zombies après avoir entendu un étrange signal provenant de leur téléphone portable. Mais la palme du nanar revient sans aucun doute à The Mangler (1995), dans lequel une presseuse possédée par un démon commence à écrabouiller celles et ceux qui ont le malheur de l’approcher. Après réflexion, c’était peut-être les costumiers et maquilleurs de Robert Englund qui étaient possédés…
Les fanatiques religieux en prennent aussi pour leur grade dans le SKCU. Avant d’être invitée au bal du diable, Carrie (Sissy Spacek, en 1976) est harcelée par ses camarades de classe. C’est un fait. Mais elle est aussi et surtout étouffée par l’éducation de sa fanatique de mère : Margaret, incarnée par Piper Laurie. Une autre dévote un peu trop zélée, Madame Carmody (Marcia Gay Harden) n’hésite pas à avoir recours au sacrifice humain, dans The Mist. Le film Peur bleue (1985, inspiré du roman illustré et calendrier L’année du loup-garou) n’est pas en reste.
Mais le plus vieux démon de Stephen King est l’addiction. L’auteur eut une relation douloureuse avec la drogue et fut alcoolique pendant de nombreuses années. Ceci explique probablement pourquoi certaines de ses histoires sont si… spéciales. Le sujet de l’addiction est parfois abordé frontalement, en mettant en scène un personnage qui en souffre, comme Jack Torrance. Dans d’autres histoires, il ne s’agit que de métaphores peu explicites. Ainsi, l’histoire de Misery ne dénoncerait pas seulement les fans trop zélés mais l’addiction. Il est vrai qu’Annie éprouve une passion dévorante pour le personnage fictif de Misery ou pour son auteur, Paul. Celui-ci est cantonné à l’histoire de Misery puis retenu dans un huis clos, de la même manière qu’une personne souffrant d’addiction s’enferme dans l’accoutumance. Quand le saint-bernard enragé Cujo s’en prend à une mère et son petit garçon, il ne serait lui-même que la métaphore d’un homme violent et toxique. Ces sens de lecture sont, quelques fois, très bien cachés, mais rendent ces œuvres d’autant plus cruelles.
Un dyptique féministe
Il arrive qu’on reproche à Stephen King de ne pas vraiment savoir écrire les personnages féminins. Bien que Carrie soit son premier roman, il ne parvenait pas à s’identifier ni à s’intéresser à l’adolescente. Heureusement, Tabitha King, son épouse, l’aida à comprendre l’héroïne et à l’apprécier. Bien que l’auteur dépeigne des ménages malheureux, il est marié depuis 1971 et bien conscient que, sans Tabitha, il se contenterait d’écumer les bars, avec les tiroirs emplis de manuscrits inachevés.
Dans les années 90, l’auteur commence à faire amende honorable et à donner vie à des héroïnes intéressantes. Jessie (2017) et Dolores Claiborne (1995) ont bien des points communs. Les deux adaptations sont issues de romans rédigés en 1992. Une éclipse joue un rôle majeur dans chaque intrigue. Dolores Claiborne, interprétée par Kathie Bates, est soupçonnée du meurtre de la vieille dame pour qui elle travaillait. Cette enquête lui sert de prétexte pour revenir sur une affaire antérieure : la disparition de son mari, des années plus tôt. Il s’agissait d’un homme alcoolique, abusif envers son épouse mais aussi envers leur fille. Dans Jessie, l’héroïne éponyme est contrainte de participer aux jeux sexuels de son mari, avant que celui-ci ne soit victime d’une crise cardiaque. Menottée à son lit, la jeune femme commence à avoir des hallucinations qui font ressurgir des souvenirs enfouis. Mais s’agit-il seulement d’hallucinations ? Dans les deux cas, une femme blessée par le passé prend sa revanche sur la gent masculine. Dans la même veine, on peut mentionner le film Couple Modèle (2014), dans lequel Darcy (Joan Allen) réalise, après des années de ménage, que son mari est un tueur en série…
Épilogue
Stephen King est probablement l’auteur vivant le plus adapté au monde, si bien qu’on peut parler de SKCU. Les histoires qu’il écrit peuvent terrifier mais ce n’est peut-être pas la peur qui unifie à ce point les gens. Les lecteurs et lectrices, puis les spectateurs et spectatrices sont rassemblés par des thématiques qui leur semblent authentiques et qui leur parlent… La lutte sempiternelle du bien contre le mal, les huis clos, la maltraitance ou au contraire la revanche des enfants : tout cela suscite des émotions intenses. Si aucune phobie n’est épargnée, qu’il s’agisse de la peur des clowns, des chiens ou des… presseuses tueuses ; ces histoires et par extension ces films renvoient surtout à des doutes et des angoisses ancrés dans la réalité. L’auteur essayait lui-même d’exorciser sa peur de l’addiction. Il y a bien sûr beaucoup à redire sur le SKCU. Une quantité non négligeable d’adaptations ont mal vieilli, lorsqu’il ne s’agit pas de nanars. Cela n’en demeure pas moins une œuvre majeure de la pop culture.
Si vous souhaitez en savoir davantage, je vous encourage vivement à découvrir certaines des adaptations mentionnées plus haut, voire même les romans ou nouvelles dont elles sont tirées. Je ne peux que conseiller le visionnage du documentaire Stephen King – Le mal nécessaire (Amazon Prime) ainsi que la lecture de deux ouvrages. D’après une histoire de Stephen King recense les différentes adaptations tirées de l’imaginaire de l’auteur, en récapitulant les points communs ou les différences entre les films et romans. Stephen King à l’écran résume de manière plus analytique lesdites adaptations.