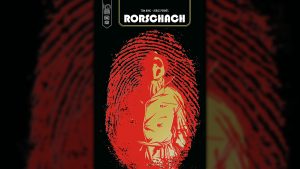Watchmen n’a jamais autant décliné son univers. Créé par Alan Moore en 1986, le comics a marqué des générations après lui, que ce soit du côté du public ou des auteur·ice·s. Et si son illustre auteur a pris ses distances, depuis, avec le monde des comics, DC Comics ne se gêne pas pour exploiter la licence. Parfois pour le pire, avec certaines productions particulièrement douteuses où l’univers de Watchmen se mélangeait à celui de DC sous l’ère DC Rebirth (avec l’évènement autour de Doomsday Clock), et d’autres fois pour le meilleur, comme l’excellente série télévisée de Damon Lindelof ou encore ce Rorschach, tout droit sorti de l’imaginaire de Tom King.
Cette critique a été écrite suite à l’envoi d’un exemplaire par l’éditeur.
La figure de Rorschach
Jamais avare en compliments pour le travail de Tom King, je vous l’annonce de suite : cette critique de Rorschach ne va pas déroger à la règle. Celui qui ne cesse de s’approprier et de réinventer des personnages du giron DC a mis la main sur Rorschach, personnage aussi emblématique que problématique de l’univers Watchmen. Célébré comme un héros incompris par de nombreuses personnes qui n’ont décidément rien pigé à l’œuvre originale, Rorschach incarne toute l’ambiguïté, et même toute la dangerosité d’un « super-héros » qui a carte blanche et qui prétend combattre la violence par la violence. Personnage servant aux revendications de Moore, qui voyait là un moyen d’alerter sur les risques d’une fascination sans borne pour le pouvoir des super-héros et la lutte contre le crime par la vengeance. Et Tom King reprend cette idée, pardon pour le spoil de Watchmen (mais ça fait 35 ans, quand même), en imaginant les suites probables de l’attaque du calmar extraterrestre à la fin du comics d’origine, avec ses conséquences politiques et sociales, ainsi qu’un fort accent mis sur le traumatisme et la rédemption, comme à son habitude. Plus encore, c’est les conséquences de l’existence de Rorschach qui interroge, avec l’empreinte qu’il laisse sur un monde bouleversé et en manque de repères. Une influence qui est identifiée dès les premiers instants, alors qu’un homme déguisé avec le masque de Rorschach, accompagné par une jeune femme masquée, tente d’assassiner un candidat à la présidentielle. On suit un enquêteur qui tente de comprendre pourquoi, et pour ce faire, se retrouve vite à enquêter sur Will Myerson, l’auteur d’une BD de pirates.
Sous l’angle du polar, l’auteur imagine un monde qui vient de subir une attaque extraterrestre qui ne fait aucun sens, avec ce que cela implique de regain de popularité pour le complotisme et des croyances folles, à l’image de la jeune femme masquée qui imagine que les calmars contrôlent les âmes des gens. Un moyen aussi d’attaquer, à la Alan Moore, le besoin de se masquer pour exister, se fonder une identité qui permet d’échapper aux interdits du monde. Malin et particulièrement bien raconté, le comics aborde tout ce qu’a pu avoir de néfaste l’influence de Rorschach sur le monde, et on le sent, avec un parallèle constant sur notre réalité. Parce qu’il faut bien le dire, la figure du personnage imaginé à l’époque a dépassée son auteur, lui qui a souvent été érigé en héros pour des gens qui y voyaient une solution alors qu’il est foncièrement marqué par la violence et le fascisme, incarnant cet espèce de fantasme de la vengeance et de la justice expéditive péniblement retranscrite dans l’adaptation cinématographique sortie il y a une dizaine d’années. Toutes les conséquences destructrices de la figure du personnage, qui n’existe qu’au travers des fantasmes des protagonistes de Tom King, sont abordées. Notamment via les deux personnes qui tentent d’assassiner le candidat à la présidentielle, faisant passer la vengeance personnelle comme un acte de citoyenneté, un acte caché derrière une prétendue critique du système qui est en réalité la satisfaction d’une pulsion meurtrière et d’un désir de pouvoir. Sorte de résumé d’une Amérique toujours plus violente, le comics Rorschach est une réussite.
Une violente fascination
Plus encore qu’à Watchmen, Tom King rend de multiples hommages au monde du comics, en faisant de l’un de ses principaux personnages un créateur de comics (qui évoque l’œuvre intradiégétique de Watchmen) ou encore en racontant un simili-Frank Miller et son The Dark Knight Returns. On sent que l’auteur, à sa manière, balaie une trentaine d’années marquées par l’influence de l’oeuvre originale, à laquelle il offre un prolongement franchement intéressant. Certes, et très paradoxalement, l’univers de Watchmen devient un élément presque accessoire au bout du compte tant l’histoire finit par se tenir à elle seule, mais ce polar hyper-maîtrisé n’aurait pas forcément un point de départ aussi génial que sans la présence d’un masque qui évoque tout un pan de l’histoire des comics. Et c’est d’autant plus réussi que le trait de Jorge Fornés, que je ne connaissais pas, parvient parfois à rendre de jolis hommages à l’œuvre original, qui plus est avec la colorisation de Dave Stewart. Sans nécessairement singer le travail effectué par Dave Gibbons à l’époque, on sent que quelques choix de couleurs, quelques cases, quelques gestes ne sont pas tout à fait innocents.
Aussi beau que pertinent, le Rorschach de Tom King est une des plus belles réussites d’une licence souvent malmenée. Plein d’amour pour l’œuvre original sans pour autant hésiter à en donner sa propre interprétation, l’auteur imagine un polar à mi-chemin entre thématiques d’antan et des considérations plus actuelles, allant d’un complotisme toujours plus présent à la figure d’un super-héros qui n’en était pas vraiment un. Grinçant sur l’héritage de Rorschach, King montre les conséquences les plus violentes de son héritage, dans un monde post-Watchmen où l’horreur et la peur ne vient plus d’un extraterrestre, mais bien de celles et ceux qui ont pris un anti-héros comme modèle.
- Rorschach de Tom King est disponible depuis cet été en librairie aux éditions Urban Comics.