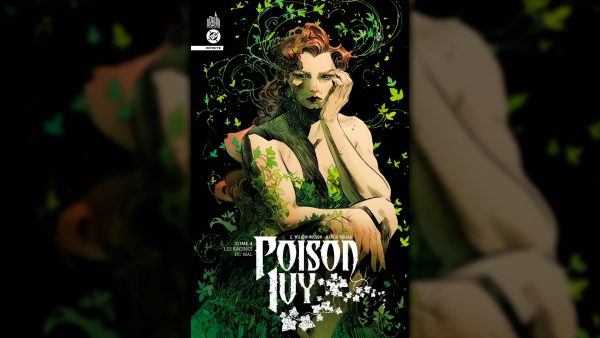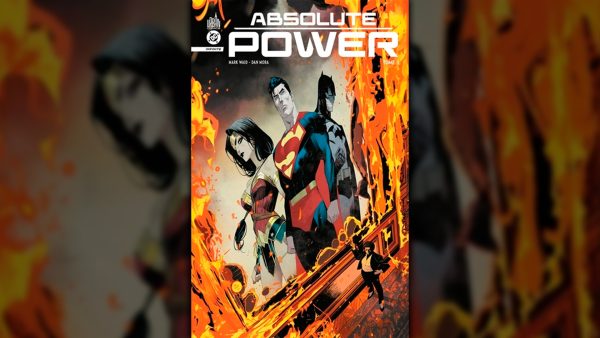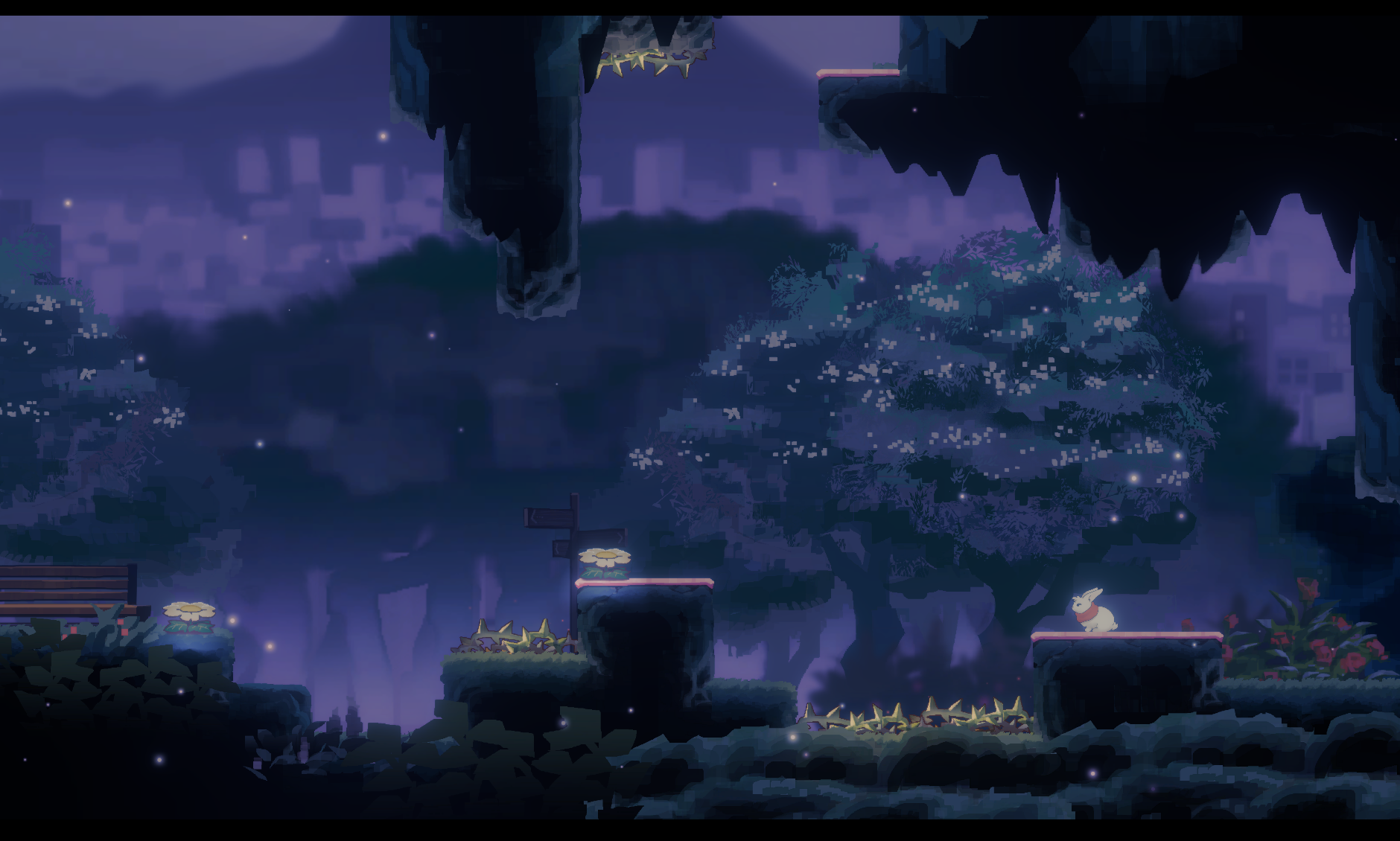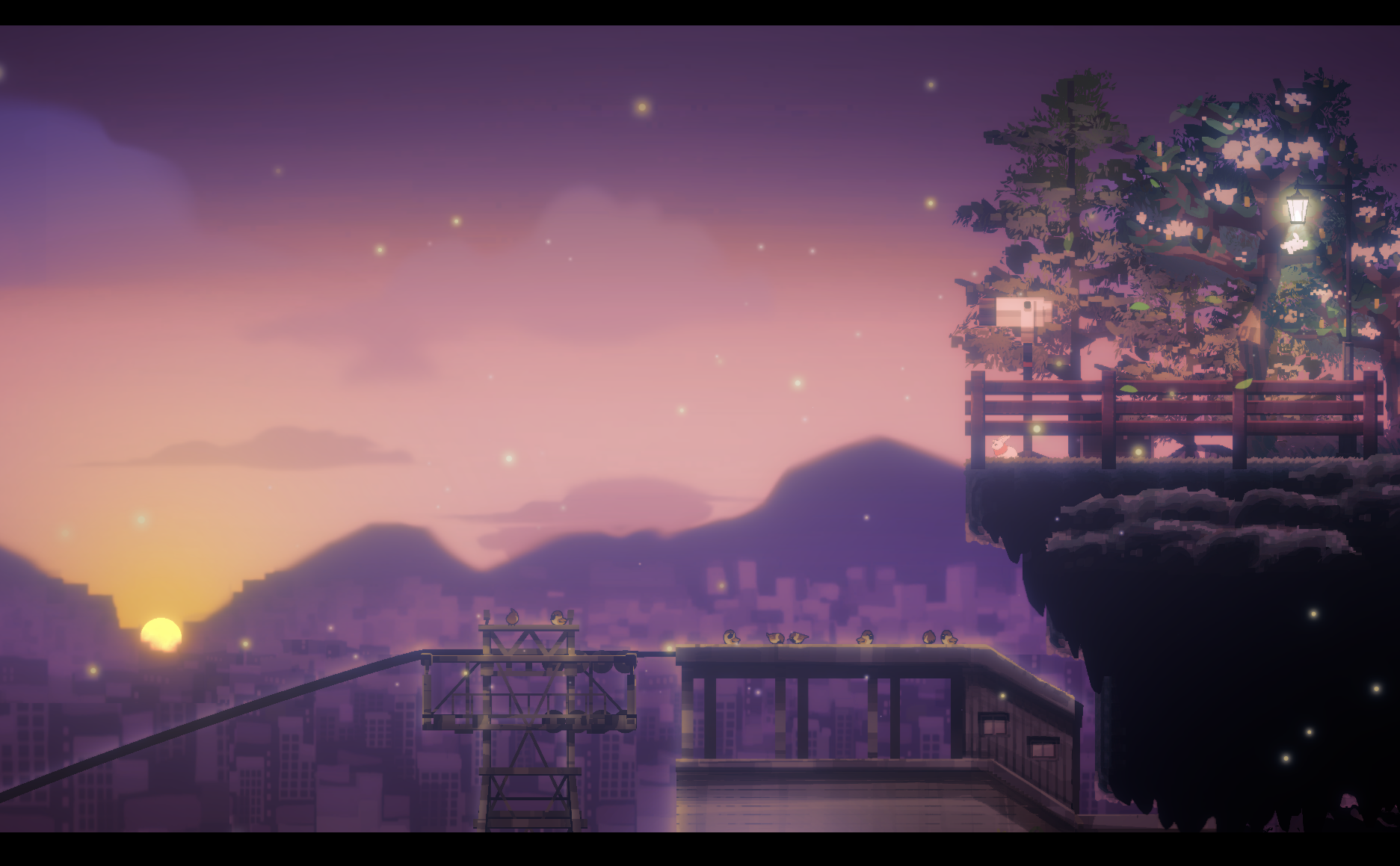J’ai une profonde affection pour le cinéma de Thomas Vinterberg, un réalisateur danois qui, à travers ses œuvres, parvient à capter ce qu’il y a de plus sombre ou de plus lumineux dans l’âme humaine, sans jamais la juger. C’est le cas dans son second film : Festen, aujourd’hui un classique de la scène danoise, mais aussi des métrages plus connus comme La Chasse ou Drunk, (lequel fut ni plus ni moins un coup de cœur.) C’est donc avec une curiosité certaine que je me suis orientée vers sa première série, disponible sur Canal +, en France : Families Like Ours.
« Il y a quelque chose de pourri au royaume de Danemark »
S’il est étonnant de voir Thomas Vinterberg se diriger vers le petit écran, il l’est également de le voir écrire et réaliser une série dystopique. Le réalisateur, qui excelle dans les drames sociaux d’une réalité brute, nous propulse cette fois-ci dans un futur proche. Le gouvernement du Danemark décide de faire évacuer le pays, progressivement, avant qu’il ne disparaisse à jamais sous les eaux. Malgré ce scénario a priori catastrophe, ne vous attendez pas à une série qui s’appuie sur le sensationnel, l’action ni des effets spéciaux à foison. Bien au contraire, Families Like Ours aborde le sujet de manière très intimiste, presque terre-à-terre, en se focalisant sur une famille en particulier. L’intrigue est ainsi resserrée autour de quelques personnages, plutôt que de nous exposer les scènes de violence habituellement propres à ce type de récits. S’il fallait désigner un personnage principal, on pourrait mentionner Laura (Amaryllis August), une lycéenne dont les parents sont séparés. Cela va poser un dilemme profond à Laura, car son père et sa mère n’iront pas se réfugier dans le même état. Les danois les moins fortunés ne peuvent pas choisir leur pays de destination, ce qui amène la mère de Laura à devoir se rendre en Pologne. Or, les réfugiés ne savent pas au bout de combien de temps ils pourront de nouveau voyager. D’un autre côté, le père de Laura a refait sa vie. Il a une femme, un fils et le projet de se rendre à Paris. S’il peut être amusant, pour certain(e)s, de regarder des foules entières se faire engloutir par des vagues géantes ; je préfère de loin le parti pris de Families Like Ours, qui situe son action avant la catastrophe, afin de se concentrer sur d’autres problématiques, nettement plus humaines. Si vous deviez quitter votre maison et votre travail du jour au lendemain, que feriez-vous ? Si les personnes que vous aimiez le plus venaient à partir dans des pays différents, qui suivriez-vous ? Ce dilemme moral amènera quelquefois Laura à prendre des décisions peu raisonnables, pour ne pas dire stupides. Mais après tout, qui sommes-nous pour juger, nous qui avons fait du papier WC une denrée rare, durant le confinement ?
« It’s easier than just waitin’ around to die »
Bien que Families Like Ours se concentre sur une famille, il y a suffisamment de personnages pour explorer plusieurs types de réactions, face à la catastrophe. On peut mentionner les quelques apparitions d’Holger, le vieil oncle de Laura, incarné par Thomas Bo Larsen (un acteur fétiche de Vinterberg). Celui-ci, certes dépassé par les événements, choisit de s’insurger face à certaines décisions du gouvernement, jugées exagérées voire malhonnêtes. Si Holger décidera de rester dans son pays natal, malgré les dangers annoncés ; beaucoup d’autres préféreront fuir, là où ils n’ont pas le droit d’aller. Il est difficile d’en dire plus, sans spoiler, mais je pense au petit-ami de Laura, Elias, joué par Albert Rudbeck Lindhardt. Le jeune homme sera, par la force des choses, contraint de voyager seul, à pieds. Or, c’est prendre le risque de traverser des frontières, clandestinement, et d’être traité en conséquence. Families Like Ours donne une leçon aux occidentaux qui peinent souvent à se mettre à la place de celles et ceux n’ayant d’autre choix que de fuir leur propre pays, dans l’urgence. De la même manière que Road 96, un jeu vidéo dont j’ai parlé dernièrement ; Families Like Ours nous fait épouser le point de vue de personnes prêtes à tout pour fuir leur pays, car elles ont déjà tout perdu. Au-delà de ces angles émotif et politique, la série comporte aussi quelques thématiques sociales. J’ai particulièrement apprécié Henrik (incarné par Magnus Millang, un autre familier de Vinterberg) et son mari Nikolaj (joué par Esben Smed). Dans la mesure où Nikolaj travaille au gouvernement, les deux hommes font partie des premières personnes au courant, ce qui leur permet d’anticiper le chaos dans lequel le pays va plonger. Nikolaj et Henrik apprennent à se défendre, par la force si nécessaire, et à ne plus se laisser marcher sur les pieds ; notamment par le frère homophobe d’Henrik. Dans ce cas de figure, la catastrophe sert de prétexte pour sortir de vieux cadavres du placard et enfin crever quelques abcès. Je voudrais en dire plus, car bien d’autres personnages ou thématiques méritent d’être abordés. On peut notamment se demander s’il n’y a pas une infime part de surnaturel, dans la série. Mais cela reviendrait à vous divulgâcher une saison, constituée d’à peine sept épisodes, qui vaut la peine d’être visionnée.
Le jour d’après
J’ai été séduite par le concept de la série, et surtout par la manière originale dont il a été traité. Il l’est sous un angle beaucoup plus modeste mais vraisemblable que d’autres productions du genre. Peut-être y a-t-il eu un avant et un après-COVID, dans l’écriture des récits dystopiques. L’atmosphère de Families Like Ours a beau nous être étrangement familière ; la série aurait pourtant été écrite avant la pandémie. Thomas Vinterberg aurait même modifié quelques éléments du script pour que l’intrigue ne rappelle pas trop ce qui nous est arrivé. Je suis toujours fascinée par la tendance prophétique de certains récits d’anticipation. J’ai aussi été charmée par le côté profondément humain et intimiste de Families Like Ours, qui réduit la catastrophe à l’échelle d’une famille. Or, cela n’amoindrit pas le drame, mais l’amplifie. « J’étais moins intéressé par la politique. Je n’étais pas intéressé à faire une sorte de série d’avertissement climatique. On va l’appeler ainsi à certains endroits, j’en suis sûr, mais j’espère que ce n’est pas trop souvent, parce qu’il s’agit davantage de la résilience humaine, de la façon dont les humains peuvent créer des stratégies d’adaptation lorsqu’il y a une crise et lorsqu’ils sont séparés de ce qu’ils aiment, » confie Vinterberg, lors d’une interview. Une fois n’est pas coutume, le réalisateur ne cherche ni à prévenir, ni à faire la morale. Il se contente d’étudier les comportements humains, dans une situation donnée ; ce qui fait de la série une tranche de vie captivante. Les amateurs et amatrices du cinéma de Vinterberg retrouveront, non sans plaisir, plusieurs visages connus, mais aussi une mise en scène reconnaissable. Je pense aux écrans affichant des textos, en émettant un son familier ; ou encore à un choix soigneux de la bande originale, comme en témoigne la chanson Day is Done, de Nick Drake. Tout ce que je peux reprocher à Families Like Ours, c’est de nous laisser sur notre faim ; surtout concernant le destin de certains personnages. Mais, à dire vrai, même si la mini-série se suffit elle-même, je n’aurais rien contre la production d’une saison 2.
Conclusion
Families Like Ours est une série que je conseille vivement, ne serait-ce que pour se familiariser avec les œuvres danoises, possédant une atmosphère qui leur est propre. Le récit catastrophe semble bien plus vraisemblable et proche de nous, que ce à quoi nous sommes habitué(e)s. Ainsi, même s’il y a très peu de plans sur la montée des eaux, la série a plus d’impact que n’importe quel film à gros budget. Thomas Vinterberg met l’accent sur une famille et sur les rapports sociaux. C’est ce qu’il connaît le mieux et il le fait bien. Families Like Ours est, de ce fait, particulièrement intéressante. J’en suis venue à me demander ce que donnerait une version française de Families Like Ours. Le gouvernement brandirait-il un 49.3 pour empêcher les eaux de monter ? Parviendrait-il seulement à prendre la moindre décision, dans les temps, avant que tous les français ne soient noyés ? Réflexion faite, mieux vaut rester concentré(e)s sur le Danemark…
- Families Like Ours est une série disponible sur Canal +, depuis l’hiver 2024.