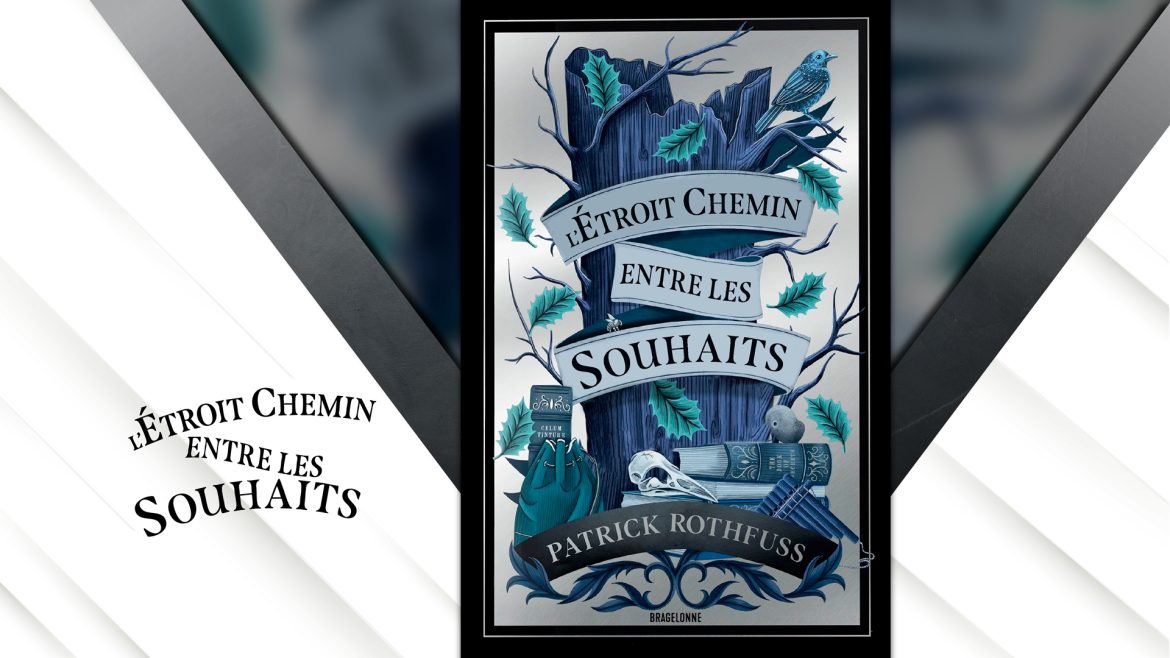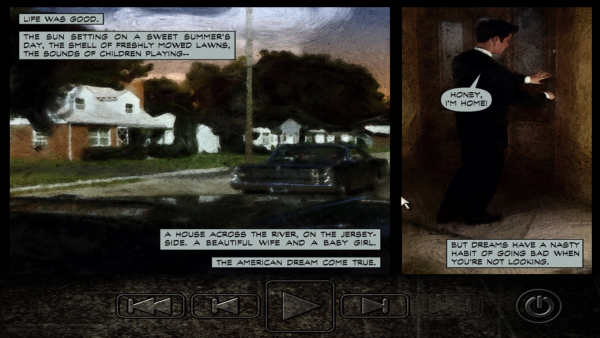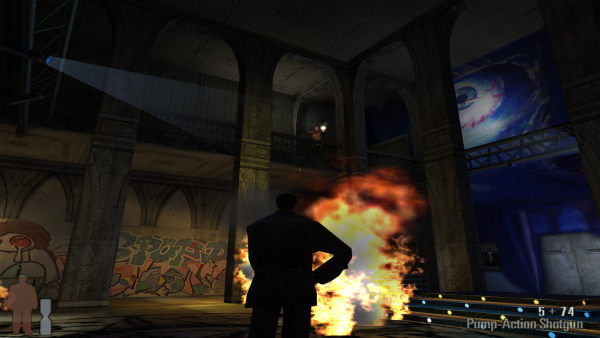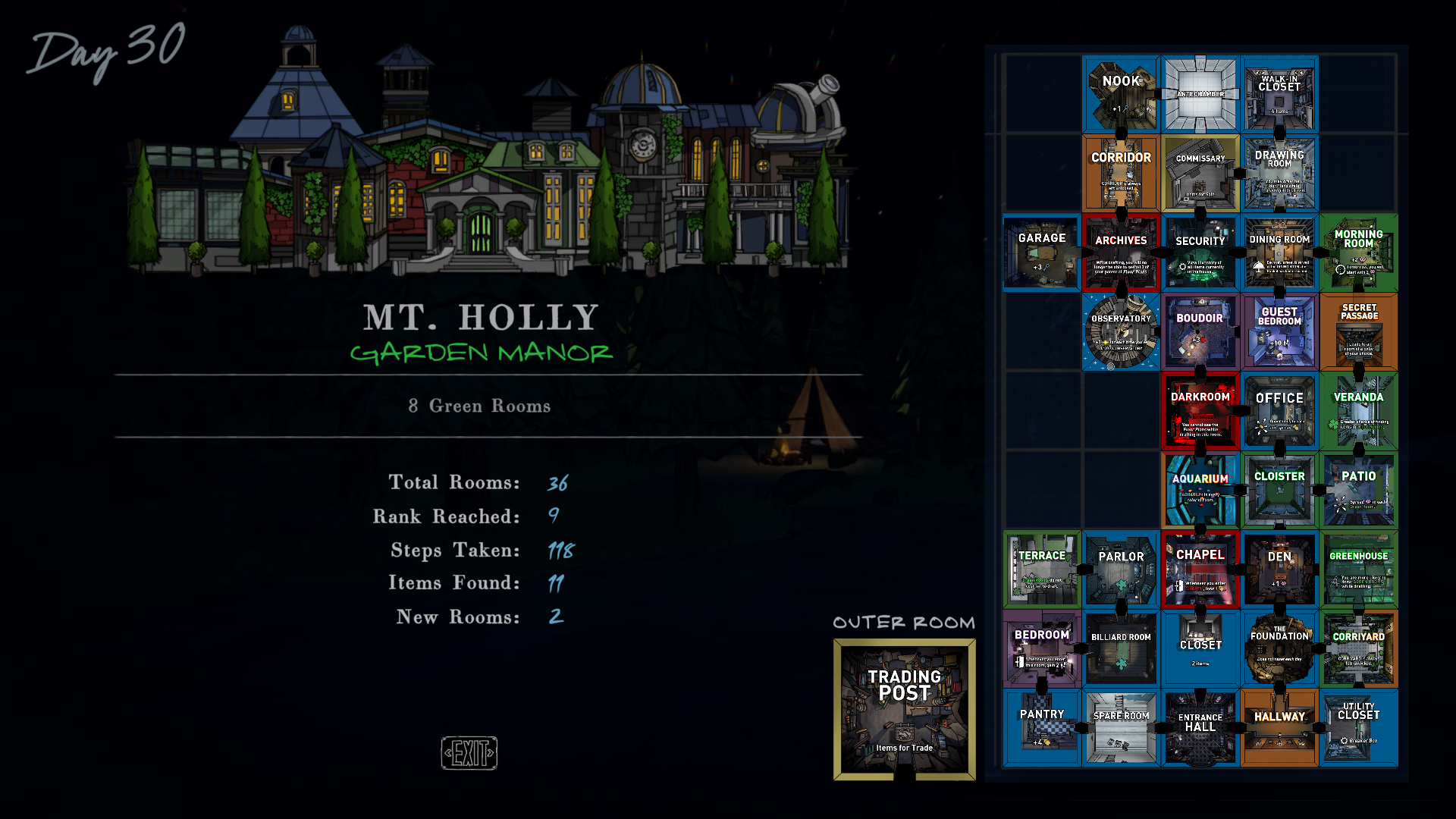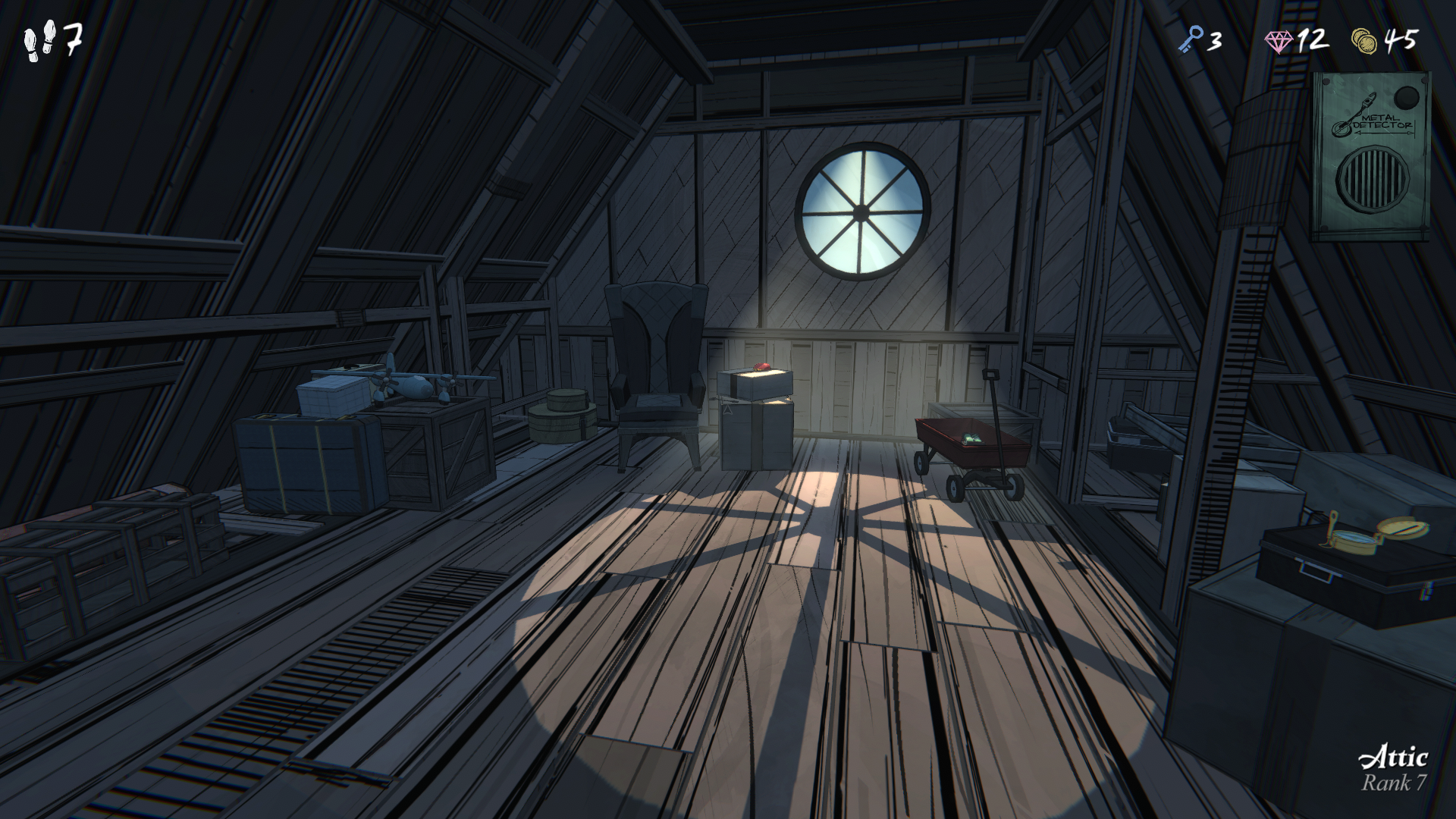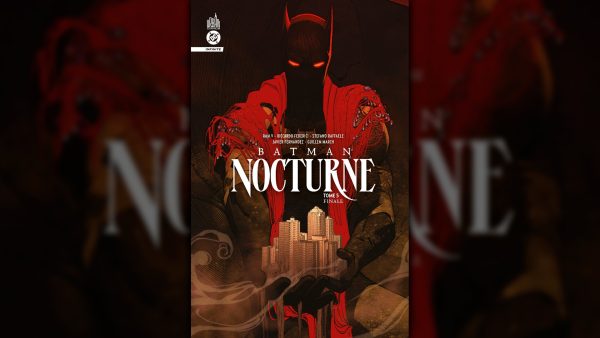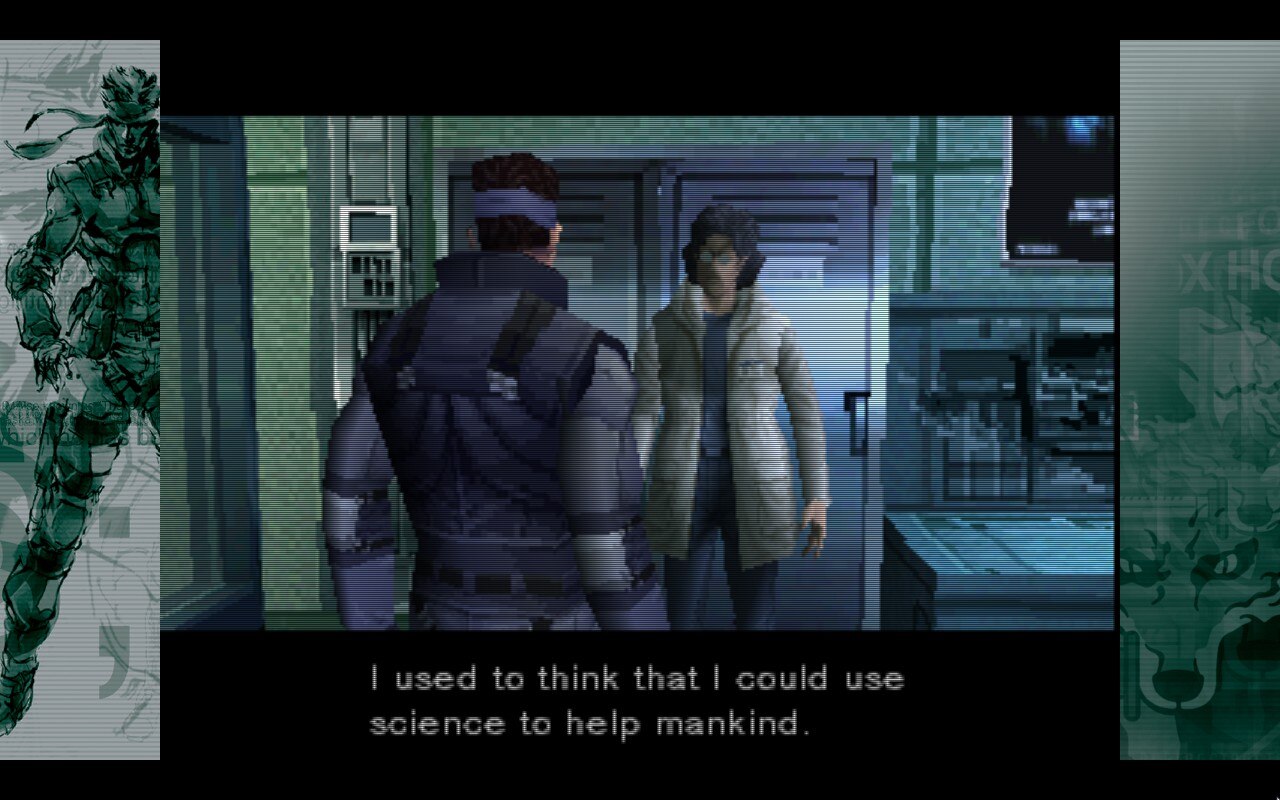Chill Chat, c’est l’émission de Pod’Culture où l’on se pose et on cause avec une personne qui navigue dans les eaux de la Pop Culture ; que cette personne soit un créateur ou une créatrice, artiste, ou encore prescripteur ou prescriptrice.
Pour ce quinzième épisode, j’ai eu le plaisir de discuter avec Phobos, cosplayeuse, photographe, podcasteuse et autrice. Avec elle nous avons abordé le cosplay et la fanfiction, deux domaines de la pop culture qui sont deux façons plus liées qu’elles n’y paraissent de faire vivre nos œuvres préférées, mais aussi de se les réapproprier et, parfois, de nous révéler à nous-mêmes.