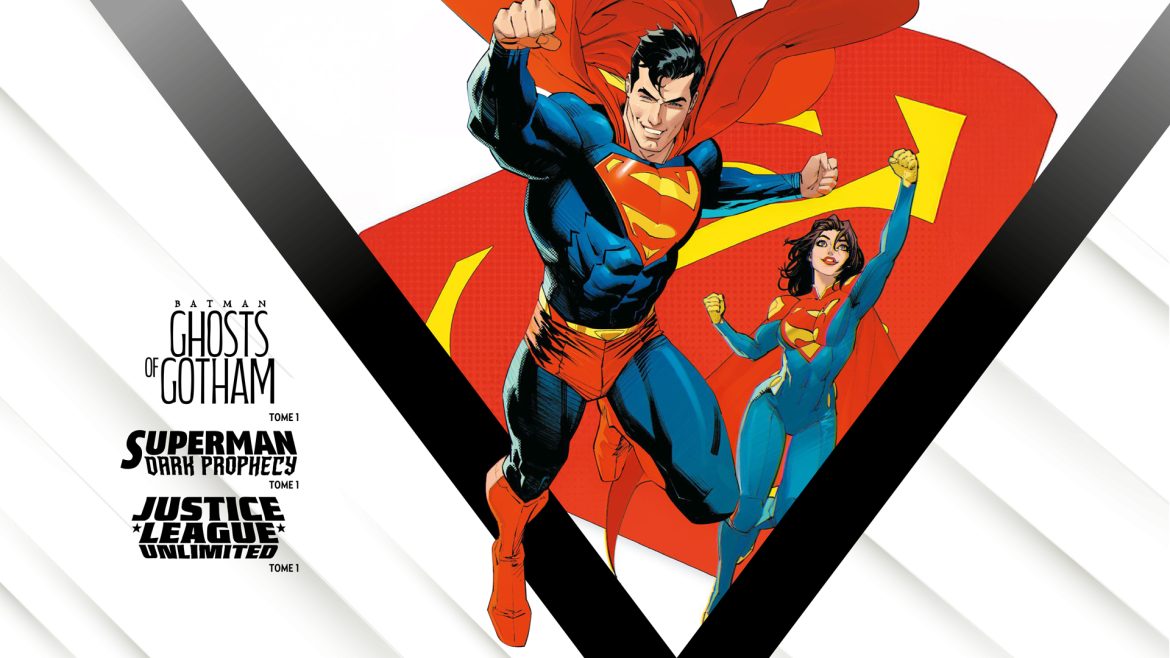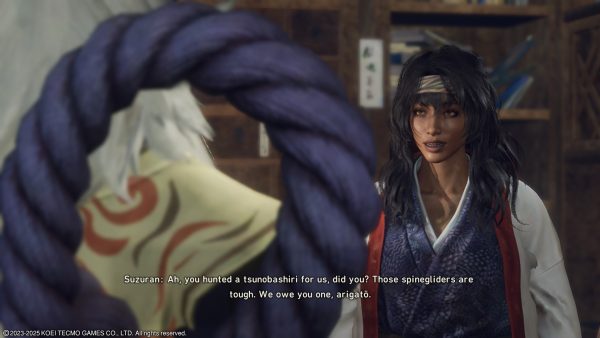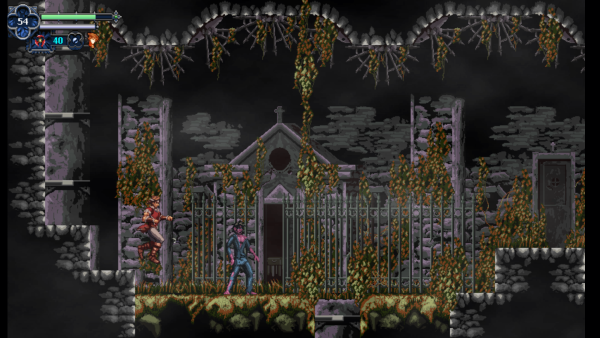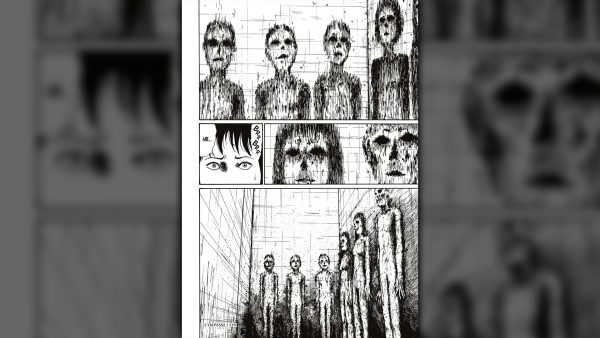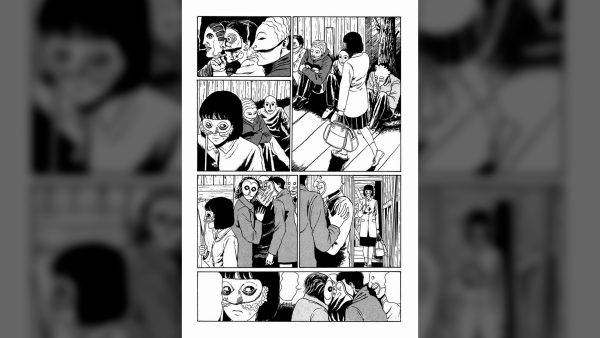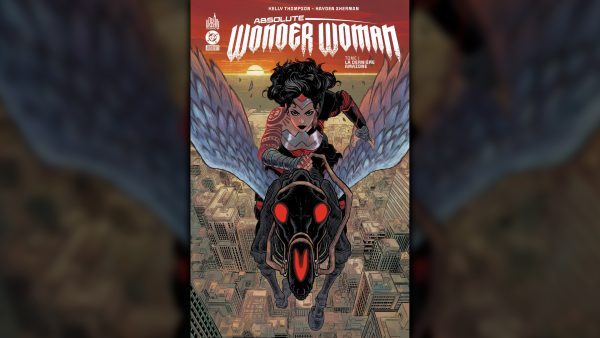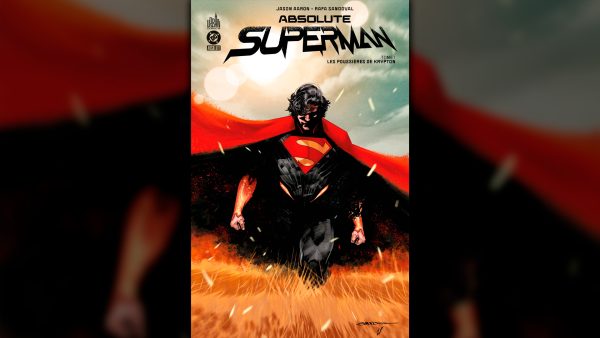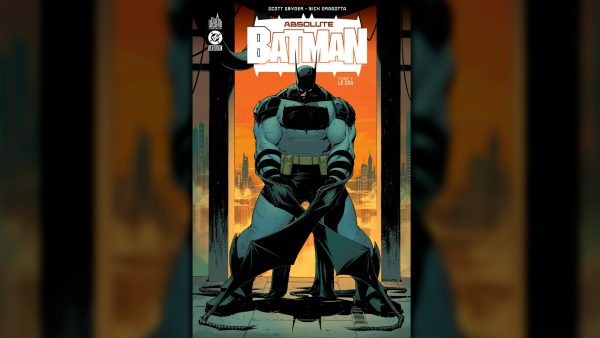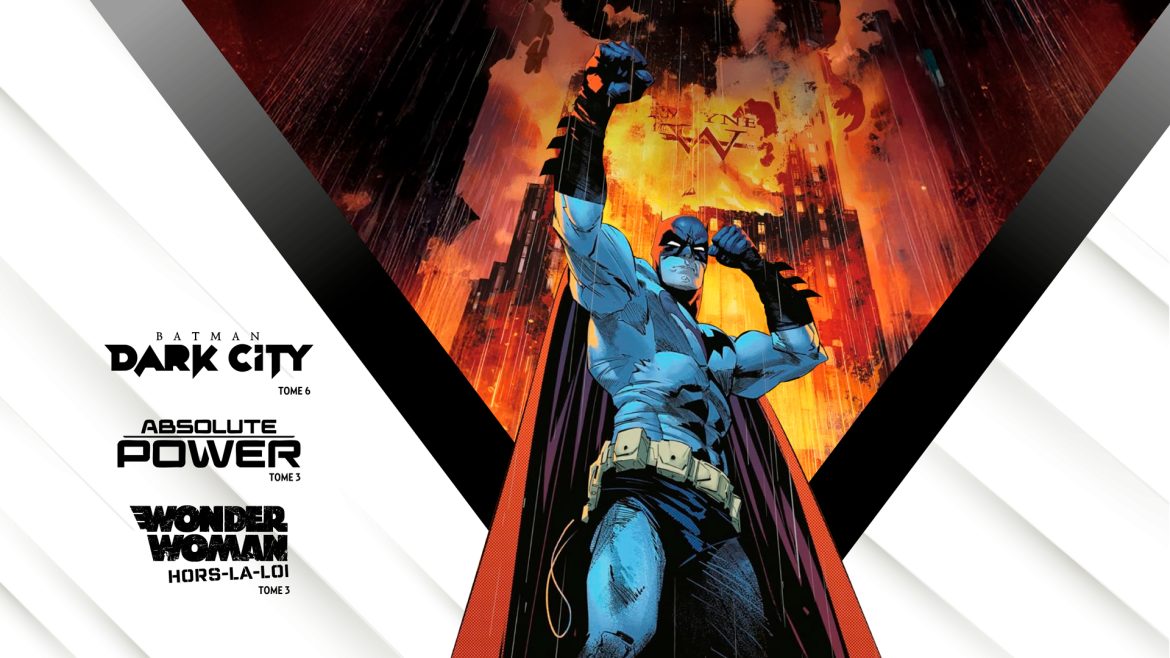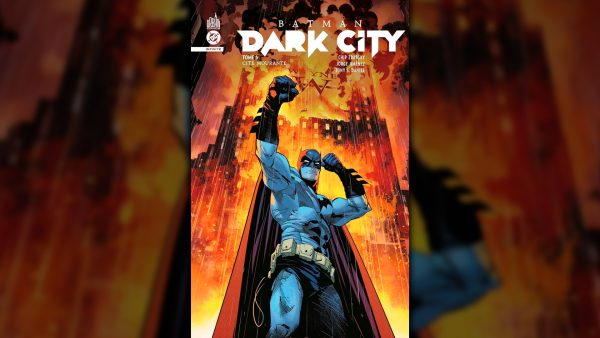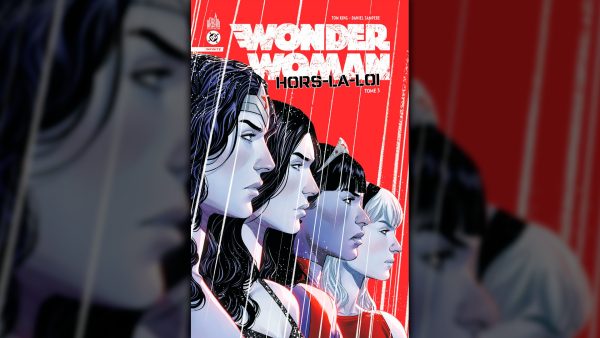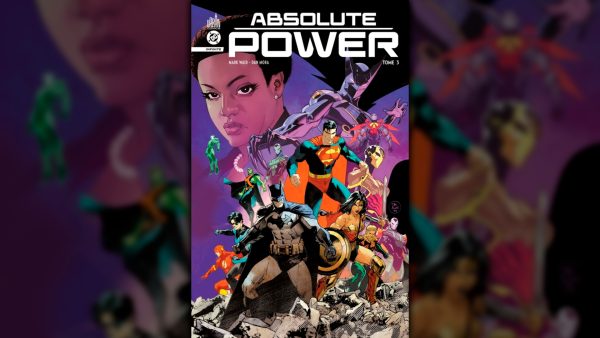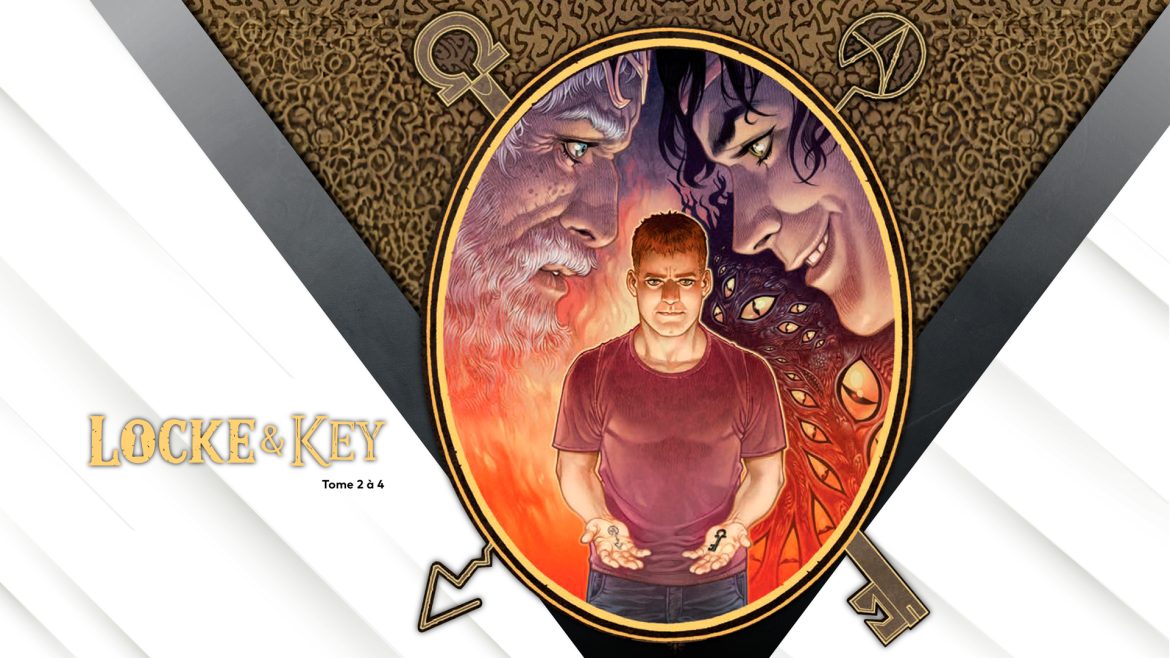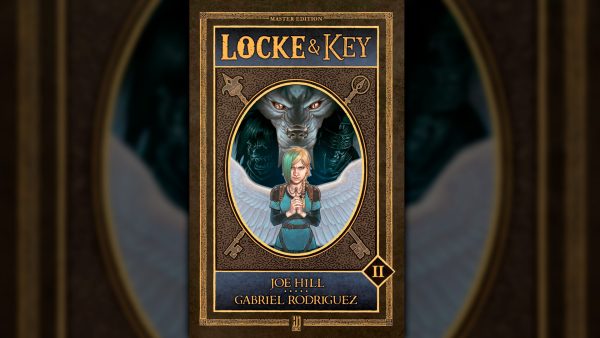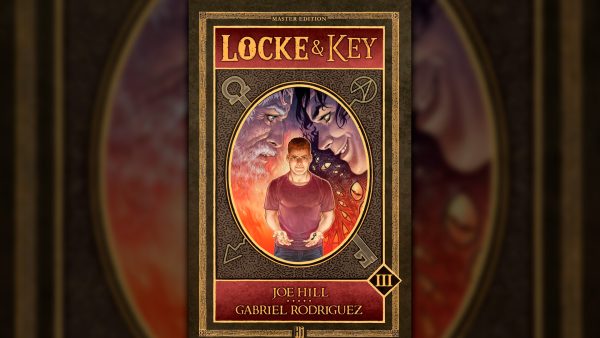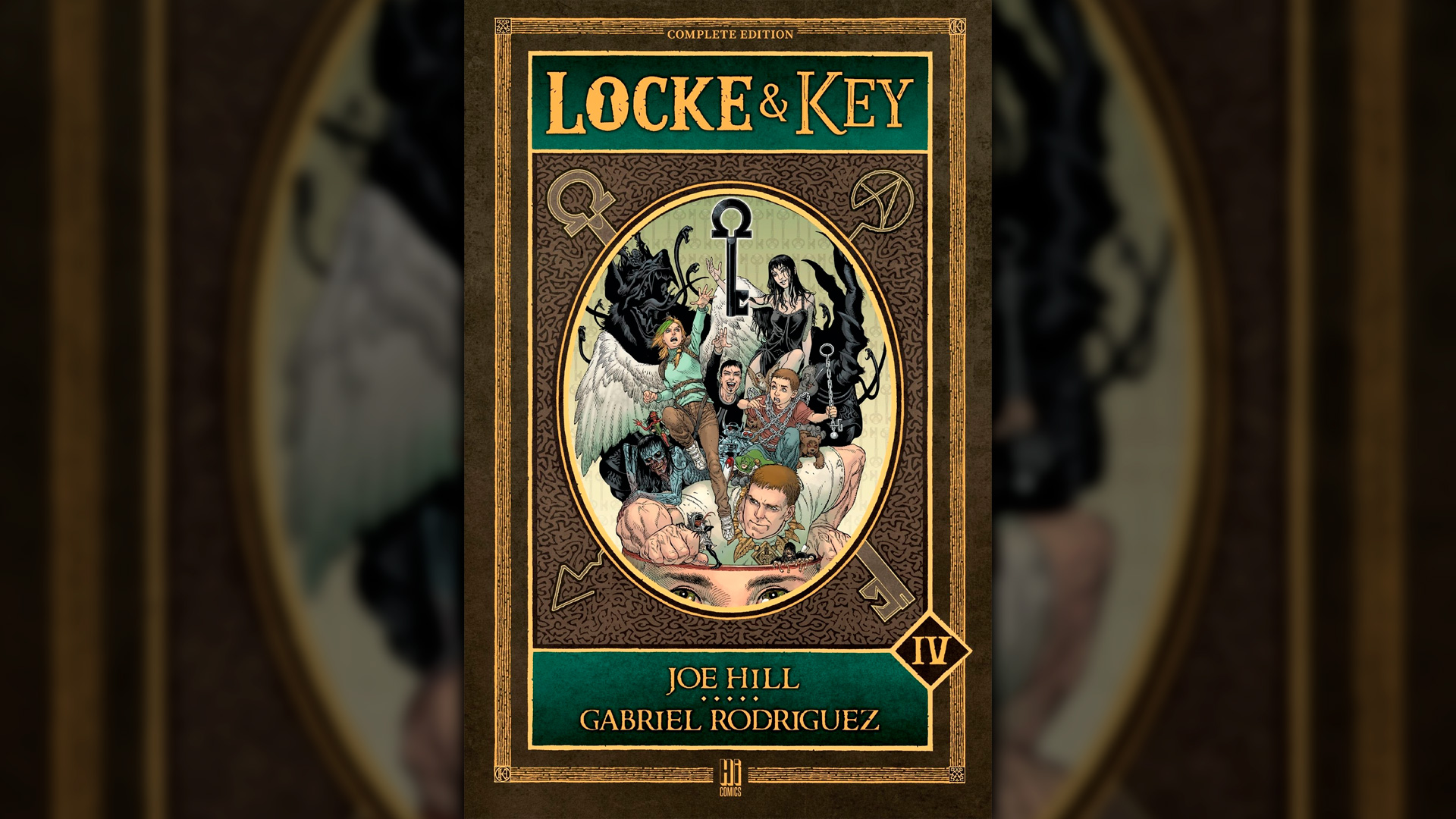La collection « Infinite » de DC chez Urban Comics en VF est désormais de l’histoire ancienne. Après le lancement des DC Absolute qui compilent des comics dans un univers alternatif, place à la continuité avec DC Prime (qui collecte ce que la VO appelle l’ère « All-In »), où l’on retrouve les séries habituelles qui se relancent avec de nouveaux enjeux et souvent des changements côté auteur·ices. Pour commencer, on retrouve cet été la série Detective Comics qui revient sous le titre Batman Ghosts of Gotham, la série principale Superman que l’on retrouve avec Superman Dark Prophecy, et enfin le retour tant attendu de la Ligue de justice, annoncé à la fin de Absolute Power, avec Justice League Unlimited, alors que l’univers Infinite s’en était séparé pendant un bon bout de temps au profit des Titans.
Cette chronique a été écrite suite à l’envoi d’exemplaires par l’éditeur.
Batman Ghosts of Gotham – Tome 1, cure de jeunesse
Le rêve d’une jeunesse éternelle, vieille idée des récits fantastiques à laquelle succombe Tom Taylor pour son arrivée sur Detective Comics. Intitulé Batman Ghosts of Gotham en VF, son récit nous montre un Bruce Wayne affecté par le temps et les nombreux combats qu’il a livré, comme dans la plupart des comics Batman de ces dernières années, et à qui une vieille amie propose une solution miracle : un traitement qui lui permettrait de retrouver sa jeunesse et de vivre plus longtemps. Inévitablement, ce traitement cache quelque chose de plus obscure, et c’est tout l’objet de l’enquête à laquelle s’adonne le détective masqué alors que de jeunes délinquants à peine sortis de prison pour mineur sont tués les uns après les autres, pris pour cible sans que l’on ne sache trop pourquoi. Plutôt classique dans son approche, le comics rappelle toutefois très vite pourquoi on aime autant le travail de Tom Taylor depuis de nombreuses années. Après son fantastique Nightwing Infinite, l’auteur australien part à l’assaut de la pierre angulaire de l’univers DC en rappelant le Chevalier Noir à son premier amour : le travail de détective. Si l’on n’échappe évidemment pas à une petite bataille ici et là, on reste dans un récit orienté polar avec une enquête savamment menée qui tire partie des capacités intellectuelles d’un personnage hors du commun. On y trouve, aussi, des thématiques proches de ce qu’il faisait récemment avec Nightwing, à commencer par l’importance de l’équipe qui l’entoure, mais également son caractère de défenseur de la veuve et de l’orphelin, même quand cet orphelin est un dangereux criminel.
Toujours très fort dans la mise en place des enjeux, l’auteur excelle aussi dans l’art de livrer des scènes clés, le genre de scène « plaisir » qui joue autant sur la corde nostalgique que celle du fan de comics qui veut voir son héros réussir des choses exceptionnelles. Côté dessin, il profite des talents de Mikel Janin qui ne manque jamais d’impressionner et de donner vie à une ville de Gotham très attachante. Et c’est peut-être là que le duo tire son épingle du jeu : plutôt que l’horreur et les frayeurs auxquelles nous ont habitué les précédents artistes sur Batman et Detective Comics ces dernières années, ce Batman Ghosts of Gotham montre un aspect un peu plus positif, ou du moins, plein d’espoir, pour une ville qui enchaîne les situations dramatiques. Et notamment au travers de ces jeunes délinquants à qui Batman veut donner une seconde chance, même quand ces jeunes gens pensent ne plus en avoir aucune. Et c’est là aussi un rappelle assez intéressant à Nightwing, avec un Batman un poil plus positif, moins renfermé sur lui-même, plus proche de sa ville et de sa famille. Un super premier tome donc, en espérant que la suite sera à la hauteur.
Superman Dark Prophecy – Tome 1, et Lois Lane vaincra
Joshua Williamson n’en a pas encore fini avec Superman. À peine sorti des très sympathiques Dawn of Superman que l’on a eu sur la fin de la collection Infinite, l’auteur continue son run et notamment deux éléments vus ces derniers mois : Lex Luthor est toujours gentil suite à l’amnésie qui lui a fait oublier ses méfaits, et Lois Lane est… désormais affublée de pouvoirs. Des compétences similaires à celles de son grand amour Superman, et qui lui permettent de combattre à ses côtés sous le titre de « Superwoman ». L’idée de propulser un personnage sans pouvoirs dans un nouveau rôle est un concept assez ancien dans les comics, toutefois Williamson le gère plutôt bien en utilisant ce trope pour interroger les responsabilités et conséquences qui viennent avec ces pouvoirs. Car Lois Lane se rend vite compte qu’être une super héroïne vient avec beaucoup de regrets, pour toutes les fois où elle ne peut pas agir, et un stress qui la rend infernale dans sa vie privée et professionnelle, notamment du côté du Daily Planet où elle conserve son boulot de rédactrice en chef. Sans révolutionner le genre, ce premier tome s’insère très bien dans la mythologie de Superman et offre de jolis moments entre ses principaux personnages.
L’autre pendant de l’histoire, c’est les conséquences de l’amnésie de Lex et son désir, ou non, de retrouver la mémoire. Effrayé par l’image dépeinte par les autres sur ce qu’il était dans une autre vie, il tente toujours d’oeuvrer pour le bien, mais on sent que l’auteur prévoit quelque chose de plus sombre pour la suite. Idem pour l’arrivée d’une nouvelle menace, l’éternel Doomsday, qui cache quelque chose d’autre. On reste dans un premier tome assez sage qui joue son rôle d’introduction en vue de futurs enjeux, mais avec l’écriture suffisamment maline de Williamson et les superbes dessins de Dan Mora, on se laisse porter et on apprécie la lecture.
Justice League Unlimited – Tome 1, plus grand, plus fort
Batman, Superman et Wonder Woman ont fait le choix de recréer la Ligue de justice, après une dissolution au temps de l’ère Infinite qui avait laissé la place aux Titans, chargé·es de défendre le monde. Mais après la menace de Absolute Power où beaucoup de super-héros et héroïnes ont été privé·es de leurs pouvoirs, il était temps pour l’équipe de revenir. Mais ce récit concocté par Mark Waid, avec des dessins de Dan Mora là encore (qui, décidément, ne doit jamais dormir vu son rythme de publication), s’appuie sur une idée nouvelle : exit la Ligue de justice composée d’une poignée des plus grand·es héros et héroïnes de l’univers DC, et place à la Ligue de justice « illimitée » au sein de laquelle l’ensemble des personnes dotées de pouvoirs ont leur place. Une gigantesque base spatiale est créée, et chacun·e se voit doté·e d’une carte de membre qui y donne accès pour coordonner les efforts et missions. Un concept nouveau qui permet de mettre en valeur de nouveaux personnages, avec son lot de mystères sur les intentions des protagonistes que l’on connaît peu, mais ça a aussi un coût. Celui d’un récit assez brouillon, notamment sur des scènes d’action qui s’enchaînent très vite sans véritable liant dans la première moitié du tome. On peine à comprendre ce qu’il se passe réellement, si ce n’est que l’on enchaîne les missions de sauvetage où tout le monde donne un petit coup de main pour vanter les mérites de la nouvelle Ligue de justice. Si le concept n’est pas inintéressant, il montre aussi vite ses limites avec un récit qui tend à s’éparpiller au lieu de se concentrer sur quelques points essentiels.
Heureusement dans sa seconde partie, ce premier tome de Justice League Unlimited trouve enfin un fil rouge qui permet de recentrer l’histoire sur l’essentiel et développer un peu plus quelques personnages. Pour le moment, cette nouvelle Ligue de justice m’emballe assez peu, avec un concept qui montre déjà des limites, mais je fais confiance à Mark Waid pour trouver les bonnes idées qui permettront à la série de gagner en finesse, tout en profitant des dessins de Dan Mora qui ne déçoivent jamais.
- Les comics de la collection DC Prime sont disponibles en librairie aux éditions Urban Comics.