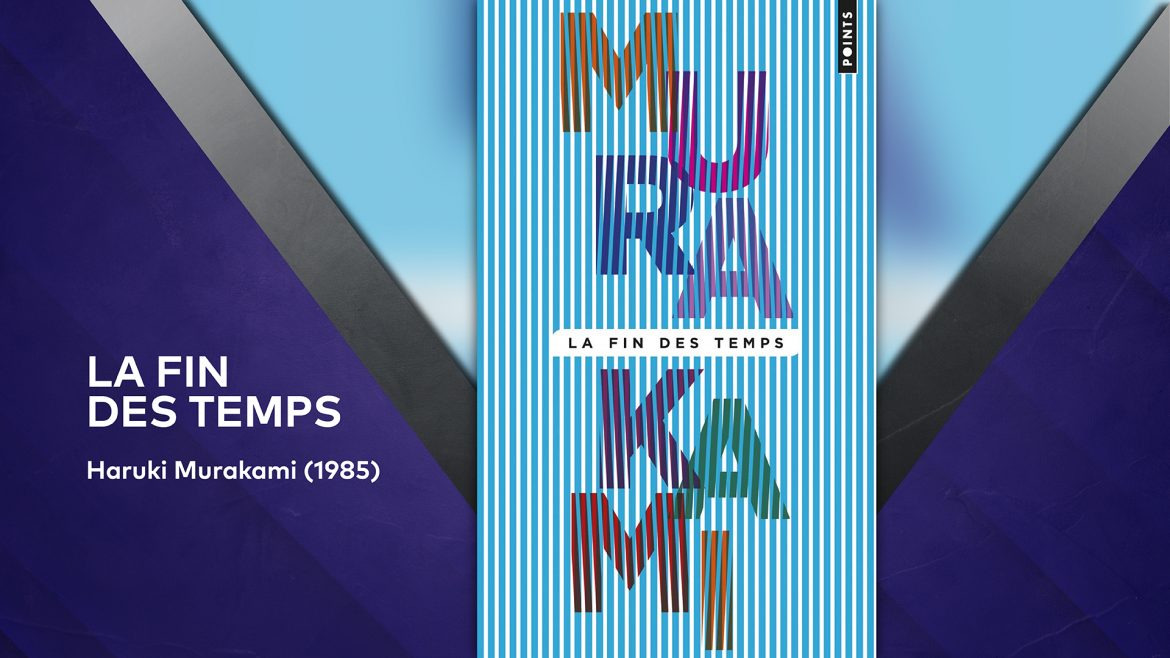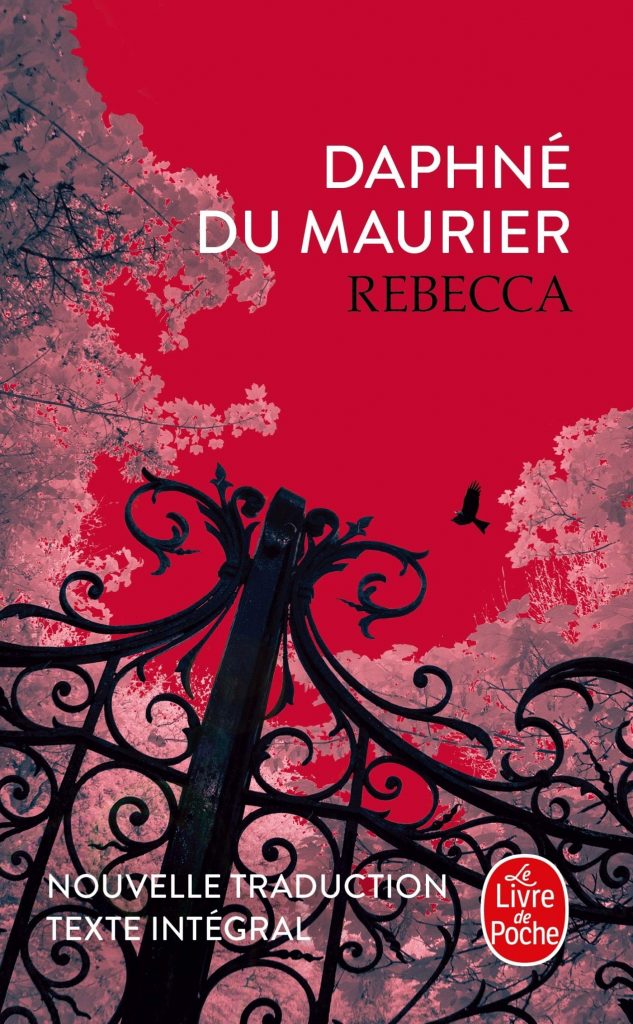La mangaka Reiko Momochi s’est fait connaître il y a bien longtemps pour sa manière de traiter de problématiques sociales, ayant un intérêt particulier pour celles du harcèlement sexuel et du viol, des sujets rares dans le manga. On pense notamment à son anthologie sur la jeunesse publiée au début des années 2000 (Confidential Confessions aux Etats-Unis, jamais traduite en France), ainsi que Daisy – Lycéennes à Fukushima, sorti dans nos contrées en 2012. Celle qui n’a jamais cessé de mettre la lumière sur les drames sociaux est revenue récemment avec Moi aussi, un manga en deux tomes qui s’inspire de l’histoire vraie de Kaori Satō, qui s’est longuement battue pour faire reconnaître l’existence du harcèlement sexuel en entreprise. Un témoignage indispensable, dans un manga qui suscite autant d’indignation que d’espoirs, et qui résonne extrêmement fort chez nous.
Moi aussi débute ainsi sur la petite vie de Satsuki Yamaguchi, une intérimaire comme les autres qui travaille en tant qu’opératrice téléphonique dans le service client d’une grande société. Rapidement, elle est prise pour cible par son supérieur, un harceleur qui ne cesse d’abuser de son pouvoir pour profiter d’elle. La difficulté à trouver de l’aide et le refus de sa hiérarchie d’entendre parler de harcèlement la pousse rapidement à aller plus loin, vers un combat qui la dépasse.
La culture du viol au sein de l’entreprise
L’autrice mélange la fiction à la pédagogie, en distillant des éléments qui permettent de mieux comprendre et aborder le sekuhara, le nom donné au harcèlement sexuel au Japon. Ces mécanismes sont multiples et se retrouvent malheureusement partout, évoquant ce qu’on peut entendre dans les récits des nombreuses victimes de harcèlement sexuel chez nous : la loi du silence au sein de l’entreprise, l’isolement de la victime par son bourreau, la peur d’être pointée du doigt, la mise dans une situation précaire, et bien d’autres choses qui permettent aux harceleurs de s’en tirer à moindre frais. La volonté d’informer sur les mécanismes de harcèlement et les recours contre les agresseurs permet à Reiko Momochi d’ancrer son manga dans le réel et le rattacher à une forme de biographie, de témoignage, de ce qu’a pu vivre celle dont elle s’inspire. Mais c’est aussi un moyen de donner une force inattendue à son récit, celui qui dépasse la fiction et qui lui permet de montrer que le manga peut aussi être un acte militant, dénonciateur, d’une situation de fait qui bénéficie encore de trop de clémence de la part des autorités. La dimension biographique du manga apporte beaucoup au récit, qui se rattache souvent au réel.
L’action commence en 2005, dans un contexte économique qui de facto limite la parole des victimes : la génération de jeunes diplômés à cette époque sont touchés de plein fouet par une crise sans précédent. La bulle spéculative japonaise à la fin des années 1980 produit encore ses effets avec son explosion au cours des années 1990, jusqu’à début 2000. Le marché du travail est morne, les jeunes diplômés se battent pour des postes pour lesquels ils sont surqualifiés et perdre le poste durement acquis s’apparente à une mort sociale. C’est dans ce contexte-là que l’héroïne, Satsuki Yamaguchi, se retrouve à travailler en intérim dans un service client. La situation économique précarise un peu plus un poste d’intérimaire qui l’est par nature, l’incertitude sur l’avenir se mêle au salaire bas et la facilité, pour sa société, de la mettre à la porte. L’autrice intègre entièrement ces données économiques à son analyse de la situation, montrant à quel point le statut de précaire de Satsuki l’empêche d’envisager de prendre la parole.
Au-delà de la précarisation de la victime, la parole se voit obstruée par une culpabilité mise sur ses épaules : cela arrive à tout le monde, cette situation fait partie du métier, il faut juste sourire et trouver un moyen de ne froisser personne pour ne pas être mise en difficulté dans la suite de sa carrière. Et puis, les autres diront qu’elle l’a peut-être cherché et que son bourreau est en réalité un « séducteur ». L’image d’entreprise, où l’on espère que les employés ne feront pas de vagues, passe avant le bien-être des femmes qui y travaillent. Cet élément est particulièrement évoqué quand l’héroïne cherche de l’aide à gauche et à droite, et qu’on lui répond le plus souvent que faute de preuve matérielle, ce n’est que parole contre parole. Un mécanisme de défense des agresseurs qu’on peut observer partout au quotidien, dans les médias, où chaque témoignage d’une femme victime de harcèlement sexuel ramène des hordes de défenseurs de la présomption d’innocence, dans un légalisme exacerbé et très malvenu à l’heure d’écouter les victimes. Un légalisme qui ne profite qu’aux agresseurs. L’intelligence du manga est d’ailleurs de ne pas verser dans l’idée tenace que le bourreau est un marginal, une personne douteuse et inquiétante : le harceleur est en réalité un homme tout ce qu’il y a de plus « normal », bien placé dans sa société, apprécié par ses collègues et même considéré comme attachant et bienveillant. L’histoire de Kaori Satō, c’est finalement celle de beaucoup d’autres femmes.
L’union face aux agresseurs
On pourrait bien reprocher au manga de ne jamais vraiment indiquer où se situe la ligne entre fiction et réalité, entre histoire inspirée et témoignage, mais l’ensemble fonctionne si bien que l’on a bien conscience qu’il serait probablement mal senti de chercher l’exactitude. En réalité, Moi aussi apparaît d’abord comme un cri d’alerte, le premier tome permettant de mettre la lumière sur une histoire, peu importe qu’elle soit fidèle à la vérité ou non, qui devrait ouvrir les yeux de tout le monde. Dans ce premier tome, l’autrice bouleverse lorsqu’elle raconte les pensées de son héroïne sur les passages de harcèlement. C’est glaçant, terrible à lire, particulièrement intense, avec une personne qui vit l’horreur avec le sentiment de ne jamais pouvoir s’en sortir. C’est ce sentiment de solitude qui isole la victime et l’empêche de se battre, de se révolter, jusqu’à ce que l’héroïne trouve un moyen de surmonter ces obstacles pour trouver de l’aide. Puis le deuxième tome embraye sur son combat, se transformant en fable judiciaire où Satsuki se retrouve confrontée à l’administration, la politique et la justice qui tentent tous de la mettre à l’écart. Mais il y a une forme d’espoir qui se dégage de cette histoire, puisque le parcours de Kaori Satō, dans la réalité, a permis de faire bouger les choses.
Il y a d’ailleurs un basculement formidable entre les deux tomes, la fin du premier sonnant comme un espoir après la résignation, à un moment où l’héroïne découvre que d’autres victimes de harcèlement existent comme elle, qu’elles sont aussi courageuses. Et c’est en se rassemblant autour d’une association qu’elles parviennent à se lancer dans une bataille judiciaire qui ne fait aucun cadeau. C’est sur cette période, au moment où l’espoir renaît, que le manga dévoile d’ailleurs tout son potentiel : les dessins sont saisissants, les expressions de ses personnages nous emportent dans leurs émotions, et c’est comme toujours très bien écrit. L’autrice couvre pourtant de nombreuses situations, le récit s’étalant sur une dizaine d’années, allant du premier harcèlement jusqu’aux conséquences juridiques et les traumatismes, mais elle s’en sort toujours à merveille et parvient à conserver cet équilibre entre le récit et la pédagogie. Non seulement on en apprend beaucoup sur le combat judiciaire, mais en plus le manga raconte très bien tout ce qui empêche encore, malheureusement, les victimes d’être écoutées et accompagnées.
Moi aussi est une lecture intense, prenante, qui doit autant à son rythme qu’à la densité des informations que l’autrice veut transmettre. La narration se mêle à la pédagogie et devient un pamphlet pour une meilleure reconnaissances des Droits des femmes, mettant en avant le combat de l’une d’elles qui, par son courage et son abnégation, a initié un nouveau mouvement au Japon. C’est parfois difficile à lire tant l’émotion est vive, mais cette lecture apparaît comme indispensable tant l’œuvre est intelligente, l’autrice Reiko Momochi célébrant à sa manière les femmes qui ont été confrontées à ces situations de harcèlement. Elle leur offre une attention touchante et salvatrice, mettant en avant leur courage, en opposition à un patriarcat profondément ancré dans une société qui, comme toutes les autres, refuse de l’admettre.
- Moi aussi est disponible en deux tomes (série terminée) aux éditions Akata.
- Jusqu’au 30 avril 2021, pour chaque exemplaire du tome 2 vendu, 5% du prix est reversé à la Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF) : https://www.solidaritefemmes.org/
Pour aller plus loin :
- « Du récit intime à la dénonciation, quand le manga s’empare des violences envers les femmes« de Pauline Croquet, Pixels, Le Monde, 3 novembre 2020.
- Le gouvernement a décidé de mettre en concurrence la gestion du 3919, le numéro d’appel et de soutien aux femmes victimes de violences, au risque de voir sa rentabilité financière passer avant l’accompagnement des victimes. Une pétition est organisée pour remettre en cause cette décision, dont les conséquences pourraient être désastreuses : https://www.solidaritefemmes.org/actualites/tribune-17112020